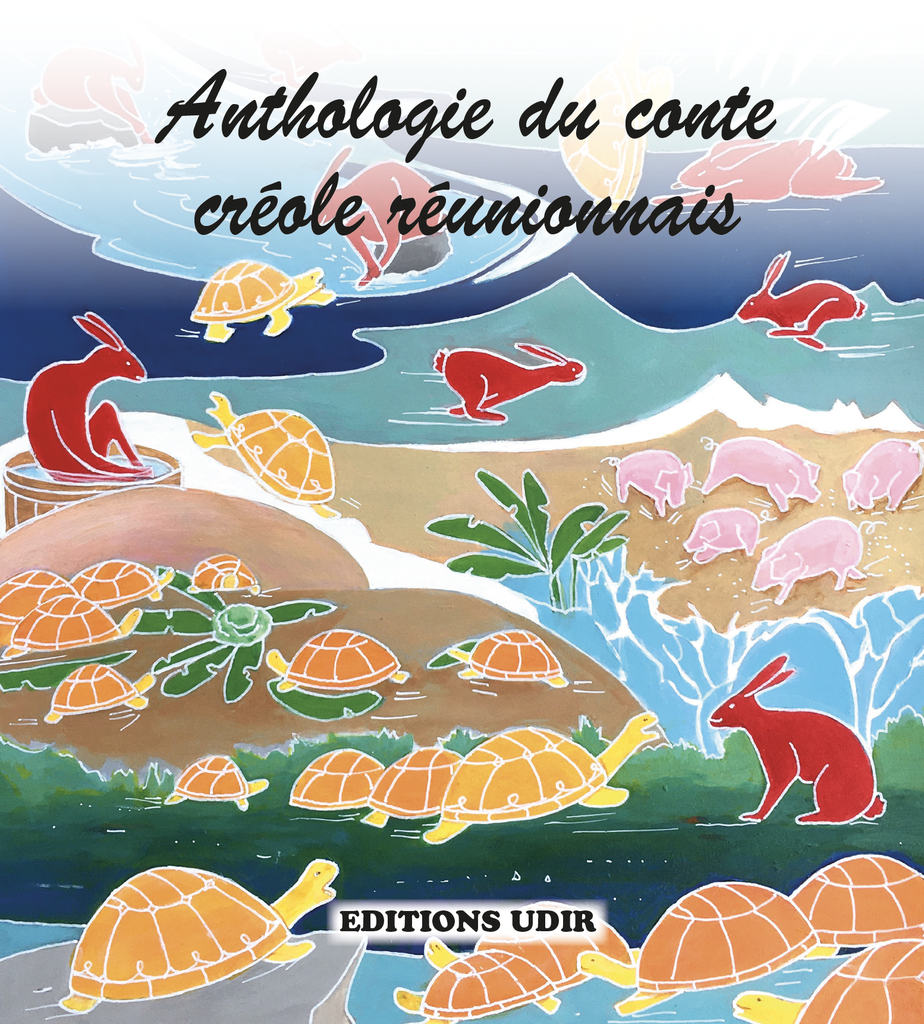
Anthologie du conte créole réunionnais
Editeur : UDIR
Auteur : Laetitia Samlong-Ah Kiem
ISBN : 978-2-87863-084-8
| Mis en ligne par | Lectivia |
|---|---|
| Dernière mise à jour | 11/10/2024 |
| Lecteur(s) | 4 |
Partager ce cours
Partager le lien
Partager sur les réseaux sociaux
Partager par email
Veuillez s'inscrire afin de partager ce Anthologie du conte créole réunionnais par email.
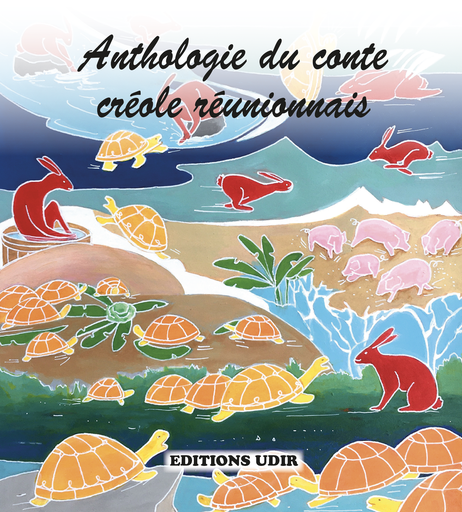
Le roi la ramasse son pèpe, batte tambour. Dann son commine na point n l’eau ! Alors toute le pèpe la rivé. Le roi i demande quiça sar capable monte là haut la case bondié, demande in pé d l’eau, parce le pèpe lé po mourir d’soif. Çoval i réponde :
— Mon roi m’allé.
Çoval i monte, i arrive là haut.
— Bonzour bondié.
— Bonzour mon enfant.
— Le roi la envoye amoin ec ou, ala son pèpe lé po mourir d’soif, quoçaq i fallé faire po gaingne in ti pé d l’eau po son pèpe ?
— Mon enfant, descende pli vite possibe, di ec le roi coupe kalandiak.
— Oui bondié merci.
— Mon enfant kalandiak, hin !
— Oui bondié kalandiak.
Li descende kalandiak diak kalandi ak diak.
Li trouve in ti carreau la paille fataque bien vert. Li rente dedans, li manze plein vente. Li arrive dann cemin po li descende.
— Mais quoça bondié la di amoin ? Ala mi conné pi quoça la, bondié la di amoin ! Ma calkile in coup. Ah tamaka ! tamaka ! tamaka !
Li arrive devant palais le roi.
— Ou la réissi mon enfant ?
— Oui mon roi.
— Quoça bondié la di ?
— La di aou coupe tamaka. La di solment passe in coté tension courant n l’eau va entrène le coupèr.
Si l bord l puis nana in pied tamaka.
Alors ce puis là, quand la fé fouille ça, la invite toute le moune, toute la vni, la donne la main. Liève la pas vouli vni, li. La di li boire l’eau dann ker fataque li, emmerde pas li ec le puis.
Là astèr, le roi i di :
— Bin veille ali bien.
I sava, i coupe tamaka. Quand i coupe tamaka-là, i di porte entention hin, passe in coté. Liève en l’air dans zacassi, guette bien.
Point n l’eau ! Le roi i di :
— Çoval, bondié la zoué ec ou mon enfant. La pas coulé ! vaut pas la peine. Na mourir d faim.
Bèf i di :
— M’allé, ma oir, sémanqué la oublié.
La fille le roi i di :
— Mon père, lé vrai, sémanqué li la oublié. Bèf i di li v’allé, laisse ali allé.
Bèf i sava. Monte lancé. Li di li va gaingné, le roi va estime ali. Li arrive là bas.
— Bonzour bondié.
— Bonzour mon enfant. Bin quoça ou la ni fé mon enfant ?
— Le roi la envoye amoin mande aou, son pèpe lé po mourir, quoçaq i fallé faire po gaingne in ti pé d l’eau parce li la point.
— Bin l’autrozour moin la di l’enfant, di le roi coupe kalandiak mais solment porte entention : si lbord là, nana in pied là, di ali coupe ça. La pas le carreau par en bas ! Passe in coté. Va sorte in courant n l’eau, va tombe dans le puis, va rempli le puis.
— Oui bondié, merci.
I descende. Content li. Gaillard : Ah moin la gaingné moin la gagné !
Quand i arrive par en bas. Kalandiak, diak, kalandiak (lé bon ! ) kalandiak diak !
Talère mon frère ! avec peine i arrète in kilomète po li arrive avec lo roi, trouve in ti carreau canne ça lé bien vert… rente dedans, vidé le canne ! son vente raide.
— Quouq moin la fé mon frar ! Bin ala moin la oublié quoçaq la di. Ah la di tamaka minme !
Bourré ! Tamaka tamaka tamaka ! Li arrive devant le roi :
— Mon roi moin la gaingné !
La fille i di : Ah mon père quoça moin la di aou, moin la pas di aou Bèf va gaingné ?
Le roi i di : Na oir quand va coupé.
Ali devant, li amène, li, contentement !
— Passe in coté !
Point n l'eau !
Le roi fou ali in tape dann zoreille. Li baisse in coté.
La fille le kèr lé tende la di : Mon père frappe pas !
Le roi na son verzer là. Tortie lé plein là-dans. Na in tortie i di :
— Mon roi, mon roi.
— Quoué ?
— Mi di aou laisse m’allé.
— Allé ? Oùq ti sava ?
— M’allé cerce de l’eau moin.
— Guette amoin, foute le camp dann verzer là, hin ! Gratte ton boyo là-bas, hin ! Gros gros zhomme la parti la pas gaingne de l’eau, toué v’allé !
La fille ec son kèr tende i di ali :
— Mon père po fini ec li, laisse ali allé.
— Vien ici foute le camp.
— Mi sava moin, mon roi !
La fé in mois ! In mois !
Kokolok kokolok kokolok kokolok li monte même, kokolok.
Li manze pas goyave, li manze pa arien li. Contentement. Pauve diab, quand li va descende li va manzé. Solment li lavé bon l’esprit. Kokolok ! In mois ! Bande là en bas i di, mi di pas toué, ça la parti crevé. Compte pi si li, là.
In moment doné, li la rive là haut.
— Bondié !
— Quoça Tortie ?
— Le roi la envoye amoin mande aou in ti pé d l’eau parce son pèpe lé po mourir. In pitié d oir !
Bondié i di :
— Mon enfant, ala ou troisième i vien oir nous po d l’eau. Allé en bas di « mon roi coupe kalandiak », li va gaingne d l’eau.
— Merci mon dié, mi sava.
I conné li amise, i compte pi si li. Li desende, kotok kotok kotok kotok. Li arrive par en bas, li oi inn ti pied’ goyave rose en fé. Saute si l pied goyave, manze plein vente. Et li lavé bon l’esprit, li. Li po manze goyave là, li perde pas l mot. Mnang mnang… tiak diak. Li nam’i trangue ali, akakganagak kalnag iak diak.
Son vente té fini plein, li la pas blié.
Arrive dann cemin, dresse ali bien, lisse bien son bouce : ma guetté çaq bondié la di amoin si mi trouve va. Kalandiak dia diak kalandiak diak.
Ça son refrain, ça !
In mois ! Talère lavé in mois et dmi !
Boum !
La fille té po guetté i di :
— Mon père ala Tortie. Tortie.
— Mi croi ou té fini crévé, Tortie !
— Mon roi, ala moin là, ou la gaingne l’eau zordi, à flot…
— Quoça la di aou Tortie ?
— La di aou coupe kalandiak.
Le roi i di :
— Bin ala troisieme !
— La pas d troisieme, moin q i cause ec ou, Tortie i cause ec ou !
Le roi i vé pas allé.
— Mon roi pisq mi di aou, amoin Tortie mi sa gaingne d l’eau.
Le roi i di :
— Allé, trape la hace.
I sava.
Bande là po coupe debois, li passe in coté comme ça.
— Kolok kolok, sorte azot arkile, d l’eau i sa coulé là, arkile !
Le roi là bas race son cévé, paré po bite ec li. Foute in coup d hace, fou à terre in kalandiak.
De l’eau, fouar !
— Merci Tortie (i di pas merci bondié là !), merci Tortie, merci Tortie !
Tortie i fé comme ça, i di :
— Oui ou lavé confiance gros gros zhomme là, amoin ou la vouli caloté. Ou la gaingne de l’eau. Encore la pencor fini. Liève po veille anous en l’air là, talère po boire de l’eau.
Le roi i réponde :
— Naura gardien po li.
Fini viré tourné, ramasse tortie, mette dann sofa. Tout cq lé pli meillère i donne Tortie.
Et li, Liève là, li vien fé in ti visite l’allée le roi. Li oi Tortie dann sofa. Li lé zalou li là : ma trape atoué talère !

- Fin du chapitre -

Tous les contenus du site internet de Lectivia sont protégés par la loi sur les droits d'auteur. L'utilisation, le partage ou la reproduction de toute partie du contenu sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur ou des ayants droits ou de Lectivia sera punis par la loi en vertu des règlements sur la violation du droits d'auteur et la propriété intellectuelle.
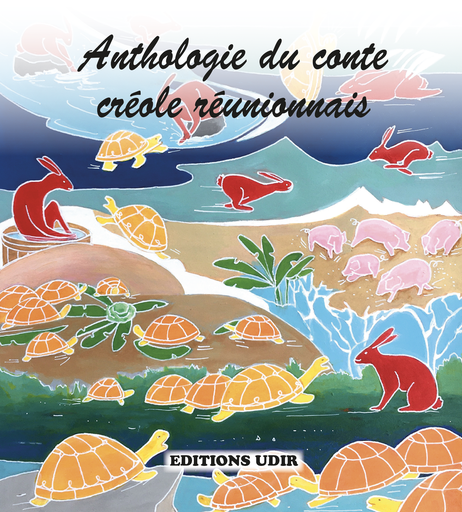
Le roi la réini toute, la di in prédication :
— Celisq la vni donne la main fouille le puis, naura d l’eau, çaq la pas ni donne la main (po Liève ça) i gaingne arpas d l’eau.
Liève en l’air :
— Moin la pas besoin d l’eau moin, mi boire la rosée.
Tortie i di :
— Le roi, ça i faut oui mette in gardien, parce de l’eau i pé sali.
— Oui, quiçaq i voudar allé faire in zardinaze dann bassin n l’eau bien prope ?
Bèf i réponde :
— Amoin lé capabe ça.
— Parce q là-bas i pé avoir malfaisant, i faut in homme fort.
— Mon roi, moin na dé lé sec, quat i pile, ène lé fou ! çaq i arrive mi donne paquet !
Le roi i di :
— Tout dbon ?
— Oui, guette ça mon dé bois sec là, si la manqué moin na quate i pile mi fou in coup derrière.
— Bin allé mounoir.
Li sava. Li arrive, i guette de l’eau bien prope. Et si lbord bassin navé in zoli ti roce plate, alors quand le roi ec son princesse, toute i visite de l’eau, i mette le pied si l ti roce bien prope là.
Bèf i dor là-minme.
Et Liève en l’air là-bas dann son carreau piquant, li veille. Li soif, li soif minme, rode qui manière li va fé po li boire boire d l’eau. Li sa partout dans le bois, trouve mouce à miel, li passe avec bombarde, tire demiel, li rempli son m ti calebasse. Li arrive en l’air. Bèf là là-minme. Li descende in ti pé si lbord :
— Ho compère béf !
— Quoué ?
— Demiel !
— Hin, mi boire pas.
— Si oui goute ça là, oua ni fou.
Bèf i di non, li boire pas. Bèf i conné i empèce ali ni là.
— Compère à cause ou lé bête comme ça ? Moin la pas besoin ot l’eau là, guette là, la rosée i brille po noye amoin, là. Mi vé donne atoué in pé d miel. Astère mon miel toué pencor vi.
— Oquilé ton miel ?
— Spère ma monte atoué.
Liève i descende ec son m ti calebasse :
« Ting ting ting mon miel là lé doux.
Ting ting ting mon miel là lé doux »
Mais li descende là, son né la corde avec li dans son rein par derrière. Li conné i sa amarre Bèf. Li arrive dann fond. Bèf i fé comme ça :
— Hrrin !
Li trempe son doigt dans son calebasse :
— Si ti goute ça là, Bèf !...
Bèf quoça i di :
— Donne vitement.
Passe son doigt dans la calebasse, fou si la langue Bèf. Bèf comme ça :
— Rrang rang compère donne encore in pé.
Li plombe Bèf bien comme ça :
— Guette amoin compère, plaisante pas, mi aime aou, ça ot quate i pile derrière ec ot dé bois sec, ça moin la père ça, oui ! Coute bien, vaudé mié mi amarre aou, allonze atoué, après ma vide dans ton bouce.
Li arprend in ti pé d miel, li baise dans la guèle Bèf. Bèf fou la langue comme ça, encore in pé i trape ali.
— Non trape pas moin, ti oi, laisse m’amarre aou, pengar oua blesse amoin.
Bèf i vien sembe li, i di :
— Amarre !
Li dave ! Amarré à bloc !
Bèf i di :
— Donne demiel.
— Ça mon miel là, ça le cien i gaingne pas.
Fine bien amarré, Bèf i bouze pas. Li saute si l ti roce :
— Ho compère Bèf.
Bèf :
— RRRHIN !
— Mi boire de l’eau, ton roi li boire pas. L’eau mi boire mi baingne !
Li boire, li baingne. Li déranze le ti roce.
Compère Bèf :
— Tention ta fé gaingne amoin malhère.
— Malhère rienq po ou !
Li pique en l’air dann zacassi.
Bèf à terre là, grand soleil po tape ali…
Le roi i guette in coup : point n Bèf ! Li di quatre hère po Bèf po li rentré, po in aute allé, lé pencore arrivé, faut allé oir.
Çoval i di :
— M’allé.
Patacouf patacouf patacouf… Li en l’air là-bas, li guette : ala in aute i vien !
Bèf i entend çoval i vien. Li souplaingne.
— Hin hin hin hin.
— Quoué ? Quiça l’amarre atoué ?
— Au moin quate mille soldat la ni là, quate mille soldat l’amarre moin (li la honte).
— Soldat ?
— Oui compère.
Çoval i di :
— Compère ou nana dé lé sec, ène lé fou, quate i pile, moin nana rienq dé main i pile derrière, mi fou in coup mi tié dix mille…
Fine largue Bèf, i descende :
— Mon roi, oui conné moin lé fort, premier coup la ni cinquante soldat, la demande amoin n l’eau, moin la pas vouli donné, la ni encore dé cent ec revolver sou mon nez, moin la pas vouli, la pèse amoin à terre, l’amarre amoin à terre, bin mi gardien pi…
Çoval i armonte, poutoupouf, i arrive, Coval i place ali bien. Ali, Liève en l’air :
— Oté compère.
Çoval i di ali :
— Ho !
— Bin comélà bande fort comme zot, zot i laisse bande soldat tape marmaille comme ça ?
— Bin moin lé là, moin la ni zordi !
— Tention na plein soldat ici… Compère Coval mi vé prende in ti çomin po atraverse par l’aute bord, oua laisse amoin ?
— Ah ici i plaisante pas, i passe pas là, hin !
— Oui sava in pé trop vite compère Coval, i va trop vite mi di aou, in ti çomin mi demande aou là, oui laisse pas moin passé, mi donne pas ou mon miel, hin !
— Quel miel ?
— Miel couti.
— Ah si d miel couti amène.
— Liève i di : ala mon affaire ! Liève i descende: ting !
— Quoça i sonne comme ça ?
— Mon miel ! Ting ting mon miel là lé doux.
— Donne in pé don, compère.
— Rouve ot bouce.
Gros lève Coval i fé comme ça, li la porte ça zisse dessi.
— Sorte là, compère ou nana mauvais langue comme ça ?
— Compère Liève, mauvais langue ça couyonnade, ça malhère !
— Compère, ma donne aou toute calebasse, solment m’amarre aou. Allonze aou.
Çoval pouf ! lève son dé pied, Liève ençaine son dé pied, ençaine son dé pied dvant, fou in corde zouk dann collet, réini toute avec comme i amarre coçon la çaine. Quand té fine bien amarré, li guette Coval, li lé assiré.
— Demiel oui vé, de l’eau oui donne pas !
Çoval :
— Hi hi hi hi ! hi hi hi hi ! largue amoin, dèfe amoin après ma donne atoué in ti pé d l’eau.
— Amoin dèfe atoué ? Ma monte atoué comment mi fé, oui pé allé di le roi !
Rentré dann bassin, baingné, fane in ti pé la plime si le roce, po li fé oir.
— Quand zot va rivé po défe atoué di amoin ça !
Piqué en l’air dann zacassi…
L’hère i arrive. I guette Coval, ebin i descende pas. I di allé guetté. Bèf minme i monte.
— Compère comme ça minme moin lété pris, i faut pas di quiça l’amarre atoué comme ça.
— Non mi dire arpas.
I descende zot, i arrive en bas.
— Mon roi, dé cent mille soldat, lété impossible défende azot…
Tortie i vien kolok kolok kolok :
— Amoin i sa gardien de l’eau.
Le roi i di ali :
— Toué lé fou, foulcan là-bas.
— Mon roi mi di aou laisse m’allé, de l’eau moin la parti cercé. Alors tout ça gardien i envoye la pas capabe gardien, moin lé capabe gardien.
Le roi i di :
— Trape in çabouc, fou ça dann verzé.
— Mi di aou laisse m’allé.
Et la princesse kèr tende i di :
— Mon père laisse ali allé.
Po fini li acoute son fille.
— Mon roi mi sava, donne amoin in caisse la colle zoizeau. Ma amène çaq la amarre bèf là moin, bande soldat ma amène ali.
I sava là-bas, i çauffe la colle bien çaud, barbotte si son dos, si son l’écaille.
La fé huit zour avant li arrive bord d bassin l’eau. Tortie la place ali ti roce là, la tire le roce la zeté, l’arpasse sa place.
Lève i descende.
— Ah moin la fé sié toute couyon zordi. Na point ène po gardien n l’eau. Ah guette ti roce là, guette in pé comment lé verni. Mon ti roce lé véni zordi. Là lé gaillard.
Li sauté si lti roce. Tortie i bouze.
— Quoué ti roce, ti bouze ? Zot la décale mon roce, là !
Tortie i bouze po fé prend la colle. A mesire q i bouze, la colle i colle ali minme.
— Ah zot la mette inn ti roce comme ça, lé bien zoli mais lé en couillon.
In moment donné li la compris.
Tortie i passe son ti tête sous son l’écaille, i guette ali en l’air.
— Liève zordi ou lé pris liève.
— Moin lé pris, ti largue pas moin, ma fou atoué un coup d poing ta oir.
Tortie :
— Envoye aou.
Passe in poing, son poing lé pris, li arpasse l’aute, l’aute lé pris.
— Çaq lé plis mauvais mi fou in coup d dent ta oir.
Li fou in coup d dent, baisé si la colle.
Tortie :
— Oua lé avec le roi, longtemps li attende aou.
Collé ec li. Amène ali en descendant si le dos.
Tortie kolok kolok
Le roi i mazine pi. Bassin nl’eau l’abandonné.
La fille le roi lé dans l’allée, i di :
— Mon père ala Tortie i vien. Na ène si son dos li porte. Tortie la trape in volère, lé si li, lé si son dos. Quoça moin la di azot.
Tortie :
— Mon roi ala li là, allé cerce Coval ek Bèf, ali minme l’amarre Coval ek Bèf, oua oir si di pas ou oui.
Le roi mèce bande là :
— Zot la poin la honte, in ti créole comme ça i amarre azot, zot i di soldat.
La estime Tortie.
— Trape amoin Liève amène ici, faut tié ali.
Tire liève si le dos Tortie.
Liève i di :
— Mon roi, ou na q à trape amoin par mon dé ti patte. Mon la vie lé courte. Batte à terre. Moin sar fini par là. Vot çance va resté.
La fille le kèr lé tende :
— Oui mon père, in vrai ti zène homme. Son vie lé courte, batte ali à terre.
Le roi i trape ali par son dé ti patte :
Ban !
— Merci mon roi.
Parti ! Li arrive en l’air :
— A moin là ici !
Le roi i di :
— Oui oi ti saleté là, ou !

- Fin du chapitre -

Tous les contenus du site internet de Lectivia sont protégés par la loi sur les droits d'auteur. L'utilisation, le partage ou la reproduction de toute partie du contenu sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur ou des ayants droits ou de Lectivia sera punis par la loi en vertu des règlements sur la violation du droits d'auteur et la propriété intellectuelle.
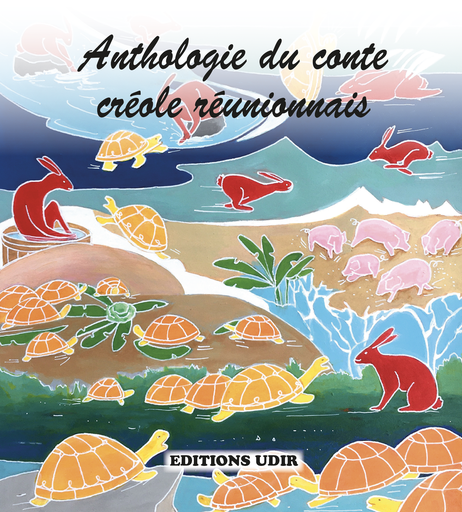
L’anthologie du conte créole réunionnais ouvre à ces imaginaires insoupçonnés où le langage tient le réel à distance, tout au moins le langage éloigne le réel de ce qu’on nomme un ailleurs du sens. Ce qui s’avère alors le réel, c’est le fantastique, le merveilleux, l’impensable qui n’exclut pas une certaine violence dans les mots et les événements quand il s’agit de contes. Cette violence pourrait choquer les lecteurs, même si elle n’est pas le seul fait du conte, elle est présente aussi dans la poésie et le roman réunionnais, autour de la thématique de l’esclavage et du marronnage, de la misère et de l’exil en métropole.
Aujourd’hui, nous aurions tendance à stigmatiser cette violence.
Cependant, dans Psychanalyse des contes de fées, Bruno Bettelheim présente à juste titre les contes comme un héritage culturel. Il affirme deux choses importantes : « La vie réelle n’est pas que soleil », et la violence, l’enchantement, le dualisme, le dilemme œdipien, le mensonge, la méchanceté, l’angoisse de séparation, la trahison, « tout en divertissant l’enfant, l’éclaire sur lui-même et favorise le développement de sa personnalité. » À présent que le conte fait partie du patrimoine immatériel de l’humanité, il ne viendrait à l’idée de personne de mettre en doute son utilité à servir de guide à l’enfant. C’est un fait acquis. Nos traditions orales nous offrent une richesse culturelle unique à partager avec le monde, d’où cette anthologie qui répond à un véritable besoin.
Initié par la Dac de La Réunion et réalisé par l’Udir, ce projet éditorial remet nos contes au goût du jour et participe à la revalorisation de la langue créole qui joue un rôle fondamental dans la construction de notre identité.
Traditionnellement le conte est mystère, même si le sens des textes change au fil du temps. Si la voix du lecteur ne s’entend pas, celle du conteur ou du rakontèr zistoir enchante l’oreille par la métamorphose du souffle. Donc, il appartient aux conteurs d’adapter chaque conte à la scène. De fait, nous avons reproduit les contes dans leur graphie d’origine, sans rien modifier non plus quant aux vocables et à la syntaxe, quitte à ce qu’on fasse un indispensable effort de lecture pour se les approprier. Une telle approche montre que la marche vers une graphie officielle de la langue créole réunionnaise s’inscrit dans le temps et ne peut être que le fruit d’une longue réflexion. Entre la graphie des contes anciens et les graphies proposées ensuite par Lékritir 77, KWZ ou Tangol, on remarquera des différences notables.
En 2003, Daniel Honoré propose une graphie phonologique pour lire le créole : un signe correspond à un son et tout signe se prononce (sauf le « e » muet à la fin de certains monosyllabes). Le souci de respecter les différences de prononciation selon les régions géographiques et les milieux socio-culturels l’a amené à adopter les propositions de la graphie Tangol ou 2001, mais en les simplifiant.
ä peut se lire a ou an : käne, kane ou kann
ë peut se lire é ou eu : sër, sér, seur
ï peut se lire i, u ou ui : plï, plu, plui
ö peut se lire o ou on : döne, done, donn
sh peut se lire s ou ch : soz, shoz
gn peut se lire gne ou ye : guingn, guingne, guinye
Pour une lisibilité plus grande, Daniel Honoré a choisi également de doubler le « s » final de certains monosyllabes ou d’ajouter un « e » muet. Exemples : « pass » au lieu de « pas » et « danse » au lieu de « dans ». Il a ajouté aussi un « e » muet à certains monosyllabes terminés par un « t » quand ce dernier est précédé d’une consonne. Exemple : « porte » au lieu de « port ». Ces précisions sont importantes, car si la langue créole est parlée par plus de 80 % de la population, seul un petit nombre de Réunionnais parvient à lire facilement la langue écrite. En effet, apprendre à lire le créole est une étape incontournable, car c’est une vraie langue qui possède déjà une riche littérature : fables, poèmes, contes, pièces de théâtre, romans, récits, nouvelles, livres pour la jeunesse.
Dans ma préface au livre d’Aude-Emmanuelle Hoareau, Concepts pour penser créole, j’ai écrit ceci : « Avec les tentatives d’aménagement et de standardisation d’une orthographe (Lékritir 77, 1983, 2000, etc.), voire d’une écriture normalisée en langue créole, les écrivains n’ont cessé d’écrire en créole ; les chanteurs n’ont cessé d’écrire et de chanter en créole ; les conteurs n’ont cessé de conter en créole ; les hommes de théâtre n’ont cessé d’écrire et de jouer des pièces en créole. Parce que la langue créole véhicule une pensée, une culture, une histoire, un avenir, depuis des dizaines d’années on l’étudie pour l’écrire, pour l’enseigner, pour publier des dictionnaires, des grammaires, des manuels scolaires – et pour en faire une langue à part entière. »
Si la littérature donne à la langue créole ses lettres de noblesse, les contes créoles traditionnels sont porteurs d’un univers qui n’a pas fini de nous enchanter, notamment avec ses valeurs ancestrales. Ils nous offrent aussi une prise de conscience, une esthétique, une nouvelle manière de penser créole, et que les idées progressent, et que l’homme avance avec le monde vers l’acceptation des différences, vers plus de lumière.
Jean-François SAMLONG
- Fin du chapitre -

Tous les contenus du site internet de Lectivia sont protégés par la loi sur les droits d'auteur. L'utilisation, le partage ou la reproduction de toute partie du contenu sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur ou des ayants droits ou de Lectivia sera punis par la loi en vertu des règlements sur la violation du droits d'auteur et la propriété intellectuelle.