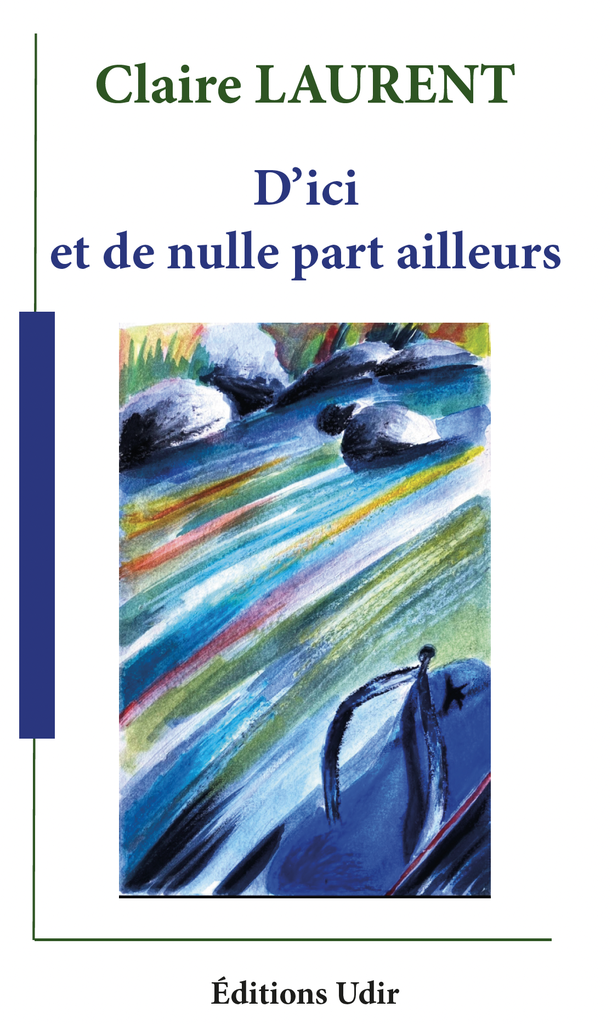
D'ici et de nulle part ailleurs
Editeur : UDIR
Auteur : Claire LAURENT
ISBN : 978-2-87863-104-3
Description :
Dans son livre D’ici et de nulle part ailleurs, Claire Laurent nous livre des histoires percutantes, tirées au cordeau, qui retracent les destins d’hommes, de femmes, d’enfants soumis aux affres de la vie. Un fil rouge relie ces histoires entre elles : La Réunion. En effet, l’île bouleverse et transforme la vie des personnages de ces douze nouvelles, comme elle a transformé la vie de l’auteure qui, dans un style réaliste et épuré, nous questionne sur l’absurdité, le tragique, les raisons de l’existence.
Laetitia Samlong Ah-Kiem
| Mis en ligne par | Lectivia |
|---|---|
| Dernière mise à jour | 09/12/2024 |
| Lecteur(s) | 1 |
Partager ce cours
Partager le lien
Partager sur les réseaux sociaux
Partager par email
Veuillez s'inscrire afin de partager ce D'ici et de nulle part ailleurs par email.

Chapitre 12 : La fille au bertèl
Les fêtes de Noël approchaient.
À la sortie d’un virage, debout devant un muret de pierre, une fille faisait du stop en fumant une cigarette. Quand je me suis garée le long du chemin herbeux, elle a lancé son mégot dans le caniveau en jetant un coup d’œil à la maison voisine aux volets clos. Personne d’autre à l’horizon que cette auto-stoppeuse en rade, entre le Tévelave et Les Avirons, un samedi après-midi.
Moi, je revenais d’une promenade dans la forêt. J’ai descendu la vitre, côté passager. L’air chaud s’est engouffré dans la voiture. La fille s’est approchée. Seize ou dix-sept ans, pas plus.
— Bonjour, je peux monter ?
D’emblée, le paille-en-queue tatoué sur son bras gauche m’a rendu le personnage sympathique, même si je n’apprécie guère les tatouages. Marquer sa peau à vie d’un oiseau si élégant, c’est le signe d’un esprit tout en finesse, ai-je pensé.
— Oui, oui. Où allez-vous ?
— Je descends sur Saint-Leu.
— Vous pouvez mettre votre sac à l’arrière, il y a de la place.
Ses cheveux roux, bouclés, encadraient un visage qui semblait n’avoir jamais vu le soleil. Sur ses épaules, les pans d’un bertèl s’écartaient comme s’ils retenaient un objet trop volumineux. D’habitude, les jeunes que je prenais en stop se baladaient plutôt avec un sac à dos. Elle a posé le bertèl sur la banquette arrière avant de s’installer à côté de moi. Une odeur de nature a envahi l’habitacle, une odeur des Hauts, à la fois fraîche et âcre, un mélange de géranium, de feuilles séchées et de viandes boucanées.
J’ai redémarré.
Les effluves aigres des mangues tombées dans le fossé flottaient dans l’air tiède. Un peu plus loin, à l’arrêt de bus, trois chiens efflanqués se disputaient une carcasse de poulet couverte de mouches. Je n’ai pu m’empêcher de chercher du regard le sachet en plastique qui sert à transporter les offrandes déposées à l’issue d’une cérémonie tamoule. À la croisée de deux voies bitumées, j’ai contourné des restes de safran, de fleurs, de morceaux de noix de coco délaissés par les chiens. « La malédiction peut toucher celui qui roule dessus », aimait à dire ma grand-mère. Malgré mes efforts, la malédiction avait frappé six mois plus tôt. Et grand-mère s’en était allée vers, peut-être, une autre vie.
— Il y en a partout.
— Quoi ? Des restes d’offrandes ? ai-je demandé.
— Non, des chiens errants. Des hordes de chiens errants. Mon frère en a trouvé un qui avait été battu à mort et jeté dans un sentier comme un détritus, les pattes cassées, les oreilles découpées, la queue arrachée. Il l’a emmené chez le vétérinaire, mais c’était trop tard.
J’ai eu envie de vomir.
Sur le bord de la route, des flamboyants coloraient ciel et terre de leurs pétales écarlates. J’ai essayé de remplacer l’image du chien torturé par celle des fleurs rouges. Pratiquer la pensée positive, c’était à la mode et bon pour le karma, mais la couleur me ramenait au sang qui avait dû gicler des blessures de l’animal.
— Vous habitez au Tévelave ?
Elle n’a pas répondu. Par la vitre ouverte, elle regardait défiler les tamariniers tandis que sa main droite tapotait le rebord de l’accoudoir.
— Vous attendiez depuis longtemps ?
— Non, je n’attends jamais bien longtemps.
— Vous faites souvent du stop ?
Pas de réponse. Elle a fait craquer les jointures de ses doigts. Ce bruit désagréable m’a rappelé ma fille. Le mois prochain, Lola aurait eu seize ans si j’étais allée la chercher à Cilaos pendant les vacances de mai, au lieu de la laisser rentrer de randonnée en stop. Lola faisait toujours craquer ses articulations avant de jouer du piano. Elle n’aurait jamais seize ans. Ne ferait plus d’auto-stop. Le couvercle du piano avait été refermé.
Pour l’éternité.
Amen.
Le piano avait été mis en vente.
En octobre, Lola aurait dû danser à Saint-Louis pour le Dipavali, la fête de la lumière. Désormais, des fleurs de frangipaniers voletaient sur sa tombe au cimetière de Saint-Leu où je me rendais les samedis en me demandant : « À quoi bon ? »
Si j’avais su…
Ma passagère a cherché quelque chose dans les poches de son jean. Quelque chose qu’elle n’a pas trouvé. Dépitée, elle a secoué la tête. Puis elle a déplié le pare-soleil et s’est observée quelques secondes dans le petit miroir, avant de relever le battant en plastique et de se retourner pour surveiller son sac.
À ce moment-là, j’ai réalisé que je n’avais jamais vu une fille avec un bertèl sur le dos. Ce genre de sac en vacoas tressé, c’était les coupeurs de canne à sucre qui le portaient pour y ranger leur sabre. Qu’est-ce qui faisait saillir les pans du bertèl ? Des vêtements roulés en boule ? Un duvet ? Des fruits ?
— Comment vous appelez-vous ?
— Audrey.
— C’est joli, Audrey.
— Vous, vous êtes la mère de Lola.
— Comment le savez-vous ?
— J’ai vu des photos de vous sur Insta.
— Insta, c’est Instagram ?
— Ben oui. Des femmes métisses malbar, ça ne court pas les rues au Tévelave.
Sa réflexion sur la couleur de ma peau m’a interloquée. Oui, j’avais une mère malbar et un père à la peau blanche. En quoi cela la dérangeait-il ?
Arrivé à La Réunion en 1968, comme Volontaire de l’Aide Technique (VAT), mon père avait rencontré ma mère, alors infirmière à l’hôpital de Saint-Pierre. La naissance de deux enfants avait transformé le service civil de mon père en installation définitive. Créolisé, réunionnisé, malbarisé, et fier de l’être. Mon père était heureux. Et nous avec.
Je mangeais du bœuf aussi, si la demoiselle assise à côté de moi voulait le savoir. Lola, elle, était végétarienne. Elle me reprochait de me nourrir de cadavres. Elle prétendait que les enfants de sa génération finiraient tous par ne plus tuer les animaux. Elle comparait le poulet ou le poisson dans mon assiette à notre chien, qui répondait au nom de Massalé.
— Ça ne te viendrait pas à l’idée de manger Massalé, quand même ?
Non, je ne mangerais pas Massalé, mais j’aimais bien le poisson. Comme les ados de son âge, ma fille passait des heures sur son téléphone, à poster je ne sais trop quoi à je ne sais trop qui.
— Vous faites ça, vous aussi ?
— Faire quoi ?
— Afficher des photos de vos parents sur votre profil ?
— Alors, d’abord, les photos, c’est pas sur le profil, c’est dans le fil d’actualité. Ensuite, Lola ne postait pas de photos de son père, juste de vous.
C’est sûr que les relations entre Lola et son père n’étaient pas au beau fixe. Aux yeux de Lola, il passait trop de temps à régler les problèmes des jeunes qu’il recevait à son cabinet de psy, sans être capable de trouver de solution aux dilemmes autrement plus importants de sa fille unique.
« Elle me fatigue avec ses histoires de droits et de liberté », me confiait-il certains soirs.
« Il ne prend jamais le temps de m’écouter », se plaignait-elle.
— Vous êtes une amie de Lola ?
— J’étais.
— Oui, bien sûr, maintenant qu’elle n’est plus là…
— On n’était plus amies de toute façon.
Le ton sec d’Audrey m’a fait hésiter à mener l’investigation plus avant, bien que sa dernière remarque semble destinée à aiguiser ma curiosité. Elle m’était soudain moins sympathique. J’ai ralenti. Il était à peine quinze heures. J’avais du temps devant moi. Le tapotement sur l’accoudoir s’est interrompu. Elle a de nouveau tâté les poches de son pantalon.
— Vous avez du feu ?
— On ne fume pas dans la voiture, désolée.
Elle a soupiré, a recommencé à tapoter sur l’accoudoir avant d’ajouter :
— Vous ne fumez pas ?
— Non.
— Lola fumait. Et pas que des cigarettes.
— Pardon ?
— Vous avez très bien entendu.
— Qu’est-ce que vous insinuez ?
— J’insinue rien du tout, c’est la vérité. Ça vous choque ?
— Ça devrait ?
— Mon frère lui vendait du zamal. Elle passait le voir le mercredi, après son cours de piano chez madame Rivière. On habite juste à côté de la prof de musique, pas loin de la boutique de Piton Vert, derrière la boulangerie Payet. Elle garait son scooter bien en évidence, le long de la clôture mitoyenne.
La voiture a fait une embardée. Cette fille me provoquait sans que je comprenne la raison de son animosité. Après tout, c’était grâce à moi qu’elle n’était plus en train de poireauter sur le bord de la route. Est-ce qu’elle en voulait à ma fille ? Et si elle n’était pas montée dans ma voiture par hasard ?
Le soleil trônait dans un ciel d’azur, aveuglant. J’ai abaissé le pare-soleil. Une photo de Lola était scotchée sur le plastique noir. Ma fille sur la plage de rochers de la Pointe au sel, en maillot de bain fluo et chapeau de paille, le jour de ses dix ans. En équilibre sur un énorme bloc, elle avait répété des mouvements de son spectacle de danse de fin d’année. J’ai cru entendre un gémissement ténu qui émanait du bertèl.
— Ce n’est pas un bébé que vous transportez, quand même ?
— Non, non. Je n’aime pas les bébés. Ils ne font que manger, dormir et pleurer.
— Ma fille aimait bien les bébés.
— Je sais. C’est comme ça qu’elle a piégé mon frère. Elle lui a fait croire qu’ils se marieraient et qu’ils auraient un bébé, mais tout ce qu’elle voulait, au fond, c’était qu’il continue à lui vendre du zamal.
Au carrefour, j’ai failli brûler le stop à l’entrée des Avirons. Les ceintures de sécurité se sont tendues d’un coup sec quand j’ai pilé. Les pneus de la Nissan ont crissé sur l’asphalte. J’ai repensé aux traces laissées par la Ford du gars qui avait pris ma fille en stop à Cilaos, six mois plus tôt. Deux longues traînées noires là où la végétation avait été arrachée, en bordure du ravin, avant que le véhicule ne bascule dans le vide.
Si j’avais su…
Si j’avais su, j’aurais annulé mon stage de yoga le dernier weekend de mai, et au lieu de raccompagner mes copines chez elles, je serais allée récupérer ma fille chérie au fin fond du cirque de Cilaos pour la ramener vivante à la maison.
Vivante.
Les images de son cercueil m’ont assaillie, envahissant tout l’espace de mon cerveau comme une vague de tsunami qui s’engouffre dans un bâtiment sans issue. Un cercueil en bois de tamarin, lisse, sans fioritures, couvert de fleurs, de photos, de messages colorés. Le cercueil et l’odeur d’encens brûlé le jour de ses funérailles, voilà ce qu’il me restait de ma fille.
Derrière moi, un camion a klaxonné. J’ai de nouveau atterri dans la réalité : les cours de piano au Tévelave, les bébés, un frère amoureux et du cannabis.
— Du zamal ? Vous racontez n’importe quoi. Jamais Lola n’aurait fumé un truc pareil. De toute façon, elle n’avait pas d’argent pour en acheter.
— Vous croyez vraiment ce que vous dites ?
— On va arrêter cette conversation qui dérape. Si vous n’aimiez pas Lola, c’est votre droit.
— Vous voulez savoir comment Lola s’est acheté son dernier iPhone ? Celui avec la coque jaune pâle et la vitre rayée. À moins que, là aussi, vous n’ayez rien vu…
Une bouffée d’angoisse me submergeait chaque fois que cette sauvageonne sortie de nulle part prononçait le prénom de ma fille.
— Lola n’avait pas d’iPhone, vous vous trompez.
— Mon frère était fou amoureux d’elle.
— Ça suffit maintenant.
— Les filles métisses, il dit que c’est son style, qu’elles ont un truc en plus.
C’est ce qu’avait dit mon mari quand je l’avais rencontré.
Audrey a continué :
— Lola débarquait à la maison une fois par semaine et mon frère lui donnait tout ce qu’elle voulait. Il a même réparé son scooter le jour où elle a glissé sur la route mouillée et qu’elle a cassé la béquille.
Je ne comprenais pas de quoi elle parlait, comme si la vie de ma fille défilait et que je l’observais de l’extérieur.
— Moi, mon scooter, il est en panne depuis un mois, mais il s’en fout. Elle l’a mené en bateau, du début à la fin. Elle ne l’aimait pas, ça se voyait, elle se servait de lui pour faire du fric.
— Comment ça ?
— Ben, le zamal, elle le revendait au lycée.
J’ai commencé à avoir mal au ventre. Mes boyaux se tordaient, réveillant une douleur bien connue depuis quelques mois. J’ai ouvert le vide-poche où je laissais le jeton pour le caddie du supermarché et j’ai attrapé un sachet de Gaviscon. J’en avais disséminé partout : dans la voiture, dans mes sacs à main, dans mon panier de plage. Mes doigts ont heurté un porte-clés aux motifs traditionnels aborigènes, souvenir d’Australie rapporté à Lola par ma mère, deux ans plus tôt. En même temps qu’une partie de moi était tentée d’en savoir plus sur la vie cachée de ma fille, une autre craignait que je ne puisse le supporter.
— Taisez-vous ou je vous dépose.
— Là ?
— Oui, là, tout de suite.
— J’me tairai pas. Vous allez faire quoi ? Me balancer par-dessus bord ?
— Par exemple.
— Le gars qui a raté son virage à Cilaos, il ne l’a pas prise en stop par hasard. Elle le connaissait. Elle projetait de partir avec lui.
— …
— Vous n’êtes pas au courant, non plus ? Elle rêvait d’aller en Inde, de voir le Taj Mahal et Bollywood. C’est pour ça qu’elle revendait du zamal.
Chaque phrase qu’elle prononçait était pire que la précédente et me déchirait le ventre comme un coup de couteau. Il fallait que cette folle se taise, qu’elle arrête de déverser sa rancœur, qu’elle ferme sa bouche infecte.
— Vous vous rendez compte des accusations que vous portez ?
La sale gamine avait une tache sur le menton, comme une trace de salive. Je me suis mise à essuyer mon propre menton.
C’était quoi cette histoire de zamal ? Lola était plus maligne que tous ces petits dealers occasionnels du lycée.
— Vous connaissiez le gars qui l’a embarquée à Cilaos ?
— Non, jamais vu, mais Lola en parlait beaucoup. Il était guide de montagne et moniteur de canyoning. C’est comme ça qu’elle l’a rencontré. Ils ont descendu en rappel les gorges de Fleurs Jaunes, vers Ilet à Cordes.
Je me suis souvenue d’une enveloppe mauve que Lola avait ouverte, le jour de son anniversaire. Mes beaux-parents nous avaient consultés, quelques semaines plus tôt, avec l’idée de lui offrir une expérience de canyoning pour ses quinze ans. Lola était sportive, elle adorait la nature et la montagne. L’idée était originale.
— Lola m’a montré des photos du guide. Elle les cachait dans le coffre de son scooter. Un grand gars au visage fin, d’une trentaine d’années, tout en muscles, avec un sourire à faire de la pub pour du dentifrice. Plus beau que tous les mecs du lycée. Et plus mûr aussi.
J’ai reconnu le discours de Lola sur ses copains de classe qui manquaient de maturité. « Ils ont seize ans et se comportent comme des bébés. »
— C’est avec lui qu’elle a commencé à fumer du zamal ? ai-je demandé.
— Non, c’est plutôt lui qui a commencé avec elle.
J’avais la sensation de ne rien comprendre, l’impression que nous ne parlions pas de la même personne. La Lola qu’elle décrivait ne ressemblait en rien à ma fille. Ma Lola, calme, sociable, enthousiaste n’était ni naïve ni inconsciente. Le lycée était à cinq minutes de la maison. Elle y allait à pied, rentrait à l’heure. Ses amies passaient la voir chez nous. De temps en temps, elles restaient dormir. Elles discutaient dans sa chambre, regardaient sur Internet des vidéos qui les faisaient rire ou des séries sur Netflix, et s’installaient dehors sur la terrasse pour manger des gâteaux et boire des sodas ou, parfois, une bière. Je n’avais jamais entendu parler d’Audrey. Encore moins de son frère qui réparait les scooters.
— Ce que vous me racontez, c’est ce qu’elle vous a dit ?
— Entre autres.
— C’est-à-dire ?
— Ce qu’elle m’a raconté… ce que mon frère m’a confié… ce que j’ai vu et entendu au lycée. J’ai croisé les informations, c’est tout.
De nouveau, j’ai cru percevoir un faible couinement ou une vibration à l’arrière.
— C’est quoi, ce bruit ?
— C’est rien, juste un truc dans mon sac.
— On dirait le gazouillis d’un bébé.
— Le quoi ?
— Le bruit que fait un bébé quand il joue à se mordiller les pieds dans son berceau. Ou un chiot. C’est ça ? Vous transportez un chiot ?
— Non.
— Un chaton ?
— Mon frère n’était plus le même depuis qu’il avait rencontré Lola.
— Je me fiche de votre frère.
— Lola, elle couchait avec tout le monde. Mon frère en était malade.
— Je ne crois pas un mot de ce que vous racontez, alors vous allez arrêter. Je vous déposerai à Saint-Leu et je ne veux plus jamais vous revoir.
— Il a fait une tentative de suicide. À cause d’elle, il a passé trois semaines à l’hôpital de Saint-Pierre, l’année dernière. Chez les cinglés. Avec les drogués et les alcooliques.
La voiture s’est arrêtée net. J’en suis descendue. J’ai fait le tour du véhicule par l’arrière. J’ai ouvert la portière, j’ai attrapé le bertèl et je l’ai balancé dans le fossé.
— Vous descendez.
— Qu’est-ce qui vous prend ?
— J’ai dit : vous descendez.
— Mais ça va pas ! Vous avez pété un câble ou quoi ?
— Vous dégagez. Et très vite.
Le contenu du sac s’était renversé sur l’herbe. Au milieu d’un énorme tas de feuilles séchées de zamal, un portefeuille orange et jaune, plein de billets, était tombé sur le côté, ainsi qu’un mobile Samsung bleu nuit dont la sonnerie s’était déclenchée, imitant le gazouillis d’un bébé.
Le portefeuille et le téléphone de ma fille.
On ne les avait pas retrouvés après l’accident.
- Fin du chapitre et du livre -

Tous les contenus du site internet de Lectivia sont protégés par la loi sur les droits d'auteur. L'utilisation, le partage ou la reproduction de toute partie du contenu sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur ou des ayants droits ou de Lectivia sera punis par la loi en vertu des règlements sur la violation du droits d'auteur et la propriété intellectuelle.

Les fêtes de Noël approchaient.
À la sortie d’un virage, debout devant un muret de pierre, une fille faisait du stop en fumant une cigarette. Quand je me suis garée le long du chemin herbeux, elle a lancé son mégot dans le caniveau en jetant un coup d’œil à la maison voisine aux volets clos. Personne d’autre à l’horizon que cette auto-stoppeuse en rade, entre le Tévelave et Les Avirons, un samedi après-midi.
Moi, je revenais d’une promenade dans la forêt. J’ai descendu la vitre, côté passager. L’air chaud s’est engouffré dans la voiture. La fille s’est approchée. Seize ou dix-sept ans, pas plus.
— Bonjour, je peux monter ?
D’emblée, le paille-en-queue tatoué sur son bras gauche m’a rendu le personnage sympathique, même si je n’apprécie guère les tatouages. Marquer sa peau à vie d’un oiseau si élégant, c’est le signe d’un esprit tout en finesse, ai-je pensé.
— Oui, oui. Où allez-vous ?
— Je descends sur Saint-Leu.
— Vous pouvez mettre votre sac à l’arrière, il y a de la place.
Ses cheveux roux, bouclés, encadraient un visage qui semblait n’avoir jamais vu le soleil. Sur ses épaules, les pans d’un bertèl s’écartaient comme s’ils retenaient un objet trop volumineux. D’habitude, les jeunes que je prenais en stop se baladaient plutôt avec un sac à dos. Elle a posé le bertèl sur la banquette arrière avant de s’installer à côté de moi. Une odeur de nature a envahi l’habitacle, une odeur des Hauts, à la fois fraîche et âcre, un mélange de géranium, de feuilles séchées et de viandes boucanées.
J’ai redémarré.
Les effluves aigres des mangues tombées dans le fossé flottaient dans l’air tiède. Un peu plus loin, à l’arrêt de bus, trois chiens efflanqués se disputaient une carcasse de poulet couverte de mouches. Je n’ai pu m’empêcher de chercher du regard le sachet en plastique qui sert à transporter les offrandes déposées à l’issue d’une cérémonie tamoule. À la croisée de deux voies bitumées, j’ai contourné des restes de safran, de fleurs, de morceaux de noix de coco délaissés par les chiens. « La malédiction peut toucher celui qui roule dessus », aimait à dire ma grand-mère. Malgré mes efforts, la malédiction avait frappé six mois plus tôt. Et grand-mère s’en était allée vers, peut-être, une autre vie.
— Il y en a partout.
— Quoi ? Des restes d’offrandes ? ai-je demandé.
— Non, des chiens errants. Des hordes de chiens errants. Mon frère en a trouvé un qui avait été battu à mort et jeté dans un sentier comme un détritus, les pattes cassées, les oreilles découpées, la queue arrachée. Il l’a emmené chez le vétérinaire, mais c’était trop tard.
J’ai eu envie de vomir.
Sur le bord de la route, des flamboyants coloraient ciel et terre de leurs pétales écarlates. J’ai essayé de remplacer l’image du chien torturé par celle des fleurs rouges. Pratiquer la pensée positive, c’était à la mode et bon pour le karma, mais la couleur me ramenait au sang qui avait dû gicler des blessures de l’animal.
— Vous habitez au Tévelave ?
Elle n’a pas répondu. Par la vitre ouverte, elle regardait défiler les tamariniers tandis que sa main droite tapotait le rebord de l’accoudoir.
— Vous attendiez depuis longtemps ?
— Non, je n’attends jamais bien longtemps.
— Vous faites souvent du stop ?
Pas de réponse. Elle a fait craquer les jointures de ses doigts. Ce bruit désagréable m’a rappelé ma fille. Le mois prochain, Lola aurait eu seize ans si j’étais allée la chercher à Cilaos pendant les vacances de mai, au lieu de la laisser rentrer de randonnée en stop. Lola faisait toujours craquer ses articulations avant de jouer du piano. Elle n’aurait jamais seize ans. Ne ferait plus d’auto-stop. Le couvercle du piano avait été refermé.
Pour l’éternité.
Amen.
Le piano avait été mis en vente.
En octobre, Lola aurait dû danser à Saint-Louis pour le Dipavali, la fête de la lumière. Désormais, des fleurs de frangipaniers voletaient sur sa tombe au cimetière de Saint-Leu où je me rendais les samedis en me demandant : « À quoi bon ? »
Si j’avais su…
Ma passagère a cherché quelque chose dans les poches de son jean. Quelque chose qu’elle n’a pas trouvé. Dépitée, elle a secoué la tête. Puis elle a déplié le pare-soleil et s’est observée quelques secondes dans le petit miroir, avant de relever le battant en plastique et de se retourner pour surveiller son sac.
À ce moment-là, j’ai réalisé que je n’avais jamais vu une fille avec un bertèl sur le dos. Ce genre de sac en vacoas tressé, c’était les coupeurs de canne à sucre qui le portaient pour y ranger leur sabre. Qu’est-ce qui faisait saillir les pans du bertèl ? Des vêtements roulés en boule ? Un duvet ? Des fruits ?
— Comment vous appelez-vous ?
— Audrey.
— C’est joli, Audrey.
— Vous, vous êtes la mère de Lola.
— Comment le savez-vous ?
— J’ai vu des photos de vous sur Insta.
— Insta, c’est Instagram ?
— Ben oui. Des femmes métisses malbar, ça ne court pas les rues au Tévelave.
Sa réflexion sur la couleur de ma peau m’a interloquée. Oui, j’avais une mère malbar et un père à la peau blanche. En quoi cela la dérangeait-il ?
Arrivé à La Réunion en 1968, comme Volontaire de l’Aide Technique (VAT), mon père avait rencontré ma mère, alors infirmière à l’hôpital de Saint-Pierre. La naissance de deux enfants avait transformé le service civil de mon père en installation définitive. Créolisé, réunionnisé, malbarisé, et fier de l’être. Mon père était heureux. Et nous avec.
Je mangeais du bœuf aussi, si la demoiselle assise à côté de moi voulait le savoir. Lola, elle, était végétarienne. Elle me reprochait de me nourrir de cadavres. Elle prétendait que les enfants de sa génération finiraient tous par ne plus tuer les animaux. Elle comparait le poulet ou le poisson dans mon assiette à notre chien, qui répondait au nom de Massalé.
— Ça ne te viendrait pas à l’idée de manger Massalé, quand même ?
Non, je ne mangerais pas Massalé, mais j’aimais bien le poisson. Comme les ados de son âge, ma fille passait des heures sur son téléphone, à poster je ne sais trop quoi à je ne sais trop qui.
— Vous faites ça, vous aussi ?
— Faire quoi ?
— Afficher des photos de vos parents sur votre profil ?
— Alors, d’abord, les photos, c’est pas sur le profil, c’est dans le fil d’actualité. Ensuite, Lola ne postait pas de photos de son père, juste de vous.
C’est sûr que les relations entre Lola et son père n’étaient pas au beau fixe. Aux yeux de Lola, il passait trop de temps à régler les problèmes des jeunes qu’il recevait à son cabinet de psy, sans être capable de trouver de solution aux dilemmes autrement plus importants de sa fille unique.
« Elle me fatigue avec ses histoires de droits et de liberté », me confiait-il certains soirs.
« Il ne prend jamais le temps de m’écouter », se plaignait-elle.
— Vous êtes une amie de Lola ?
— J’étais.
— Oui, bien sûr, maintenant qu’elle n’est plus là…
— On n’était plus amies de toute façon.
Le ton sec d’Audrey m’a fait hésiter à mener l’investigation plus avant, bien que sa dernière remarque semble destinée à aiguiser ma curiosité. Elle m’était soudain moins sympathique. J’ai ralenti. Il était à peine quinze heures. J’avais du temps devant moi. Le tapotement sur l’accoudoir s’est interrompu. Elle a de nouveau tâté les poches de son pantalon.
— Vous avez du feu ?
— On ne fume pas dans la voiture, désolée.
Elle a soupiré, a recommencé à tapoter sur l’accoudoir avant d’ajouter :
— Vous ne fumez pas ?
— Non.
— Lola fumait. Et pas que des cigarettes.
— Pardon ?
— Vous avez très bien entendu.
— Qu’est-ce que vous insinuez ?
— J’insinue rien du tout, c’est la vérité. Ça vous choque ?
— Ça devrait ?
— Mon frère lui vendait du zamal. Elle passait le voir le mercredi, après son cours de piano chez madame Rivière. On habite juste à côté de la prof de musique, pas loin de la boutique de Piton Vert, derrière la boulangerie Payet. Elle garait son scooter bien en évidence, le long de la clôture mitoyenne.
La voiture a fait une embardée. Cette fille me provoquait sans que je comprenne la raison de son animosité. Après tout, c’était grâce à moi qu’elle n’était plus en train de poireauter sur le bord de la route. Est-ce qu’elle en voulait à ma fille ? Et si elle n’était pas montée dans ma voiture par hasard ?
Le soleil trônait dans un ciel d’azur, aveuglant. J’ai abaissé le pare-soleil. Une photo de Lola était scotchée sur le plastique noir. Ma fille sur la plage de rochers de la Pointe au sel, en maillot de bain fluo et chapeau de paille, le jour de ses dix ans. En équilibre sur un énorme bloc, elle avait répété des mouvements de son spectacle de danse de fin d’année. J’ai cru entendre un gémissement ténu qui émanait du bertèl.
— Ce n’est pas un bébé que vous transportez, quand même ?
— Non, non. Je n’aime pas les bébés. Ils ne font que manger, dormir et pleurer.
— Ma fille aimait bien les bébés.
— Je sais. C’est comme ça qu’elle a piégé mon frère. Elle lui a fait croire qu’ils se marieraient et qu’ils auraient un bébé, mais tout ce qu’elle voulait, au fond, c’était qu’il continue à lui vendre du zamal.
Au carrefour, j’ai failli brûler le stop à l’entrée des Avirons. Les ceintures de sécurité se sont tendues d’un coup sec quand j’ai pilé. Les pneus de la Nissan ont crissé sur l’asphalte. J’ai repensé aux traces laissées par la Ford du gars qui avait pris ma fille en stop à Cilaos, six mois plus tôt. Deux longues traînées noires là où la végétation avait été arrachée, en bordure du ravin, avant que le véhicule ne bascule dans le vide.
Si j’avais su…
Si j’avais su, j’aurais annulé mon stage de yoga le dernier weekend de mai, et au lieu de raccompagner mes copines chez elles, je serais allée récupérer ma fille chérie au fin fond du cirque de Cilaos pour la ramener vivante à la maison.
Vivante.
Les images de son cercueil m’ont assaillie, envahissant tout l’espace de mon cerveau comme une vague de tsunami qui s’engouffre dans un bâtiment sans issue. Un cercueil en bois de tamarin, lisse, sans fioritures, couvert de fleurs, de photos, de messages colorés. Le cercueil et l’odeur d’encens brûlé le jour de ses funérailles, voilà ce qu’il me restait de ma fille.
Derrière moi, un camion a klaxonné. J’ai de nouveau atterri dans la réalité : les cours de piano au Tévelave, les bébés, un frère amoureux et du cannabis.
— Du zamal ? Vous racontez n’importe quoi. Jamais Lola n’aurait fumé un truc pareil. De toute façon, elle n’avait pas d’argent pour en acheter.
— Vous croyez vraiment ce que vous dites ?
— On va arrêter cette conversation qui dérape. Si vous n’aimiez pas Lola, c’est votre droit.
— Vous voulez savoir comment Lola s’est acheté son dernier iPhone ? Celui avec la coque jaune pâle et la vitre rayée. À moins que, là aussi, vous n’ayez rien vu…
Une bouffée d’angoisse me submergeait chaque fois que cette sauvageonne sortie de nulle part prononçait le prénom de ma fille.
— Lola n’avait pas d’iPhone, vous vous trompez.
— Mon frère était fou amoureux d’elle.
— Ça suffit maintenant.
— Les filles métisses, il dit que c’est son style, qu’elles ont un truc en plus.
C’est ce qu’avait dit mon mari quand je l’avais rencontré.
Audrey a continué :
— Lola débarquait à la maison une fois par semaine et mon frère lui donnait tout ce qu’elle voulait. Il a même réparé son scooter le jour où elle a glissé sur la route mouillée et qu’elle a cassé la béquille.
Je ne comprenais pas de quoi elle parlait, comme si la vie de ma fille défilait et que je l’observais de l’extérieur.
— Moi, mon scooter, il est en panne depuis un mois, mais il s’en fout. Elle l’a mené en bateau, du début à la fin. Elle ne l’aimait pas, ça se voyait, elle se servait de lui pour faire du fric.
— Comment ça ?
— Ben, le zamal, elle le revendait au lycée.
J’ai commencé à avoir mal au ventre. Mes boyaux se tordaient, réveillant une douleur bien connue depuis quelques mois. J’ai ouvert le vide-poche où je laissais le jeton pour le caddie du supermarché et j’ai attrapé un sachet de Gaviscon. J’en avais disséminé partout : dans la voiture, dans mes sacs à main, dans mon panier de plage. Mes doigts ont heurté un porte-clés aux motifs traditionnels aborigènes, souvenir d’Australie rapporté à Lola par ma mère, deux ans plus tôt. En même temps qu’une partie de moi était tentée d’en savoir plus sur la vie cachée de ma fille, une autre craignait que je ne puisse le supporter.
— Taisez-vous ou je vous dépose.
— Là ?
— Oui, là, tout de suite.
— J’me tairai pas. Vous allez faire quoi ? Me balancer par-dessus bord ?
— Par exemple.
— Le gars qui a raté son virage à Cilaos, il ne l’a pas prise en stop par hasard. Elle le connaissait. Elle projetait de partir avec lui.
— …
— Vous n’êtes pas au courant, non plus ? Elle rêvait d’aller en Inde, de voir le Taj Mahal et Bollywood. C’est pour ça qu’elle revendait du zamal.
Chaque phrase qu’elle prononçait était pire que la précédente et me déchirait le ventre comme un coup de couteau. Il fallait que cette folle se taise, qu’elle arrête de déverser sa rancœur, qu’elle ferme sa bouche infecte.
— Vous vous rendez compte des accusations que vous portez ?
La sale gamine avait une tache sur le menton, comme une trace de salive. Je me suis mise à essuyer mon propre menton.
C’était quoi cette histoire de zamal ? Lola était plus maligne que tous ces petits dealers occasionnels du lycée.
— Vous connaissiez le gars qui l’a embarquée à Cilaos ?
— Non, jamais vu, mais Lola en parlait beaucoup. Il était guide de montagne et moniteur de canyoning. C’est comme ça qu’elle l’a rencontré. Ils ont descendu en rappel les gorges de Fleurs Jaunes, vers Ilet à Cordes.
Je me suis souvenue d’une enveloppe mauve que Lola avait ouverte, le jour de son anniversaire. Mes beaux-parents nous avaient consultés, quelques semaines plus tôt, avec l’idée de lui offrir une expérience de canyoning pour ses quinze ans. Lola était sportive, elle adorait la nature et la montagne. L’idée était originale.
— Lola m’a montré des photos du guide. Elle les cachait dans le coffre de son scooter. Un grand gars au visage fin, d’une trentaine d’années, tout en muscles, avec un sourire à faire de la pub pour du dentifrice. Plus beau que tous les mecs du lycée. Et plus mûr aussi.
J’ai reconnu le discours de Lola sur ses copains de classe qui manquaient de maturité. « Ils ont seize ans et se comportent comme des bébés. »
— C’est avec lui qu’elle a commencé à fumer du zamal ? ai-je demandé.
— Non, c’est plutôt lui qui a commencé avec elle.
J’avais la sensation de ne rien comprendre, l’impression que nous ne parlions pas de la même personne. La Lola qu’elle décrivait ne ressemblait en rien à ma fille. Ma Lola, calme, sociable, enthousiaste n’était ni naïve ni inconsciente. Le lycée était à cinq minutes de la maison. Elle y allait à pied, rentrait à l’heure. Ses amies passaient la voir chez nous. De temps en temps, elles restaient dormir. Elles discutaient dans sa chambre, regardaient sur Internet des vidéos qui les faisaient rire ou des séries sur Netflix, et s’installaient dehors sur la terrasse pour manger des gâteaux et boire des sodas ou, parfois, une bière. Je n’avais jamais entendu parler d’Audrey. Encore moins de son frère qui réparait les scooters.
— Ce que vous me racontez, c’est ce qu’elle vous a dit ?
— Entre autres.
— C’est-à-dire ?
— Ce qu’elle m’a raconté… ce que mon frère m’a confié… ce que j’ai vu et entendu au lycée. J’ai croisé les informations, c’est tout.
De nouveau, j’ai cru percevoir un faible couinement ou une vibration à l’arrière.
— C’est quoi, ce bruit ?
— C’est rien, juste un truc dans mon sac.
— On dirait le gazouillis d’un bébé.
— Le quoi ?
— Le bruit que fait un bébé quand il joue à se mordiller les pieds dans son berceau. Ou un chiot. C’est ça ? Vous transportez un chiot ?
— Non.
— Un chaton ?
— Mon frère n’était plus le même depuis qu’il avait rencontré Lola.
— Je me fiche de votre frère.
— Lola, elle couchait avec tout le monde. Mon frère en était malade.
— Je ne crois pas un mot de ce que vous racontez, alors vous allez arrêter. Je vous déposerai à Saint-Leu et je ne veux plus jamais vous revoir.
— Il a fait une tentative de suicide. À cause d’elle, il a passé trois semaines à l’hôpital de Saint-Pierre, l’année dernière. Chez les cinglés. Avec les drogués et les alcooliques.
La voiture s’est arrêtée net. J’en suis descendue. J’ai fait le tour du véhicule par l’arrière. J’ai ouvert la portière, j’ai attrapé le bertèl et je l’ai balancé dans le fossé.
— Vous descendez.
— Qu’est-ce qui vous prend ?
— J’ai dit : vous descendez.
— Mais ça va pas ! Vous avez pété un câble ou quoi ?
— Vous dégagez. Et très vite.
Le contenu du sac s’était renversé sur l’herbe. Au milieu d’un énorme tas de feuilles séchées de zamal, un portefeuille orange et jaune, plein de billets, était tombé sur le côté, ainsi qu’un mobile Samsung bleu nuit dont la sonnerie s’était déclenchée, imitant le gazouillis d’un bébé.
Le portefeuille et le téléphone de ma fille.
On ne les avait pas retrouvés après l’accident.
- Fin du chapitre et du livre -

Tous les contenus du site internet de Lectivia sont protégés par la loi sur les droits d'auteur. L'utilisation, le partage ou la reproduction de toute partie du contenu sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur ou des ayants droits ou de Lectivia sera punis par la loi en vertu des règlements sur la violation du droits d'auteur et la propriété intellectuelle.

— Arrête !
— Quoi ?
— Arrête de taper dans les cailloux avec tes savates, ça m’énerve. En plus, tu vas te faire mal.
Ça changerait quoi ? Il avait déjà mal. Mal au ventre de ne pouvoir lui dire. Mal à la tête d’y penser sans relâche. Mal au cœur à cause des images qui tournaient en boucle à l’intérieur de ses yeux.
Il étouffait.
Elle s’en fichait.
Comment il allait lui dire ? À quel moment ?
Il y avait réfléchi une partie de la nuit et il y réfléchirait encore s’il ne trouvait pas de solution. Il s’est remis à taper dans les cailloux, à les envoyer valser d’un coup de savate, le plus fort qu’il pouvait, le plus loin possible. Comme dans la cour de récréation, après la cantine.
— Arrête, purée ! Faut t’le répéter combien de fois ?
Parce qu’elle avait les yeux rougis, il a évité de la regarder. Elle avait pleuré presque toute la nuit. De l’autre côté de la cloison, elle avait gémi, reniflé, s’était mouchée au moins dix fois. Blotti contre le tigre en peluche gagné à Pâques à la fête foraine, il n’avait pas dormi non plus.
Côte à côte, ils marchaient maintenant sur la route, en direction de la forêt. Le soleil était encore haut. À l’orée du bois, un papangue a déchiré l’air lourd et plongé en piqué sur une proie. Un peu plus tard, une jeune femme les a doublés en courant. Ses bras fendaient l’air comme les pales d’un moulin à vent pour attirer l’attention du Car Jaune qui venait de les dépasser. Sans doute comptait-elle monter dedans au prochain arrêt. Mais son chapeau s’est envolé et elle n’a plus eu aucune chance de rattraper le bus. Un chapeau de paille, avec un ruban vert, comme celui de la directrice de l’école. Madame Hoarau n’aimait pas le soleil à cause de ses taches de rousseur.
Joseph a cessé de donner des coups de pied dans les pierres. Ses orteils étaient écorchés et mangés par la poussière. Ils sont arrivés devant le ponton de bois. Il avait bien tenté de freiner la marche depuis le départ, mais voilà, ils y étaient. Ils finissaient toujours par y arriver, quoi qu’il fasse.
— Tu y vas tout seul ou tu veux que je t’accompagne ? a-t-elle demandé d’un ton sec.
Elle n’avait aucune intention de le suivre.
Ni l’un ni l’autre, avait-il envie de répondre.
Sans un mot, il a lâché la main de sa mère. Il s’est avancé sur le pont branlant. Un bras d’eau douce limpide se faufilait entre les galets. Joseph s’est souvenu qu’il était tombé dedans à plusieurs reprises. Il a enlevé ses savates pour traverser prudemment pieds nus dans l’eau fraîche, presque froide en ce début du mois de mai.
En face, un sentier de terre rouge montait en pente douce vers une case noyée sous la végétation.
C’était samedi, Joseph allait chez son père à Condé Concession.
Il ne s’est pas retourné pour regarder sa mère s’éloigner. Il savait qu’elle avait déjà tourné les talons. Quand viendrait donc le jour où elle le prendrait dans ses bras pour lui dire au revoir ? Il n’avait cessé d’espérer. Il était né par accident. Qu’y pouvait-il ? Son sac sur le dos, il a continué à gravir le coteau, sans se presser.
En haut, personne ne l’attendait hormis quelques volailles dans la cour. De leurs grands bras feuillus, les tamarins avalaient le toit de tôle qui, un jour, avait dû être blanc. La rouille en avait grignoté la moitié.
De la poche de son short, Joseph a extirpé la clé de la porte de derrière. Son père ne rentrerait que vers six heures. Il était employé à la commune du Tampon qui l’avait appelé ce samedi, exceptionnellement.
Joseph avait deux heures pour ranger la maison, faire la vaisselle, balayer la cour et préparer le dîner. Il regarderait ce qu’il y avait dans le frigo. S’il ne trouvait rien, il mettrait de l’eau à bouillir sur la gazinière, y jetterait un sachet de nouilles, ou ferait cuire du riz dans le rice-cooker et ouvrirait une boîte de cassoulet. Ce qui comptait, c’était que son père ait à manger en arrivant.
Sinon…
Sur sa droite, des piaillements vers la lisière de la forêt. Au-dessus de la route bitumée de la ligne des 400, une tache vert olive se débattait sur une branche basse : encore un merle-pays pris dans la glu. Son père s’obstinait à braconner. Un jour, il se ferait prendre et ce serait bien fait pour lui. Quand Joseph le mettait en garde, tout ce que son père trouvait à dire, c’était : « Moin lé pa la èk sa. »
Il s’en moquait, quoi.
Tout à l’heure, Joseph irait libérer l’oiseau. Pas sûr qu’il y arrive. La dernière fois, il avait failli arracher les pattes à un autre merle, avant de se résoudre à le laisser crier sur la branche.
Maintenant, Joseph regrettait d’avoir parlé à Anne-Lise, la remplaçante de la maîtresse. Elle avait détourné le regard avant de faire diversion en lui proposant d’emporter le livre qu’il n’avait pas eu le temps de finir. Il s’en fichait complètement de savoir la fin ou pas. Sans famille ! Ce n’était pas un roman à lui donner à lire. Si elle avait su. S’il avait eu le choix, il aurait pris un livre sur les chats. Un livre où on explique ce qu’un chat ressent lorsqu’il meurt. C’était la question qui lui vrillait l’estomac.
Il a avisé un caillou assez gros et rond et a shooté dedans de toutes ses forces.
Même pas mal.
Derrière le mur en parpaings, un chien a hurlé dans la cour d’à côté. Il avait dû recevoir la pierre sur la gueule.
Pas de chance ! Pas fait exprès.
Joseph a déverrouillé la porte en forçant un peu sur la serrure.
Dans l’entrée, comme chaque samedi, il a frissonné en apercevant les fusils de chasse suspendus à des clous rouillés. Trois fusils marron et deux vieilles carabines 12 mm. Un peu plus loin, des jumelles, à un autre clou. Les armes, tête vers le haut, n’étaient pas chargées. Le dimanche, son père les utilisait pour chasser des lièvres dans les branles, du côté de La Plaine des Cafres où il posait des collets.
Joseph a jeté son sac derrière la porte. D’un mouvement de cheville, il a envoyé ses savates sur le meuble à chaussures en plastique. Au-dessus du meuble, un miroir lui a renvoyé son image : visage ovale plongeant vers un menton pointu, cheveux châtain clair, yeux marron tristes, peau blanche légèrement hâlée, le nez un peu trop long, les lèvres fines un peu trop crispées à son goût. Il n’aimait pas le grain de beauté sous son œil gauche. Une bande de coquillages, fixés à la colle Scotch, cerclait le miroir.
Joseph a souri.
Dans la glace, son visage s’est éclairé.
L’année dernière, il avait réalisé le plus beau cadeau de fête des Pères de tous les élèves de sa classe de CP. Quand il l’avait offert à son père, celui-ci l’avait aussitôt accroché dans l’entrée. Les murs semblaient vibrer encore de la joie que Joseph avait procurée à son père.
— Astèr, mon pti gaté, ou lé in lartist. Na poin in zafèr lé gayar komsa dann la kaz.
Un artiste dans la maison, quelle chance !
Son père, lui, savait lui faire oublier sa naissance indésirable.
Indésirée.
Derrière le cadre, un margouillat a pointé un bout de museau. Joseph a repensé au chat. Il faudrait bien qu’il explique à sa mère. Il n’avait pas voulu que ça arrive. C’était un accident. Il n’avait juste pas réfléchi. C’est tout. Seulement voilà, elle le lui répétait tous les jours :
— Fais attention, Joseph, tu vois bien que c’est dangereux.
Maintenant, il était un assassin. Bien fait pour lui. Il l’avait cherché. Il irait en prison. Dans une prison pour enfants où on mange du riz sec et des brèdes. Il serait enfermé dans une cellule moisie. Des grands avec des poux plein la tête lui feraient la peau. Il l’avait entendu à la télévision : les détenus règlent leur compte aux meurtriers et les gardiens ferment les yeux.
Il avait peur. Mais rester sans rien dire l’effrayait tout autant. Peut-être que sa mère pourrait l’aider. Une fois qu’elle aurait fini de pleurer la mort de son chat et de verser des larmes de découragement, parce que son fils était un bon à rien.
Il se ferait tout petit.
Encore plus petit.
Lorsqu’elle aurait épuisé son stock de larmes, il lui prendrait la main. Enfin, si elle le laissait approcher. Mais peut-être qu’elle pleurait pour autre chose que la mort de Figaro. Peut-être qu’elle pleurait le départ de son mari.
Le lendemain de Noël, quand elle s’était aperçue que Joseph avait vidé les flacons de parfum neufs dans le lavabo de la salle de bains, elle l’avait menacé de le placer dans une famille d’accueil. Il ignorait que c’était possible, ça, qu’on pouvait déménager un enfant, tout seul, dans un autre foyer, s’il n’était pas gentil. Il croyait qu’il resterait toujours avec sa mère. Ou, au pire, avec son père. Même s’il n’aimait pas les fusils dans la maison. Les armes, c’était pour la chasse, dehors, ou pour la guerre.
Dans une autre famille, il n’y aurait peut-être pas eu de chat, donc pas de meurtre de chat.
Pas d’accident de chat, a-t-il corrigé mentalement.
Il aurait préféré. C’était trop tard. Et sa mère n’achetait plus de parfum, alors il n’avait plus rien à vider lorsque la colère le submergeait.
Elle disait toujours :
— Arrête tes conneries, Joseph ! Après tu vas le regretter, mais ce sera trop tard.
Il ne répondait pas, ou bien juste :
— J’ai pas fait exprès.
— C’est bien ce que je te reproche. Je voudrais que tu fasses exprès de ne pas le faire.
Il a dégluti.
Il irait digérer la leçon en prison.
Comme tous les samedis, il a commencé par lancer des grains de maïs aux volailles qui gloussaient. Puis il a balayé la cour. Les feuilles mortes dansaient dans la poussière orangée qui lui giclait au visage. Il a éternué à plusieurs reprises.
Ensuite, il a rangé le séjour et la cuisine. Son père laissait tout traîner. Il a ramassé les vêtements sales par terre, les barquettes en plastique achetées chez le Chinois, en face de la mairie, et les chaussures qui sentaient mauvais. Il a caché ces dernières dans un goni déchiré qui dépassait du meuble à chaussures. Le sac en toile de jute était rempli de chaussettes en tire-bouchon. Son père avait les jambes poilues comme des pieds de palmiste. Il s’est demandé s’il aurait, un jour, de grands poils noirs comme lui, partout sur les mollets.
Il n’avait pas envie de grandir.
Il s’est attaqué à la vaisselle. De la sauce de soja marron dégoulinait des assiettes. Des yeux gras flottaient dans une casserole. Il a craché dessus. Des bulles ont fait exploser les yeux jaunes un à un. Il a repensé à la soupe de la prison. Et aux yeux de Figaro agonisant. Il a fouillé les placards. Une boîte de raviolis. Parfait. Du frigo, il a sorti un sachet de fromage râpé ouvert qui sentait un peu le moisi, mais qui ferait l’affaire. Il a mis deux doses de riz et deux d’eau dans le rice-cooker qu’il a branché sur la paillasse.
Oubliant l’oiseau pris au piège, il a allumé la télévision, a choisi une série pour enfants et s’est allongé sur le canapé en tissu.
Il s’est endormi.
Le chat l’étouffait. Ses énormes pattes noires appuyaient sur son cou où les veines gonflées traçaient un réseau en relief. Il était comme paralysé. Les griffes étaient plus longues que les dents de la fourche de son père planquée derrière le pied de letchi. Il essayait d’appeler à l’aide, mais aucun son ne sortait. Sa bouche de poisson tétait l’air sans bruit. Il battait de la queue sous la patte du chat qui l’observait, tranquille et froid. Des yeux jaunes du félin coulait un liquide visqueux, comme la glu meurtrière que son père étalait sur les branches.
Un crissement de pneus sur les scories du chemin l’a réveillé. Il faisait jour. Par la fenêtre, il a reconnu la voiture cabossée de sa mère.
— Ton père a eu un accident en sortant de la mairie.
— Il est mort ?
— Non. Il est aux urgences du Tampon. Dépêche-toi.
— C’est grave ?
— Non, une jambe cassée et deux côtes fêlées.
— Il va mourir ?
— Non. Arrête de poser des questions. Tu me fatigues.
Joseph a pris le trousseau de clés sur la table basse et a rejoint sa mère dans la cour. Il s’est souvenu du chat. Dans la voiture, oui, c’était une bonne idée. Il lui raconterait toute l’histoire pendant qu’elle conduirait. Ce n’était pas de sa faute. Elle comprendrait. À côté de l’accident de son père, l’incident du chat, cela ne serait plus grand-chose.
— Il faut qu’on accélère. Je n’ai pas de temps à perdre, moi. Après, je dois retourner travailler à la boulangerie.
Le dimanche, la boulangerie du Douzième kilomètre restait ouverte jusqu’à quinze heures. C’était pour cette raison que Joseph passait les weekends chez son père.
Il ne savait pas ce qu’il préférait : les jours d’école dans le petit appartement rénové de sa mère, à la Ligne Paradis, ou les weekends dans la case de son père, en pleine nature, à Condé Concession.
Il glissait d’un monde à l’autre en passant de la langue française au créole. Quand quelqu’un demandait à son père : « Comment ça va, Charly ? », celui-ci répétait invariablement la même blague éculée : « Savate deux-doigts ». Et sa mère disait que sa blague à deux balles ne faisait plus rire personne.
Sur la quatre-voies qui menait au Tampon tout était gris. Un fin brouillard aspirait les couleurs.
Joseph a pris son courage à deux mains.
— Jeudi, quand je suis rentré de l’école en vélo, le chat me barrait la route. Il était allongé de tout son long en travers du chemin. Tu sais, là où la clôture est cassée, près de la boîte aux lettres.
Il ignorait si sa mère l’écoutait ou si elle était déjà mentalement à l’hôpital avec son père, ou à la boulangerie avec sa grosse patronne qui criait tout le temps. Elle ne réagissait pas. Elle fixait la route, droit devant, et, pour une fois, elle n’a pas dit : « Arrête ! »
— Pour lui faire peur, j’ai foncé dessus. Je me serais arrêté à temps, je le jure. Je suis un pro des dérapages.
Il voulait juste effrayer le chat, mais celui-ci s’était sauvé par la droite, vers le four à chaux. Ce n’était pas prévu. Joseph avait sauté du vélo et couru derrière l’animal parce que, un peu plus loin, dans les herbes hautes, il avait posé des collets. Attraper un lièvre prouverait à son père qu’il méritait de l’accompagner à la chasse.
La tête de Figaro était coincée dans le nœud coulant. Au fond de ses orbites, ses yeux roulaient à lui déboulonner le cerveau. Ses griffes pédalaient dans l’air et un son bizarre s’échappait de sa gueule. Un cri rauque comme Joseph n’en avait jamais entendu. Il s’était approché. Le chat avait agonisé à ses pieds. Joseph s’était efforcé de ne pas le regarder, mais c’était impossible.
— J’ai rien pu faire. J’ai attendu qu’il meure. Ensuite, j’ai coupé la corde du collet avec le sabre à canne que tonton Michel pose le long du grillage. Après, j’ai paniqué et j’ai caché le corps dans le fossé.
Ils étaient arrivés à l’hôpital. Les essuie-glaces couinaient en chassant la pluie qui s’abattait sur le pare-brise. Sa mère a garé la voiture. Elle a observé Joseph dans le rétroviseur intérieur. Longtemps, sans rien dire. Joseph se tenait droit, immobile sur le siège arrière, le regard fixé sur l’appui-tête avant. La sueur lui ruisselait des aisselles aux poignets.
Sa mère a ouvert la portière. Il a fait de même. Ils sont sortis de la voiture, sous l’averse. Le macadam irrégulier du parking peinait à déglutir l’eau qui s’accumulait dans les creux.
Sa mère s’est tournée vers lui et, contre toute attente, l’a serré très fort dans ses bras, presque trop fort. Il a cru qu’il allait étouffer, comme le chat pris dans le piège, et ce serait un juste retour des choses, œil pour œil, dent pour dent.
Il sentait le visage mouillé et chaud de sa mère contre le sien. Sa peau collait. Elle pleurait. Quand est-ce qu’elle allait arrêter de pleurer ?
Il n’a rien dit, rien de plus que tout ce qu’il avait déjà dit.
Cela suffisait.
L’haleine de fumeuse de sa mère lui a donné la nausée. Il a essayé de desserrer son étreinte. Elle s’est penchée pour lui murmurer quelque chose à l’oreille.
Quelque chose que personne ne lui avait jamais dit.
Que les parents disent à leurs enfants.
Quelque chose qu’il avait attendu sept ans.
Qu’il s’était juré de dire un jour à son fils.
Il n’était pas sûr d’avoir bien entendu le « je t’aime ». Il ne lui demanderait pas de répéter. Il n’avait pas oublié son « Arrête de poser des questions. Tu me fatigues. » Si elle ne le lui redisait plus, il resterait avec ce doute jusqu’à la fin de sa vie.
Et ce serait bien fait pour lui !
Maudit chat…
- Fin du chapitre -

Tous les contenus du site internet de Lectivia sont protégés par la loi sur les droits d'auteur. L'utilisation, le partage ou la reproduction de toute partie du contenu sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur ou des ayants droits ou de Lectivia sera punis par la loi en vertu des règlements sur la violation du droits d'auteur et la propriété intellectuelle.

— Hôtesse de l’air ? Mais ma pauv’ fille, tu t’es regardée ? Pourquoi pas top model aussi, ou pute, tant que tu y es ? Tu rêves d’être bonniche sur Air Austral, c’est ça ?
— Non, je veux travailler sur Air France.
— Bonniche sur Air France, c’est pareil.
Le père a reposé son verre vide sur la table, près de la bouteille de rhum Charrette. La brume des Hauts avait envahi l’étroite cuisine en même temps que le soleil de mai disparaissait derrière le Piton Cabri. L’humidité imprégnait tout, du sol en béton ciré au plafond. L’esprit du père, lui, était brumeux depuis longtemps, aussi brumeux que sa Sologne natale.
Debout près de la porte, Mylène a baissé les yeux comme chaque fois que son père élevait la voix. Ses pieds nus portaient encore les empreintes creusées sur sa peau par les lanières de ses sandales. Quand elle serait riche, elle s’achèterait des chaussures à sa taille, au lieu de toujours devoir finir d’user celles de sa mère qui faisait une pointure de moins. Et elle prendrait l’avion. Avec la vieille valise noire qui moisissait derrière le buffet, elle irait à Gillot et s’envolerait dans un Boeing 747.
— Ou une fac de philosophie ? a-t-elle tenté, le regard fuyant. Je pourrais devenir professeur ou journaliste. Je pourrais travailler pour le Journal de l’île, a-t-elle continué, les yeux rivés sur ses orteils colorés par la terre rouge du chemin qui menait de la route goudronnée à la maison.
Tout en parlant, elle triturait un cahier qui semblait avoir vécu dix vies. La couverture écornée était déchirée au-dessus du Clairefontaine inscrit en majuscules bleues. Un des cahiers achetés au Mini-Market, à la rentrée d’août, qu’elle n’avait pas utilisé pour les cours au lycée.
— Y a une fac de philo à Saint-Denis ? a demandé son père.
— Non.
— Ben alors ?
— Faut aller en métropole.
— Et tu crois qu’on va t’payer des études à Paris ? Tu t’prends pour qui ? On n’a pas les moyens d’offrir à mademoiselle un logement pour faire la fête avec ces merdeux d’étudiants friqués.
— J’vais pas faire la fête, papa, je veux étudier.
— Tu parles ! La philo ! Qui t’a mis des idées pareilles dans la tête ? C’est encore ce con de prof, là, celui qui vient en cours en débardeur, short, et casquette à l’envers. La liberté ! Il me fait marrer. Il a oublié de grandir ou quoi ? C’est pas avec Platon que tu vas réussir à manger et à te payer un loyer. Non mais, t’entends ça, Cécile ? De la philo !
Jetant un coup d’œil à sa femme, assise à l’autre bout de la table, il a tiré sur son cinquième joint de la journée. Il était râblé, le visage rougeaud, les cheveux gras. Les muscles de ses bras bronzés saillaient là où s’interrompaient les manches de son T-shirt Quiksilver. Il a recraché la fumée dans la chevelure de sa fille qui n’a pas bougé.
Faut pas que je me laisse enfumer, a pensé Mylène, toujours immobile.
La mère, avachie sur une chaise bancale, est intervenue, aussi ivre que son mari, l’esprit aussi nébuleux.
— Et vendeuse, Frank ? Ce serait bien, vendeuse, pour elle, non ? Enfin, si elle y arrive…
En soupirant, elle a défait le nœud qui retenait ses longs cheveux noirs qu’elle a enroulés autour de son index, avant de remettre l’élastique en place pour maintenir sa queue de cheval. Avec ses yeux en amande, son nez retroussé et ses lèvres fines, elle aurait pu être belle.
— J’ai eu quinze de moyenne générale, ce trimestre, et les félicitations, s’est défendue l’adolescente. J’aurai le bac avec mention, tous mes profs le disent.
— Le bac, le bac ! Ils le donnent à tout l’monde. Hein, Cécile ? Même nous, on l’a eu. Même ton abrutie d’copine qui m’regarde pas quand j’lui parle, elle l’aura.
— Marcelline ?
— J’sais pas comment elle s’appelle. Celle qui est venue ici pour ton anniversaire.
— Marcelline. C’est la première de la classe.
— Ben, première ou pas, elle me regarde pas quand j’lui parle.
— Tu lui fais peur.
— Non, mais t’entends ça, Cécile ? Je terrorise les gosses maintenant.
Sa femme a tangué sur sa chaise. Puis, après un basculement sur la gauche et un autre sur la droite, elle a réussi à rétablir son équilibre.
— Vaut mieux entendre ça que d’être sourd, est-elle parvenue à articuler.
Mylène a réprimé les larmes qui montaient. Elle regrettait d’avoir invité Marcelline chez elle. C’était pourtant la seule amie à avoir franchi le seuil de cette maison. Elle n’osait plus inviter personne.
Marcelline n’était venue qu’une fois, en mars, pour les dix-huit ans de Mylène. Dix-huit ans, ça se fête, quand même !
Marcelline habitait à Saint-Louis, pas loin de l’usine sucrière du Gol, dans une petite case en bois sous tôle, comme Mylène, mais avec de vrais parents. Mylène aimait bien y aller. Souvent, après les cours, elles faisaient leurs devoirs ensemble, sur la grande table de la salle de séjour, en sirotant une tasse de café ou une limonade. Elles discutaient des heures dans la chambre que Marcelline partageait avec deux de ses sœurs. Quand elles avaient fini, la mère de Marcelline leur apprenait à préparer un rougail morue ou un gâteau patate. Dans la cour en terre battue, Marcelline jouait aux billes avec ses jeunes frères et sœurs, ou à la marelle et à l’élastique. Contrairement à Mylène, elle ne s’ennuyait jamais.
Et il y avait Benoît, le frère aîné de Marcelline. Quand il rentrait du boulot, il s’installait sur le canapé et lisait des romans de Jules Verne. Pas de bière, pas de rhum, pas de cigarette. Il souffrait d’épilepsie.
— Ouais, Cécile, t’as p’t-être raison, ta fille est propre et souriante, et tu pourras toujours demander au patron du Mini-Market de la prendre. Il t’a à la bonne, le Chinois, depuis que t’as dénoncé le client qui piquait des boîtes de sardines.
Il s’est mis à rire.
— Des sardines ! Tant qu’à voler, il aurait mieux fait de piquer du Dom Pérignon ou du Petrus.
Au milieu des éclats de rire du père, le frère de Mylène est entré dans la pièce. Il sentait l’urine et le vomi dans son pyjama qui, un jour, avait dû être bleu. Un doudou crasseux dans la main droite, il a tiré, de sa main gauche, sur le bas du peignoir informe qui enveloppait leur mère.
— Monmon, bibi, monmon, bibi.
Il avait la peau claire, comme sa mère, alors que Mylène avait hérité du teint méditerranéen de son père. À bientôt trois ans, le petit garçon souffrait de problèmes d’élocution. Son cerveau tournait au ralenti.
La mère a posé son verre, vide comme le cerveau de son fils, sur la toile cirée tachée, où trônaient des bouteilles de bière Bourbon et une pile d’assiettes rougies par la sauce du carri de porc de midi. À son tour, elle a allumé un joint en attrapant le biberon : une cuillère à café de rhum diluée dans deux cents millilitres de lait tiède, de quoi endormir le môme sans qu’il fasse le cirque. Elle était fière d’avoir trouvé la solution pour qu’il arrête de leur casser les pieds, le soir. En se retournant vers la gazinière, elle a saisi la poignée à moitié dévissée de la casserole en inox encore chaude. Elle a rempli le biberon en plastique où stagnait un fond du lait utilisé le matin, puis a placé la casserole sur un rectangle de bois qui servait tantôt de dessous-de-plat, tantôt de planche à pain et, occasionnellement, de cale pour la table.
— J’veux pas travailler dans un magasin comme toi, maman, je veux faire des études, a repris Mylène, rassemblant ce qui lui restait de courage.
Le père a tapé du poing.
— Tu ne parles pas à ta mère sur ce ton. Cécile, dis quelque chose.
Une bouteille de bière a roulé sur la toile cirée et s’est fracassée par terre. Du bout de sa savate, la mère a poussé les éclats de verre sous la table.
— Écoute ton père. Tu me parles pas sur ce ton, a-t-elle déclaré, sans même regarder sa fille.
Mylène a observé ses parents, se demandant ce qu’elle avait de commun avec ces ivrognes fainéants. Elle avait de la chance d’être née quinze ans avant son frère. Ils avaient déboulé à La Réunion, deux décennies plus tôt, parce qu’un de leurs copains surfeurs leur avait écrit que c’était l’endroit rêvé : « Les vagues sont magnifiques. On est en maillot de bain toute l’année. Pas de facture de chauffage à la fin du mois. Pas de vêtements à acheter. Du beau temps trois cent soixante-cinq jours par an. »
Alors, ils étaient venus, ils avaient surfé, et ils s’étaient installés dans une colocation, vers la grande ravine de Saint-Leu, vivant de pas grand-chose, un petit boulot par-ci, une indemnité de l’État par-là, un peu d’argent envoyé par la mère de Cécile et les grands-parents, jusqu’au moment où Cécile avait changé la donne en tombant enceinte. Surfer avec un marmay sur le dos, c’était inenvisageable, même si les parents de Mylène l’avaient sûrement envisagé.
Et le matin, c’était moins fun, à cause des pleurs nocturnes de la gamine. Ils étaient de vraies loques. Putain de môme. Impossible de s’arracher du lit avant midi. Laissant passer les vagues, ils avaient remisé leurs planches au fond du garage d’un copain. Cécile avait trouvé une place de caissière au Mini-Market de L’Étang-Salé. De temps en temps, Frank bricolait pour une boutique de surf, sur le port de Saint-Leu. À l’étroit dans leur chambre, ils avaient fini par quitter la colocation d’origine que leurs potes avaient désertée depuis longtemps. Ils avaient emménagé dans un petit meublé, au-dessus de la ligne droite qui traversait les champs de canne en direction de l’usine du Gol, à Saint-Louis.
Dans les Hauts, les loyers étaient abordables.
Fixant du regard le biberon qui se vidait dans le gosier de son frère, Mylène a cherché en vain d’autres arguments. Elle n’avait pas envie d’être à la merci des mains baladeuses du chef de rayon dont sa mère se plaignait à ses voisines, un jour sur deux. Son père était-il au courant ?
— Je ne vais pas passer ma vie à remplir des gondoles au Mini-Market, ni à trancher du saucisson ou du jambon, avec un bonnet plastique sur la tête. Je veux réaliser mon rêve, moi.
— Parce que tu crois que, dans la vie, on réalise ses rêves ? Moi, si j’avais eu le choix, je serais en train de surfer à Hawaï, tiens, et ta mère, elle serait pas assise là, à écouter tes conneries. Hein, Cécile ? Le pipeline de Waimea, c’est autre chose que la gauche de Saint-Leu.
Il a écrasé son mégot dans un cendrier cassé où se consumait un tortillon antimoustique à la citronnelle.
— C’est pas parce que vous n’avez pas su réaliser les vôtres que je ne vais pas suivre le mien.
— Tu la veux, celle-là ? a menacé le père, la main brandie au-dessus de la tête. Il s’est arrêté net en grimaçant : « Putain ! » Il avait réveillé sa tendinite à l’épaule droite.
— J’ai dix-huit ans maintenant.
— Et alors, qu’est-ce que ça change ?
— Je suis majeure.
— C’est pas ça qui va m’empêcher de t’en coller une. T’en aurais vingt que ce serait pareil.
— Tu ne me fais pas peur.
Pris de court, il s’est tourné vers sa femme.
— Si j’avais pas assisté à ton accouchement, Cécile, j’aurais du mal à croire que c’est ta gosse.
Mylène s’est tue.
Plus que la violence physique de son père, sa violence verbale faisait mouche à tous les coups. Elle avait compris, depuis des années, qu’il aurait mieux valu qu’elle ne vienne pas au monde. Seulement voilà, elle était là, et elle était leur fille. Elle s’estimait heureuse : elle aurait pu être aussi abrutie qu’eux.
— Nous, à ton âge, on s’imaginait surfeurs professionnels. Tu vois le résultat, a relancé la mère.
Après une seconde d’hésitation, Mylène a pris son courage à deux mains.
— Moi, mon rêve, c’est d’être écrivain.
— Écrivain ? se sont exclamés ses parents d’une seule voix.
— Mais pour écrire quoi ? a demandé son père.
— Pour m’évader dans un autre univers. Pour inventer des histoires.
— Des histoires de quoi ? De Grand-mère Kalle ? De Sitarane ?
— Pour raconter les confidences de tes copines du lycée ? a ajouté sa mère.
— Tu vas pas raconter notre vie quand même ? s’est inquiété son père.
Tiens, je n’y avais pas pensé, s’est dit Mylène.
Le père s’est resservi une rasade avant d’amorcer une tentative pour se lever de sa chaise. Il a désigné la bouteille vide.
— Va en chercher une autre, Mylène.
— Y en a plus, a précisé la mère, c’était la dernière.
— Quoi ? On a déjà descendu les trois litres de rhum que t’avais rapportés hier midi ?
— Ben oui. Les trois Charrette. Plus le Bordeaux que le chef de rayon m’avait filé en douce, à la fermeture du magasin, samedi soir.
En échange de quoi ? a failli demander Mylène.
Une pluie régulière tambourinait maintenant contre la tôle. Avec la tombée de la nuit, le vent austral s’infiltrait à travers les boiseries creusées par les termites. Même s’il tenait mieux l’alcool que sa femme, le père avait du mal à rester debout. Il s’est appuyé sur un coin de la table.
— J’ai jamais lu un livre de ma vie et ma fille veut devenir écrivain ! On aura tout vu. C’est pas un métier, ça, tu m’entends ? Laisse ça aux intellos. De toute façon, ils ont déjà tout écrit.
— Je veux écrire des romans.
— Des romans ?
— Comme Marguerite Duras.
— C’est qui celle-là ? Tu sais qui c’est, toi, Cécile ?
— Jamais entendu parler.
— C’est celle qui a écrit Un barrage contre le Pacifique, a expliqué Mylène. Je l’ai étudié en classe l’an dernier, pour le bac de français.
— Connais pas.
— D’ailleurs, j’en ai presque fini un.
— Un barrage ?
— Ben non, un roman. J’ai pres-que fi-ni d’é-crire un ro-man.
Mylène n’était pas sûre que ses mots traversent l’opacité de leur cerveau.
Elle a secoué le cahier blanc qu’elle tenait à la main. Cent cinquante pages écrites en six mois, cachées dans son cartable qu’elle gardait avec elle, nuit et jour. Entourée de livres, de dictionnaires, de manuels scolaires, elle avait passé des heures au CDI du lycée à remplir son cahier, assise à la table en formica, près de la verrière avec vue sur la mer.
Le samedi après-midi, elle continuait à la bibliothèque de L’Étang-Salé, bien au frais dans la salle de lecture climatisée qui donnait sur une haie d’hibiscus plus haute que le premier étage.
De temps en temps, elle relevait la tête pour observer Benoît, debout un peu plus loin, occupé à réparer les ordinateurs du club informatique. Si leurs regards ne se croisaient pas, elle comptait jusqu’à trente avant de risquer une nouvelle tentative. Quand leurs regards se croisaient, il lui souriait. Elle rougissait et, l’inspiration décuplée par le charme du jeune homme, elle replongeait dans l’écriture de son roman. Son stylo se mettait à trembler.
Il avait vingt ans. Il avait quitté le lycée après la seconde. Il jouait au foot dans l’équipe de La Dominicaine. Le dimanche, elle allait parfois au stade assister aux matchs avec Marcelline. Perchées en haut des gradins, à l’ombre de l’avant-toit du gymnase, elles encourageaient l’équipe de Benoît en buvant un Cot citron. À la fin de la rencontre, elles l’attendaient à la sortie des vestiaires. Elles regardaient défiler les joueurs en maillot vert et jaune. Ceux qui connaissaient Marcelline venaient les saluer. Quand Benoît sortait enfin, sa sœur le félicitait, quel que soit le résultat du match, et Mylène ne savait jamais quoi dire. Elle s’efforçait d’avoir l’air sûre d’elle, mais en réalité, elle se sentait bête et moche, avec ses vêtements qui n’avaient plus de couleurs et ses sandales usées.
— Où t’as trouvé le temps d’écrire ? T’es censée travailler pour le bac, et, si tu as un moment de libre, c’est pour aider ta mère avec le ménage, le linge, la vaisselle et Kevin. Regarde-moi, ça !
Son père a repoussé les assiettes sales et s’est mis à gratter de l’ongle les miettes de pain agglutinées en croûtes sur la toile délavée.
— C’est dégueulasse ici.
Pour une fois, Mylène était d’accord avec lui. C’était dégueulasse, répugnant et de pire en pire. Qu’est-ce qui l’empêchait, lui, de nettoyer tout ça ?
Sa mère n’a pas bronché, sûrement déjà trop ensuquée. Les yeux ternes et le teint fatigué, elle a agité la main devant elle pour chasser un moustique imaginaire. Elle a tourné son regard vers le canapé en skaï au dossier déchiré. Kevin s’était endormi. Le biberon avait roulé vers le montant de l’accoudoir, semant des gouttelettes blanches qui finiraient par sécher en laissant des auréoles sur le similicuir. La pointe d’une planche de surf jaunie dépassait sous la banquette.
La seule chose de rangée dans cette maison, ce sont les rêves, a pensé Mylène. Les rêves et les bouteilles pleines.
Le père a tendu un bras vers sa fille.
— Montre un peu ton truc, là, qu’on lise c’que t’as écrit.
Aussitôt, Mylène a caché le cahier dans son dos, hors de portée des mains grasses de son père.
— Non, personne ne le lira. Surtout pas vous.
— T’as peur des critiques ?
— Non, plus maintenant. Je le montrerai à Marcelline.
Et à Benoît, s’est-elle promis.
Le bras de Kevin a glissé du canapé, entraînant le biberon qui a d’abord ricoché sur la pointe de la planche de surf, puis sur le sol. Le lait a recommencé à couler doucement sur le béton. Mylène s’est avancée vers son frère. Elle l’a réinstallé au milieu des coussins râpés et a ramassé le biberon collant. « Monmon, bibi, monmon, bibi », a répété Kevin dans son sommeil. Il s’est mis à sucer son pouce. Ses petits orteils se rétractaient et se détendaient au fur et à mesure que les images de ses rêves lui traversaient le cerveau.
À quoi pouvait-il bien penser ?
À quoi rêve un enfant ivre ?
Mylène ne boirait jamais d’alcool.
— Allume, a ordonné son père. On voit plus rien là-dedans.
Mylène a fait trois pas vers la porte sur laquelle était affiché un calendrier des pompiers dont personne ne tournait les pages. Elle a appuyé plusieurs fois sur l’interrupteur avant que l’ampoule du plafonnier daigne réagir et diffuser une lumière blafarde au-dessus du buffet, éclairant la photo de ses parents le jour de leur mariage, à Lamotte-Beuvron, en Sologne, au pays du Grand Meaulnes.
Inutile de leur parler d’Alain Fournier ou de François Seurel. Ils n’avaient sûrement pas plus lu Le Grand Meaulnes que les romans de Marguerite Duras.
Un ananas, donné par la mère de Marcelline, pourrissait dans la coupe à fruits. Des mouches tournoyaient, voletant de l’ananas à un morceau de papaye que personne n’avait pris la peine de mettre dans le frigo.
— Il va falloir que je cherche un éditeur.
— V’là aut’ chose. Tu vas rien chercher du tout. Tu vas bosser ton bac et aider ta mère.
— L’un n’empêche pas l’autre. J’enverrai mon manuscrit à des maisons d’édition et on verra bien.
— On verra rien du tout.
Elle s’imaginait découvrant, un matin, dans la boîte aux lettres, un courrier d’une grande maison parisienne. Est-ce qu’elle leur donnerait son vrai nom ou est-ce qu’elle utiliserait un pseudonyme ? Mylène Charbonnier, cela n’était pas le nom du siècle. Mylène C. ? Ou Meryl, à la place de Mylène ?
Elle prendrait l’avion pour la capitale, elle qui n’avait jamais quitté La Réunion. On la recevrait comme une princesse. Elle signerait un contrat dans un salon aux murs tapissés de livres, et alors, adieu la case miteuse, la crasse et les alcooliques. Adieu les rayons du Mini-Market et la trancheuse à jambon. Adieu les habits trop petits, les souliers râpés et les draps poisseux.
Elle dînerait au restaurant, dormirait à l’hôtel, ferait les magasins sur les Champs-Élysées. Elle irait chez le coiffeur et l’esthéticienne. On lui livrerait des fleurs dans sa chambre. Elle irait au cinéma, au théâtre, voir des expositions. Elle se promènerait sur les quais de la Seine. Elle monterait en haut de la tour Eiffel. On la prendrait en photo. Elle enverrait des cartes postales à Marcelline et à Benoît.
— Tu feras rien sans ma permission, a lancé son père.
— J’vais m’gêner.
— Il te faudra des sous pour expédier ton manuscrit. On va pas t’en donner. On n’en a pas.
— Je trouverai un moyen. J’irai faire le ménage à la bibliothèque. Ils ont mis une annonce. Ils cherchent quelqu’un.
— Ma fille ne fera le ménage chez personne.
— C’est pas pire que d’être employée au Mini-Market. Au moins, personne ne me tripotera les fesses, là-bas…
Elle a jeté à sa mère un coup d’œil qu’elle aurait voulu complice, mais cette dernière était hors-jeu. Mylène n’aurait su dire si elle s’était endormie sur sa chaise, ou si elle n’était plus en état de capter la conversation autrement que comme un bruit de fond.
*
Cette année-là, Mylène a obtenu le bac avec mention bien. Ses parents ne l’ont pas félicitée. Le lendemain, elle a été engagée au Mini-Market sur les recommandations de sa mère. Six mois plus tard, elle a démissionné et, contre l’avis de son père, elle a épousé Benoît.
— C’est un bon à rien, celui-là, même pas capable de me dire bonjour quand il me croise. En plus, il bégaie.
Avec son mari, elle s’est installée dans la maison de la mère de Marcelline. Elle a fait le ménage à la bibliothèque, le temps de rassembler suffisamment d’argent pour s’acheter un ordinateur d’occasion. Pendant huit semaines, elle a tapé et corrigé le texte de son roman. À la bibliothèque, elle l’a imprimé en trois exemplaires, moyennant une vingtaine d’euros. Elle a ensuite envoyé son manuscrit à trois grandes maisons d’édition à Paris.
Le weekend, elle rendait visite à sa famille. Refusant de la voir, son père disparaissait dès qu’elle franchissait le seuil. Elle nettoyait la case de fond en comble et la débarrassait des dizaines de bouteilles vides accumulées pendant la semaine. Elle s’assurait que Kevin allait à l’école, qu’il y avait de quoi manger dans le frigo et que sa mère ne portait pas de traces de coups.
Un matin de mai, deux ans jour pour jour après la conversation dans la cuisine, elle a reçu une lettre : son roman serait publié à la rentrée de septembre.
Le trente novembre, alors que les jacarandas refleurissaient dans la cour, Mylène est passée chercher ses parents. Ils avaient du mal à marcher mais, bras dessus, bras dessous, elle a réussi à les emmener jusque devant la Librairie de L’Océan, près de l’église, en centre-ville. Elle avait arrangé ses cheveux en un chignon qui lui dégageait la nuque et lui donnait « une certaine classe » avait dit Benoît, avant qu’elle ne parte. Elle avait enfilé une robe neuve, des sandales neuves et arborait un petit sac en cuir neuf.
Dans la vitrine, entre les cahiers Clairefontaine, les manuels scolaires et les articles de papeterie, une pile de livres s’élevait en plein soleil. Sur la couverture bleue s’étalait une photo de Mylène en gros plan, prise devant un flamboyant. Tout en haut, un titre, en lettres noires : Bouteilles vides. Un peu plus bas, en plus petit : Mylène Charbonnier.
— Tu vois, papa. Tu disais que je n’y arriverais jamais, s’est exclamée Mylène.
Son père s’est tourné vers elle et, sans un mot, lui a collé la gifle qu’il avait regretté de ne pas lui avoir donnée deux ans plus tôt.
- Fin du chapitre -

Tous les contenus du site internet de Lectivia sont protégés par la loi sur les droits d'auteur. L'utilisation, le partage ou la reproduction de toute partie du contenu sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur ou des ayants droits ou de Lectivia sera punis par la loi en vertu des règlements sur la violation du droits d'auteur et la propriété intellectuelle.

« Réminiscence d’un cours de français […]. Je revois le visage du jeune professeur métropolitain, doux, rieur, qui m’a fait entrer au cœur de la poésie. […] Ses yeux fixaient les miens. Plus de trente ans après, sa voix résonne dans ma tête avec cet accent qui me disait qu’il venait d’un pays lointain. Loin des siens, il s’était amouraché de cette île du bout du monde. »
Jean-François Samlong, L’Empreinte française, 2005.
Jeudi 17 août 1972. La Réunion. Rentrée des classes.
Installé sous la varangue, Thomas Lagrange, confiant, guettait le retour de Sophie et de Natacha, inscrites dans une école primaire du Tampon. Sur le carrelage, leurs tennis blanches délacées s’alignaient en rang d’oignons. Il avait hâte d’entendre leurs premières impressions, de s’assurer qu’il ne s’était pas trompé. Il avait tellement rêvé de cette vie aux antipodes de la grisaille et de la morosité.
— Alors, les filles, cette journée ?
— Bof !
Une moue enfantine a déformé le visage de Sophie d’habitude si rieur.
— Bof ? a répété Thomas.
— On m’a traitée de cachet d’aspirine dans la cour. Natacha aussi. Hein, Natacha, que c’est vrai ?
Thomas a passé doucement la main dans les cheveux de Sophie qui triturait le bas de son T-shirt. Du haut de ses dix ans, Natacha, l’aînée, n’a pas répondu à la question de sa sœur.
— Quand on jouait à l’élastique, deux filles nous ont parlé, a précisé Sophie.
— On ne comprenait pas ce qu’elles disaient, a ajouté l’aînée, fuyant le regard perplexe de son père.
— N’empêche qu’elles ont bien dit : « Blanche comme un cachet d’aspirine ».
Thomas ne s’attendait pas à ça.
Il pensait être enfin au bon endroit, au bon moment.
— Moi, je trouve que c’était mieux avant, a continué Sophie. Pourquoi on a quitté la France ?
— C’est interdit de dire la « France », l’a reprise Natacha en fronçant les sourcils.
— Ah bon ? Faut dire quoi alors ?
— J’sais plus. La maîtresse a dit le mot, mais je l’ai oublié.
À quoi rêvent des petites filles de neuf et de dix ans ?
À quoi aspire un homme de trente ans, après ce qu’il estime être « une erreur judiciaire » ?
Avant de quitter Apremont, Thomas avait imaginé des pique-niques à la plage et des randonnées dans les cirques. Il avait rêvé de la première fois qu’il décrocherait un régime de bananes, ouvrirait une noix de coco ou un chemin au coupe-coupe, dans la forêt tropicale de l’île.
Le sabre de la réalité venait d’entailler ses châteaux sous les tropiques. Et son crâne avec. Derrière son front, la migraine dressait des barricades. Devant les visages chagrins de ses filles, son rêve se délitait. À courir après son bonheur, avait-il oublié le leur ? Qu’était-il sans elles ? Sans leurs éclats de rire ? Elles étaient son port d’attache, son rocher. Quand elles étaient tristes, sa vie n’avait plus le même goût.
Dehors, sur la table, s’étalaient les fiches que les élèves de Thomas avaient remplies la veille, au lycée Roland Garros.
Un coup de vent a balayé la varangue. Une fiche s’est envolée. Thomas s’est levé pour la rattraper. Elle a voleté au-dessus du grillage, avant de retomber dans le champ de canne qui jouxtait la maison.
Il a escaladé la clôture.
Devant lui, un transformateur EDF. Sur le mur, à la peinture noire, une inscription en créole : Zorèy déor. Il s’est arrêté. Un léger nuage a voilé le soleil et ses premières illusions. Il a relu les mots. Des questions se sont percutées sous son crâne. S’était-il monté un bateau ? La Réunion, c’était son Amérique à lui, son eldorado.
Avait-il poussé son rêve trop loin ?
Son rêve ou sa fuite ?
Il ne savait plus.
Quarante mille francs d’amende avaient eu raison de sa mémoire.
Tandis que le ciel perdait de son bleu, le silence a envahi sa tête. Il a vérifié qu’Hélène et les filles étaient dans la cuisine. Que la végétation autour de la maison était assez haute pour dissimuler le bloc EDF. Pour qu’elle le reste, il planterait des bananiers, des manguiers, des avocatiers.
Tandis que la sueur glissait le long de son cou, il a repensé aux lycéens en pull-over rencontrés la veille, aux grands vasistas gris qu’il leur avait demandé d’ouvrir, les nako.
Comme ses filles, il faudrait qu’il apprenne le créole.
Dans sa tête, sa propre rentrée scolaire tournait en boucle.
Il se revoit, à sept heures, montant à pied le chemin Martinel Lassays. Pas encore de voiture. L’Eau Sauvage de Dior a remplacé l’eau de Cologne. Pour la première fois de sa vie, il s’est acheté un parfum dans une boutique hors taxes. Pour la première fois, il a pris l’avion.
Arrivé au lycée Roland Garros, le cartable à la main, il se dirige vers sa salle de classe en claudiquant légèrement, prend garde à ne pas buter contre l’estrade. Derrière son bureau, d’un geste de la main, il fait asseoir les élèves. Puis il saisit un morceau de craie et, évitant de faire crisser le bâtonnet sur le tableau, il écrit « mercredi 16 août 1972 ».
Dans la goulette métallique suspendue au tableau, une éponge humide. Pour effacer, sans doute. Pas de brosse. Tant mieux. Il déteste le contact avec le bois de la poignée. Quand le feutre frotte le tableau, la poudre de craie le fait éternuer. Au pied de l’estrade, une eau glauque dans un seau rouge.
Original.
— Bonjour à tous. Je m’appelle M. Lagrange. Je suis professeur de français.
Dans les rangs, quelques bonjours timides circulent tandis qu’il entame l’appel.
— Arianatchy Marie-Christine.
— Présente.
— Barret Frédéric.
— Présent.
Face à lui, trente-cinq paires d’yeux. Il ne tremble pas. Il saura les séduire. Jongler avec Baudelaire, Racine ou Maupassant. Réveiller les Don Quichotte, Gavroche, Bovary.
— Kermadec Gaël.
— Présent.
— Lauret Valérie. (Il prononce « Lauré »)
Rires dans la classe.
— « Laurette », monsieur. On dit « Laurette ».
D’une de ses poches, il sort un mouchoir et s’éponge le front. Des cheveux clairs bouclés, un peu plus longs depuis mai 68, encadrent son visage qu’il sait juvénile, mince et lisse, aux lèvres roses, ni trop fines ni trop épaisses. Il porte un pantalon de lin bleu, une chemisette de coton blanche et des mocassins noirs.
Comment s’habille-t-on sous les tropiques alors que le thermomètre grimpe à vingt-trois degrés en hiver austral ?
« Le ridicule déshonore plus que le déshonneur », a-t-il appris à l’unique école primaire d’Apremont, son village natal, loin, très loin d’ici. Il n’a jamais aimé La Rochefoucauld. Encore moins d’avoir eu à réciter ses Maximes, debout devant la classe, les bras croisés dans le dos. Les cours de morale, il les passait aux toilettes, au fond de la cour, à déchiffrer les graffitis qui rongeaient les murs.
Jamais il n’appliquera ces méthodes d’un autre âge.
O tempora, o mores.
Jamais ses élèves ne préféreront les toilettes taguées d’un lycée à ses cours de français. Mais il n’ignore pas que les certitudes… Sa jambe le lui rappelle tous les matins.
— Jean-François Chane-Teng, s’il vous plaît, pourriez-vous ouvrir la fenêtre ? demande-t-il à l’élève qui porte le prénom de son frère.
Chuchotements dans la classe.
— Les nako, monsieur ?
— Rouv lo nako, té, Shinoi ! s’exclame un voisin.
Thomas ne comprend pas bien, s’étonne intérieurement de cette manière de désigner les gens.
— Ousa i sorte zorèy-la ? ajoute un autre.
La façon dont l’adolescent le désigne du menton signale qu’il ne s’agit pas d’un compliment. Il esquisse un sourire. Il saura gagner la confiance de ses élèves. Ses yeux clairs aux longs cils reviennent sur la liste.
— Payet Juliane. (Il prononce « Payé »).
Nouveaux rires.
— « Paillette », monsieur, lance une voix fluette, au dernier rang.
Une jolie brune aux cheveux bouclés le fixe de ses grands yeux noirs. Il a l’habitude. Il ne compte plus le nombre de lycéennes dont les mots doux ont atterri sur son bureau.
Nouveau coup de mouchoir sur le front. Pour Barret, n’aurait-il pas dû prononcer « Barrette » ?
Qu’importe.
Garde la tête haute, voilà ce qu’il se dit, « Barrette » ou pas.
Il parvient, sans encombre, au trente-cinquième nom de la liste. Une phrase à lui tout seul : Randriamanarisoa. Un roucoulement d’oiseau.
Il pense à M. Albray. Si ce professeur de français n’avait pas croisé sa route autrefois, il serait devenu médecin, comme son père. Il avait alors l’âge des élèves devant lui. Il avait dévoré Zola, Voltaire, Mallarmé. Ou c’étaient eux qui l’avaient dévoré. Il ne se souvient plus très bien.
— Prenez une demi-feuille.
Bruissements de papiers qu’on déchire.
Murmures.
On frappe à la porte. Il sursaute.
À chaque début d’heure, un factotum apporte un cahier sur lequel inscrire le nom des absents. Un homme transparent, dont les élèves ne remarquent même plus l’irruption dans la classe.
Pour lui, cette intrusion, précédée d’un grincement de porte à peine audible, ravive l’écho du grincement d’un pied-de-biche sur la porte d’entrée de son domicile d’Apremont, 21, allée des Cerisiers, dans la nuit du mardi quatorze juillet 1970, alors que, sur le parvis de l’hôtel de ville, La Marseillaise retentissait pour clore le bal populaire.
— Nom, prénom, date de naissance, adresse des parents…
Par les nako, une étendue verte file en pente douce jusqu’à la mer : des champs de canne aux plumets roses, des palmiers giflés par les alizés, des arbustes inconnus. Cahin-caha, un car kourandèr rouge et beige remonte la rue du lycée.
En bas, l’océan Indien à perte de vue.
Un monde de possibles.
Il adore nager.
De l’autre côté de la salle, dans l’ombre, des montagnes s’imposent, coiffées d’un ciel indigo. Illuminant les cahiers Clairefontaine, les rayons du soleil traversent les échancrures rocheuses.
Cette lumière éclabousse-t-elle aussi les affaires de ses filles en train de dessiner, à la maison, en ce mercredi matin ?
— Mon père est mort, monsieur. Je mets quoi ?
— Je suis désolé. N’écrivez rien.
Échange de clins d’œil entre élèves. La partie n’est pas gagnée d’avance. Son physique de jeune premier fait des miracles auprès des adolescentes, mais gare à ne pas s’attirer les foudres des garçons. Tout en parlant, il baisse les yeux pour vérifier qu’il peut encore avancer sur l’estrade.
Des pieds nus dépassent sous une table.
Nus.
Dans un effort pour se réchauffer, des petits pieds fins se chevauchent. À la récréation, il en touchera deux mots à ses collègues. En territoire inconnu, mieux vaut éviter les remarques inappropriées. Toujours réfléchir avant d’agir. Il a retenu la leçon.
Que connaît-il de la vie dans l’île ?
Ses croyances pourraient bien être remises en question aussi vite qu’au mois de février 1971 où le procès a fait voler en éclats une grande partie de ses certitudes. Qui était la victime ?
Le coupable ?
La presse s’en est donné à cœur joie : Légitime violence. Innocent coupable ou coupable innocent ?
Un spasme contracte son estomac. Machinalement, il serre le poing. Il n’est pas du genre à se laisser faire.
Il pose les yeux sur ces têtes aux cheveux crépus ou raides, châtains ou noirs, au teint d’un arc-en-ciel tropical géant : pois chiche, ambre, noisette, pain d’épice, cannelle, caramel, café. Tant de diversité naturelle l’éblouit.
Ses années d’enseignement dans l’académie de Poitiers jaunissent comme une vieille photo. Une page s’ouvre : Lycée Roland Garros, Le Tampon, La Réunion, académie d’Aix-Marseille.
Il songe au teint basané hérité de son grand-père d’origine italienne. D’un mouvement imperceptible, ses épaules se relâchent. En quelques minutes, ce complexe qu’il traîne depuis l’enfance a perdu sa raison d’être.
Il distribue un poème tiré au stencil, en salle des professeurs. Le papier mou sent l’alcool. Le titre est à peine lisible. Il l’inscrira au tableau : « Mon rêve familier » de Paul Verlaine. Son poème préféré.
« Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant
D’une femme inconnue, et que j’aime, et qui m’aime,
Et qui n’est, chaque fois, ni tout à fait la même
Ni tout à fait une autre, et m’aime et me comprend. »
Quelques couinements moqueurs — « mi èm a ou, mi èm a ou, miaou » — lancés par des garçons au fond de la classe ponctuent le cours. Un instant, il est tenté d’en envoyer un changer l’eau du seau. Il se ravise.
— Qui est cette femme dont parle le poète ?
Les réponses fusent.
— La fille dont il est amoureux, suggère un garçon.
— Une femme qu’il imagine, mais qu’il ne connaît pas, propose celle qu’il aurait dû appeler « Paillette ».
— Son zézèr, entend-il au fond de la classe.
Les élèves s’esclaffent.
La sonnerie de onze heures trente le surprend au milieu des rimes, paradoxes et enjambements.
Le temps passe vite quand on est heureux.
Sous le soleil au zénith, il redescend le chemin Lassays. Le déménagement sera livré dans quatre semaines. Aucune importance. De quoi d’autre a-t-on besoin quand la lumière inonde le moment présent ? Quand la perspective d’une vie qu’on a choisie s’ouvre devant soi ? Il fêtera ses trente-et-un ans au sommet du piton des Neiges. S’il y arrive. Trois mille soixante-dix mètres, cela semble haut, même vu de loin.
Thomas a rejoint sa famille dans la cuisine. Les filles finissaient de manger des tranches d’ananas. Hélène buvait un café en feuilletant un catalogue de La Redoute.
— Tu veux un déca ?
À la vue d’une publicité pour des survêtements noirs, Thomas a eu un haut-le-cœur.
Il a repensé au ciel orageux de juillet, quitté quelques semaines plus tôt, à la lente disparition de l’été métropolitain qui laisserait bientôt place aux prémices de l’automne, puis à la triste installation de l’hiver, là-bas.
Il ne regrettait rien.
Même pas l’odeur des nuits d’été à La Baule, sous la canadienne avec Hélène, ni celle du romarin flottant au-dessus des barbecues, ni l’odeur des frites sur l’esplanade du camping, ni celle des Gauloises qu’ils fumaient, le soir, sur le ponton, avant que leur vie ne bascule à cause d’une « erreur ».
Il ne regrettait rien… jusqu’à ce qu’il découvre le visage de ses filles au retour de l’école.
*
Vendredi 18 août. Jour des premiers cours. La vraie rentrée.
— Qu’est-ce qui vous révolte ? a-t-il demandé aux élèves, à peine franchi le seuil de la salle. De quoi réveiller les Gavroche.
— La misère, la famine, a lancé une fille. La guerre, aussi.
— Le cancer, a ajouté une autre.
— Oui, a repris Thomas. Voilà des défis à relever. Mais plus personnellement, qu’est-ce qui vous ferait serrer le poing ?
Au fond de lui, l’écho du bois qui grince, éclate sous la pression d’un pied de biche et tombe en morceaux sur le carrelage.
— Les profs qui fument en cours.
Jean-François Chane-Teng a désigné les mégots dans la poubelle.
Un garçon a levé la main :
— Ce qui me révolte, c’est de ne pas pouvoir parler créole au lycée.
Un silence a enveloppé les élèves. Une bourrasque d’admiration, de courage et de pudeur, une bourrasque muette et audacieuse a soufflé sur les doigts levés, comme on éteint les bougies sur un gâteau d’anniversaire.
— Me faire attaquer dans la rue parce que je suis une fille, et ne pas réussir à me défendre, a ajouté une grande brune aux yeux clairs.
Une bouffée acide a brûlé la gorge de Thomas, un relent de la bile qu’il contenait depuis des mois, depuis que le procès l’avait foudroyé.
Coupable de coups et blessures volontaires.
Condamné à verser quarante mille francs de dommages et intérêts pour avoir défendu sa famille contre un cambrioleur en survêtement.
— Je vais vous parler d’un révolté qui travaille dans une mine, a-t-il repris. Il s’appelle Étienne Lantier. C’est le héros d’un roman d’Émile Zola.
Au tableau, il a écrit Germinal.
1973, 1974, 1975 ont défilé leurs chapelets de jours heureux. Il était loin cet après-midi de 1972 où Sophie et Natacha étaient rentrées de leur première journée de classe. Quatre années au soleil avaient tanné leur peau, blondi leurs cheveux et élargi leurs sourires.
Et elles ne disaient plus « La France ».
Depuis quatre ans maintenant, Thomas Lagrange arpentait le linoléum gris du lycée Roland Garros, le long du couloir du troisième étage.
Avec ses filles, il avait compris le créole plus vite qu’il ne l’aurait cru et la gentillesse naturelle de ses élèves le touchait toujours : « Monsieur, donne, mi porte vot sak. »
Parfois, le samedi, un sachet de samousa, bonbon koko, kol pistash l’attendait sur le bureau. Trop ému pour s’épancher, il murmurait merci. Sur le tableau, la craie zigzaguait en écrivant les alexandrins de Leconte de Lisle, loupait les boucles des « l », le temps qu’il reprenne ses esprits.
« Non loin, quelques bœufs blancs, couchés parmi les herbes,
Bavent avec lenteur sur leurs fanons épais,
Et suivent de leurs yeux languissants et superbes
Le songe intérieur qu’ils n’achèvent jamais. »
Un matin de décembre 1976, Thomas, assis dans le canapé de la varangue, a suivi à la radio l’atterrissage du Concorde à l’aéroport de Gillot. Dans l’île, la télévision, en noir et blanc, n’émettait que le soir, pour le journal parlé et le film quotidien. Sur les ondes, le président Giscard d’Estaing a prononcé une allocution : « Je voudrais vous demander […] de garder votre liberté de jugement […]. Les jeunes Français ont le droit […] de juger eux-mêmes leur avenir… »
Bercé par le ventilateur et le ronron du discours, l’esprit de Thomas, qui n’avait que faire de la politique, s’est mis à vagabonder, faisant défiler les images de la nuit précédente.
Suivant l’idée de Houssein, un professeur de physique, ils avaient décidé d’effacer l’inscription « Zorèy déor » sur le transformateur EDF. Accompagnés de Marie-Christine Arianatchy et de Jean-François Chane-Teng, ils avaient parcouru, dans l’après-midi, les rues du Tampon pour repérer les autres graffitis. Cinq en tout : un sur le transformateur EDF, près de la maison des Lagrange ; un à l’arrière du parking du lycée ; un sur le mur de la gendarmerie, en centre-ville ; un autre sur les gradins du stade, derrière les buts de football ; le dernier à l’entrée de l’École Militaire Préparatoire.
Au cours de la nuit, Houssein, en short et T-shirt, juché sur des parpaings, avait recouvert les tags de peinture blanche. Marie-Christine Arianatchy récupérait le pinceau, le trempait dans le pot et le lui rendait, pendant que Thomas et Jean-François Chane-Teng surveillaient les alentours. Ils avaient ri à l’idée de la tête que feraient les Tamponnais le lendemain matin.
Ils avaient laissé sécher la première couche avant de refaire le circuit. Cette fois, c’étaient Houssein et Marie-Christine qui faisaient le guet, pendant que Thomas et Jean-François écrivaient sur les murs : Malbar dédan, Zarab dédan, Zorèy dédan, Kréol dédan, Malgas dédan, Sinoi dédan, Kaf dédan, Yab dédan.
Alors que l’Est blêmissait, électrisant le ciel, ils avaient plié bagage…
La Marseillaise, ponctuant la fin du discours du président de la République, a fait sursauter Thomas.
Sophie et Natacha, en short et en savates, ont déboulé sous la varangue.
— Papa, t’es réveillé ? Tu avais promis de nous emmener voir le Concorde.
Trente minutes plus tard, la 4 L filait sur le bitume, doublait les sharèt bèf regorgeant de cannes à sucre.
« Mon Dieu, faites que la Corniche retienne ses roches », priait Thomas intérieurement. Il a accéléré pour franchir les dix derniers kilomètres au pied de la falaise. Il ne croyait en Dieu que lorsqu’il circulait sur cette route-là.
Devant l’aéroport, des centaines de véhicules bloquaient la départementale. D’autres saturaient le parking. Des gendarmes agitaient les bras comme des tourniquets débridés. Thomas a garé la voiture sur le bas-côté.
En jouant des coudes, les Lagrange se sont faufilés parmi les curieux jusqu’à la plateforme d’observation.
Devant eux, le plus bel avion du monde. Un supersonique. Le nez fuselé, la carlingue immaculée où ricochaient les rayons du soleil.
Les gens se bousculaient.
Des enfants grimpaient sur les épaules de leur père. Thomas tenait par la main Sophie et Natacha, ses deux petites zoréol aux savates roses.
- Fin du chapitre -

Tous les contenus du site internet de Lectivia sont protégés par la loi sur les droits d'auteur. L'utilisation, le partage ou la reproduction de toute partie du contenu sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur ou des ayants droits ou de Lectivia sera punis par la loi en vertu des règlements sur la violation du droits d'auteur et la propriété intellectuelle.

— Au fond de vous, vous le savez bien, a-t-elle lancé.
— Que suis-je censé bien savoir ?
— Que je ne vous aimerai pas, que je ne vous aimerai jamais.
— Et pourquoi ne m’aimerez-vous pas ? a demandé Antoine.
— Il y a dans l’amour cette chose indéfinissable qui fait que l’on sait si on aimera quelqu’un ou pas.
— Et quelle est donc cette chose qui fait que vous ne m’aimerez pas, puisque celle qui fait que vous pourriez m’aimer est indéfinissable ?
— Vous voulez vraiment le savoir ? a-t-elle insisté. Parfois, mieux vaut ne pas avoir de réponse à certaines questions.
Elle a regardé vers la passe, absente, vers les bateaux qui s’éloignaient dans le soleil couchant tant qu’il était encore temps.
— Peut-être que, lorsque vous me l’aurez dit, je regretterai d’avoir posé la question.
Un instant immobile, Antoine s’est tu, observant le dernier bateau de pêche qui entrait dans le port de Saint-Gilles et déchargeait une bonite. Elle faisait bien huit kilos, celle-là. Elle avait dû se faire prendre le long des tombants. C’était la loi de ce côté-ci de l’océan Indien, mieux valait croiser au large.
— Lorsque je tombe amoureuse de quelqu’un, j’aime tout en lui. De la couleur de ses cheveux à celle de ses chaussettes.
— Je ne porte pas de chaussettes. Par trente-huit degrés, personne n’en porterait.
— J’aime aussi sa manière de rire, de parler, les gestes involontaires qu’il fait pour se rassurer, j’aime le regard qu’il porte sur moi, j’aime ses mains qui parlent… qui me parlent…
Antoine a contemplé ses mains inertes et a souri.
— Je ne savais pas pour les mains.
— Vous voyez, tout à l’heure, dans la voiture, j’ai senti votre odeur.
— …
— Et je n’ai pas aimé, votre odeur.
— Vous êtes en train d’insinuer que je sens mauvais, s’est-il indigné.
— Non, il ne s’agit pas de cela. Vous avez une odeur corporelle, comme j’en ai une. Avec la chaleur, cette odeur… elle flotte dans l’air.
« Comme l’odeur d’un poisson crevé à la surface d’un aquarium », a-t-elle eu envie d’ajouter.
— Vous dégagez une effluence tiède, sucrée, un peu âcre et, vous m’excuserez, pour répondre à votre question, un peu rance aussi.
— Je sens le renfermé, c’est ça ? C’est bien ça que vous essayez de me faire comprendre ?
Antoine s’est mis à rire, sans qu’elle le suive dans son accès de jubilation.
La bonite a atterri sur le sol déjà éclaboussé de sang. La jeune femme a frissonné. Elle a lu l’inscription peinte en noir sur la coque de l’embarcation : Vré sipèk. L’idée qu’un bateau soit baptisé « sauterelle » l’a fait sourire. Son regard s’est absenté de nouveau. De nouveau, elle a oublié le port, les bateaux, le temps, Antoine. Un attroupement s’est formé : des touristes curieux, en short et sandales, la nuque rougie et les jambes blanches grêlées de piqûres de moustiques ; des habitués du port aussi, en savates et chemise à carreaux.
— Quand je suis amoureuse, a-t-elle repris, l’odeur de l’autre m’attire comme une phéromone. L’homme est un animal social, vous le savez. Social, mais animal.
— Donc, à cause de cette odeur, vous ne m’aimerez jamais ?
— Oui, c’est un signe.
— C’est sans appel ?
Elle s’est levée, sans répondre. Il a payé les boissons. Comme avec les autres. Sauf une qui, une fois, avait insisté pour payer : une jeune femme au teint caramel qu’il avait revue plusieurs fois avant qu’elle ne disparaisse.
Quand elle s’est avancée vers la voiture, quelque chose a surpris Antoine, mais cette impression s’est aussitôt estompée. Était-ce sa démarche ?
— Je vous dépose ? a-t-il proposé.
— Je ne sais pas.
— À cause de l’odeur ?
— Non, à cause de la bonite.
Elle a hésité puis a ouvert la portière. Tiens, elle était gauchère. Elle n’avait pas menti sur son âge comme l’avaient fait les précédentes. Une quarantaine d’années, c’est ce qu’elle avait indiqué dans son profil sur le site de rencontres. Pourtant, on eût dit qu’elle en avait vingt de moins tant son sourire juvénile le désarmait.
— S’ils la découpent sur le quai, j’en achèterais bien un morceau. Vous aimez le poisson cru ?
Le vent s’est levé. Le cyclone approchait. Ce n’était pas la tempête du siècle, même si une obscurité inquiétante recouvrirait bientôt la ville. Pour l’heure, une lumière jaune surréelle nimbait les quais, les silhouettes et les envies de bonite.
— Vous ne pouvez pas tomber amoureuse d’un inconnu, c’est cela ?
— Je peux tomber amoureuse d’un homme au premier regard, un beau brun ténébreux…
— C’est ma blondeur qui vous freine, alors ?
— Non, il n’y a rien qui me freine, c’est juste qu’il n’y a rien qui me porte vers vous. Cet élan inexplicable de l’amour, eh bien, je ne le ressens pas.
L’un des pêcheurs a décapité la bonite et il lui a ouvert le ventre pour l’éviscérer. Le sang a giclé. Les badauds se sont écartés. Trop tard, le liquide visqueux a maculé leurs jambes nues et dégouliné jusqu’aux tongs encore neuves.
— Suis-je le premier que vous rencontrez ?
— Non, il y en a eu d’autres.
— Et il y en aura d’autres, n’est-ce pas ?
— Si c’est vous qui le dites…
Le pêcheur s’est mis à découper le poisson.
La jeune femme s’est tournée vers Antoine.
— Que faites-vous à La Réunion ?
— J’y vis.
— De quoi vivez-vous ?
— Je suis vulcanologue, a-t-il expliqué. J’étudie le piton de la Fournaise. C’est un volcan-bouclier et, comme vous le savez, il est en éruption depuis des dizaines d’années. Et vous, quel est votre métier ?
— Oh, moi, j’analyse l’impact qu’ont les retombées radioactives de l’accident nucléaire de Fukushima sur les tortues vertes. C’est une espèce menacée, vous savez. Et je parcours le monde d’un océan à l’autre.
Domaine professionnel : recherche scientifique. C’est ce qu’il avait lu sur son profil et il s’était demandé de quoi il s’agissait.
— Vous n’êtes que de passage, alors ? a-t-il repris.
— Qu’est-ce que ça change ?
— Tout.
Elle a pris place dans la voiture, bien qu’elle ne manifestât aucune envie de partir. Elle a regardé tour à tour la passe, le port, les bateaux, la passe, le port, les quais. On eût dit qu’elle attendait quelque chose. Ou qu’elle s’attendait à voir autre chose. Quelqu’un, peut-être. Elle a sorti de sa poche une poignée de pastilles blanches. Des bonbons ? Elle ne lui en a pas offert, ce dont il ne s’est pas offusqué.
— Vous leur donnez toujours rendez-vous dans un bar sur la marina ? a demandé Antoine en désignant les alentours.
— Non, parfois au marché ou dans un parc, ça dépend du temps qu’il fait.
— Vous voyagez beaucoup ?
Elle ne lui a pas répondu. Sans doute la réponse était-elle évidente, sans qu’il sache pourquoi. Il a réalisé qu’il ne pourrait pas refaire sa vie ailleurs qu’ici, avec quelqu’un qui ne serait pas d’ici. Dans la voiture climatisée, un bref instant, Antoine a été saisi d’une sensation étrange, comme si quelque chose n’était pas à sa place. La jeune femme a porté une autre pastille à sa bouche et s’est mise à la sucer. Bruyamment. Ses yeux de panda, Antoine les avait vus sur les photos. Les yeux cernés des gens qui ne dorment pas assez ou qui dorment trop, peut-être.
— Je suis descendue à l’Hôtel Ylang-Ylang, a-t-elle indiqué.
— Celui qui donne sur l’esplanade ?
— Oui, près de l’Aquarium où vous m’avez attendue tout à l’heure.
— Ah oui, l’Aquarium… les océans… les tortues vertes…
Elle regardait au-delà de la vitre fermée, teintée. Profil compatible à dix-neuf pour cent. C’était dans la moyenne, ni extraordinaire, ni insignifiant. Antoine avait consulté les photos dix fois avant de se décider. Les yeux en amande, la peau mate, les cheveux en chignon ananas sur la tête. Il avait cliqué sur « flash ». Attendu. Cliqué sur « favori ». Attendu. Devant son absence de réaction, il avait fini par envoyer un message auquel elle avait réagi par un « Pourquoi pas ? » laconique.
— Sarah, c’est un pseudonyme ou votre prénom ?
— C’est mon prénom. Je m’appelle Sarah Hadrien. J’ai quarante-quatre ans, les cheveux châtains, les yeux marron, je mesure un mètre soixante-huit et pèse cinquante-huit kilos. Je suis divorcée, sans enfants, j’aime les chiens et je suis agnostique. Ah, j’oubliais, je suis gauchère.
Elle récitait un texte appris par cœur en jouant machinalement avec un bracelet bleu à ses initiales : S. H. Pas de sac à main, c’est cela qui manquait. Elle n’avait pas de sac à main. Voilà ce qu’Antoine cherchait depuis tout à l’heure. Voilà le détail qui le mettait mal à l’aise.
— C’est donc cela qui vous définit ?
— Quoi ? Gauchère ? Agnostique ? Divorcée ? Cinquante-huit kilos ?
— Non, le fait que vous aimez les chiens.
Il a ri. Il était bien le seul à trouver cela drôle. Il a démarré car même avec la climatisation et les vitres teintées, l’exposition au soleil était insoutenable et de nouveau l’odeur écœurante.
— Combien de temps resterez-vous à La Réunion ? a lancé Antoine.
— Cela dépendra de mes recherches. Si les tortues se montrent coopératives, la semaine prochaine je serai au Japon.
— Au Japon ?
— Oui, sur une île dont j’ai oublié le nom. Vous savez, les noms japonais…
— Sur la piste des tortues ?
— Oui.
S’il n’y avait pas eu cette odeur, cela n’aurait rien changé, il ne lui plaisait pas. Il ressemblait à celui qu’il avait décrit dans sa présentation, pas à celui qu’elle avait imaginé. Elle avait eu tort de venir à la rencontre de celui qu’elle avait vu sur les photos. Comment l’avait-elle imaginé ? Sans doute plus affirmé, plus viril. Moins blond. Moins obligeant. Ce qu’il n’avait jamais prétendu être. Profil compatible à dix-neuf pour cent. Il irait rejoindre les autres dans la collection, entre le joueur de tennis sur le retour, l’homme d’affaires pressé et le journaliste en révolte perpétuelle. Mauvaise pioche. Et cette odeur, c’était insupportable à la fin.
— Finalement, vous n’avez pas pris de bonite ? a-t-il demandé.
— Je n’aime pas le poisson.
— J’avais cru que…
— Ne me dites pas que c’est votre signe astrologique ?
— Non, je suis Verseau, vous avez dû voir que je suis né au mois de janvier.
— Oh, vous savez, la plupart des hommes mentent sur leur date de naissance.
— Pour se rajeunir ?
— Quel âge avez-vous ?
— Je vous l’ai écrit. Vous avez lu mon profil ?
— J’ai oublié. J’oublie tout, s’est-elle excusée.
— J’ai trente-sept ans.
— Mon père avait trente-sept ans quand il est mort.
— De quoi est-il mort ?
— Je ne sais plus. Il est mort, c’est tout.
Elle l’intriguait. « Il est mort, c’est tout. » Comment peut-on dire une chose pareille ? s’est-il dit, perplexe. Il n’était plus le même depuis qu’il avait perdu son père. Sa vision du monde en avait été bouleversée. C’était tragique et bête de mourir en haut du piton de la Fournaise, de glisser sur les scories, de s’empaler sur son propre bâton. La mort était absurde, si on l’écoutait. Alors il avait décidé de faire le sourd quand la mort l’appellerait.
Ils se sont tus, perdus dans le fil de pensées souterraines.
Le ciel jaunissait, le cyclone approchait.
Sarah a tressailli. Elle les avait vus. Deux hommes costauds en veste bleu ciel aux initiales de la maison de repos Le Songe des Hauts. Antoine les avait vus aussi, à peu près au même moment qu’elle.
Soudain il a compris les errances du discours, l’absence de sac à main, les médicaments (non, ce n’était pas des bonbons), les initiales S. H. sur le bracelet. Il a garé la voiture le long du bureau de la Marine de Saint-Gilles.
Il était presque dix-sept heures.
— Continuez, l’a-t-elle supplié dans un spasme, continuez. Vous ne devez pas me laisser là.
— Vous savez bien que je ne peux pas. Je sais que vous ne m’aimerez jamais. Et je ne sais même pas si vous êtes d’ici.
— Ne m’abandonnez pas, s’il vous plaît. Vous, vous m’aimerez.
Antoine a abaissé la vitre côté passager, la livrant au regard de ses geôliers.
— Madame Hoareau, ça fait des heures qu’on vous cherche partout, il faut cesser de vous enfuir comme ça. Surtout sans emporter votre bip. Un jour, on ne vous retrouvera plus.
Un paille-en-queue innocent a fendu l’azur.
Sarah s’est tournée vers son chauffeur d’un jour. Elle lui a pris la main. Il lui a souri, impuissant. Les deux hommes l’ont embarquée comme on embarque une récidiviste fantasque. Antoine a senti son cœur basculer dans l’eau froide où avaient atterri les morceaux de bonite.
Le cyclone se rapprochait de l’île.
- Fin du chapitre -

Tous les contenus du site internet de Lectivia sont protégés par la loi sur les droits d'auteur. L'utilisation, le partage ou la reproduction de toute partie du contenu sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur ou des ayants droits ou de Lectivia sera punis par la loi en vertu des règlements sur la violation du droits d'auteur et la propriété intellectuelle.

Sitôt entrée dans l’appartement, elle a fait glisser les fines bretelles élastiques de son soutien-gorge par-dessus ses épaules, sous son chemisier. Comme ses copines, elle avait la technique. Vingt ans qu’elle pratiquait ce geste tous les jours.
Pourquoi étaient-elles contraintes de porter cette espèce de ceinture qui comprimait le torse ? Qui avait, un jour, décidé que les femmes seraient forcées de s’emballer la poitrine dans un carcan de dentelle, qu’il pleuve, qu’il vente, ou qu’il fasse trente-cinq degrés à l’ombre ?
Toute la journée, la sueur avait dégouliné le long de son cou, puis sur son sternum, pour s’accumuler à la croisée des bonnets. Pas si sexy que ça. Si les hommes savaient ! En plus, ses seins pointus et fermes tenaient debout tout seuls.
Pourquoi les hommes avaient-ils le droit de se promener torse nu, et pas elles ? Est-ce qu’on les obligeait, eux, à camoufler la bosse qui pointait sous leur short ? Était-ce moins indécent ? Jamais elle n’aurait eu l’audace de dire tout haut ce qu’elle et ses amies pensaient tout bas, ni de sortir sans soutien-gorge.
Cependant, parfois, elle se demandait d’où venait cette honte inculquée aux jeunes filles.
À peine avait-elle franchi le seuil de son cocon, au premier étage de la Résidence de l’Océan, que son téléphone avait déjà bipé trois fois. Jamais tranquille. Olivia ne répondrait pas. Elle ne consulterait même pas l’écran. On était vendredi. Elle avait droit à la déconnexion du weekend. Et son patron des Caves du Capricorne ne faisait pas partie de ses projets, contrairement à ce qu’il imaginait.
Abandonnant le soutien-rien sur un des accoudoirs du canapé, elle s’est dirigée vers le réfrigérateur. Pas grand-chose à se mettre sous la dent. Un reste de cabri massalé pommes de terre, une moitié de mangue trop mûre, une cuillérée de rougail Dakatine racorni au fond d’une soucoupe. Elle n’avait pas fait de courses de la semaine. Ce soir, elle irait chercher des mines chez Tia-Song-Fat, ou des bouchons au camion-bar du coin de la rue. C’était l’avantage de vivre seule : on mangeait n’importe quoi, à n’importe quelle heure.
Elle a allumé l’ordinateur et lancé une liste de lecture sur Spotify.
« What if I don’t want to put on all that make up ? »
Alicia Keys.
Le maquillage, encore une invention d’homme. Le naturel, un confort refusé aux femmes.
« I’m so tired of that image,
What if today I don’t feel like putting heels on ? »
Que ces messieurs essaient les talons pour voir. En fredonnant, Olivia a retiré les escarpins dont les bords rigides lui meurtrissaient les chevilles du lundi au vendredi, de janvier à décembre, depuis presque dix ans.
Elle a attrapé les jumelles posées sur le rebord de la fenêtre du séjour, a relevé les stores de la baie vitrée et est sortie sur le balcon inondé de lumière.
En ce début d’hiver austral, les baleines à bosse croisaient au large de Boucan Canot. Des pêcheurs y avaient même aperçu deux baleines bleues, un événement.
Elle a scruté l’océan. Rien à l’horizon. Une mer plate, argentée comme une feuille d’aluminium en plein soleil. Trois heures. Elle a dirigé les jumelles un peu à droite, vers la splendide villa des Hakim. Elle s’amusait parfois à observer ses voisins à leur insu. Si, un jour, un crime était commis dans le quartier, qu’on vienne l’interroger, elle serait le témoin idéal.
Allongée sur un transat, au bord de la piscine, Soraya Hakim lisait sous un large parasol malgache, tandis qu’Augusta, leur vieille femme de ménage, passait la serpillère sous la véranda. Sur un séchoir, du linge voletait sous l’effet des alizés. Les polos Lacoste de Tarik se soulevaient à l’horizontale, effleurant les jupes de golf de sa femme, les chaussettes de football bleues de leur fils Waël et les paréos aux motifs de cases créoles.
À cette heure, le parasol projetait une ombre étrécie à côté de la chaise longue. Soraya s’est penchée sur son coude droit pour faire pivoter le mât en bois massif jusqu’à ce que le soleil n’atteigne plus un seul centimètre carré de sa peau claire. Elle a bu quelques gorgées d’un thé qui refroidissait dans un mug, sur la table basse en teck, et a repris sa lecture.
Au ralenti, un léger coup de vent a couché le séchoir dans l’herbe. Soraya s’est tournée vers la véranda où Augusta avait disparu. Ses soixante-dix kilos se sont redressés. Elle a enfilé ses savates rose coquillage pour protéger ses pieds du sol brûlant du deck et est entrée dans la villa.
Olivia connaissait bien le séjour, spacieux, sombre et propre, qui embaumait l’encens et le camphre. Un bar en acajou séparait la cuisine américaine de l’immense salle à manger. Carrelage italien, moulures au plafond, éclairage indirect. Elle imaginait la climatisation, presque silencieuse, distillant dans la pièce un air frais qui contrastait, sans nul doute, avec la chaleur qui, tous les après-midis, plombait le balcon de son appartement exposé plein sud.
Augusta terminait son service à quinze heures. Capeline vissée sur la tête, elle était en train de longer la Résidence de l’Océan pour rejoindre à pied le rond-point encombré de Bruniquel. Des klaxons mitraillaient le quartier à longueur de journée. Un Car Jaune ramenait l’employée à la gare routière de Saint-Paul où un bus Alternéo la déposerait dans les Hauts, en fin d’après-midi.
Olivia a pointé les jumelles un peu plus sur la droite, vers l’allée de scories où trônait le portail en fer forgé qui barrait l’accès à la propriété des Hakim.
Propriété privée, défense d’entrer.
Trois merles des Moluques au bec jaune sautillaient en piaillant sur le toit de l’Audi Sport flambant neuve que Tarik venait de s’offrir, aussi rouge que les Louboutin de Soraya, rapportées de Paris le mois dernier. Soraya n’échappait pas non plus au talon aiguille, quintessence de la féminité dans le regard des hommes.
Tarik était sûrement parti au bureau avec son associé, Alexandre. Ils travaillaient à Saint-Gilles-Les-Bains, dans une des sociétés du père de Tarik, un vieux grincheux que personne ne critiquait ouvertement tant qu’il arrosait la famille de dizaines de milliers d’euros. Les affaires marchaient, couraient même. Depuis plus de vingt ans, Bourbon Hakim Océan Indien régnait sans conteste sur le secteur du bâtiment.
Olivia a songé au repas d’anniversaire que Tarik avait organisé, quatre ans plus tôt, pour ses quarante ans. Elle avait livré des caisses de champagne tandis que le paternel déversait un discours complaisant :
— Maintenant que le Conseil d’administration a nommé mon fils directeur de BHOI, je peux envisager une retraite sereine, s’était exclamé le septuagénaire, levant sa coupe de Dom Pérignon aussi haut que le lui permettait son bras arthritique.
Du haut de son mètre quatre-vingt-cinq, Tarik avait toisé son père comme un héritier défie un patriarche autoritaire, une lueur de proche revanche pétillant dans ses yeux noirs.
L’heure de Tarik Hakim ne tarderait plus à sonner.
Beau comme un prince des Mille et Une Nuits, il avait la silhouette élancée, le teint mat, des cheveux noir de jais, les traits fins et réguliers de son père, un port de sultan. Il exsudait la confiance en soi, le charisme, et une légère impudence. Son seul défaut était d’être marié à Soraya depuis plus de quinze ans. Qu’est-ce qu’un type aussi exceptionnel trouvait à cette femme presque plus imposante que son portail ? Ses dix ans de moins ?
Soraya est ressortie dans le jardin, ses longs cheveux noirs dégouttant sur le caillebotis de la piscine. Secouant la tête, elle a relevé le Tancarville, vérifiant que le sol était à peu près stable dans l’herbe haute. Elle a remis en place les pinces à linge qui s’étaient détachées. Ses savates ont moucheté les planches sombres du deck d’auréoles humides parsemées de brins d’herbe.
Le transat a tangué lorsqu’elle s’est réinstallée.
Cela doit être dur de passer ses journées au bord d’une piscine, sans rien d’autre à faire que regarder les pailles-en-queue virevolter dans le ciel indigo, a ironisé intérieurement Olivia. Aussi dur que d’aller dépenser l’argent gagné par un mari plein aux as.
Flâner dans les magasins de luxe à Saint-Denis, prendre rendez-vous chez le coiffeur un jour sur deux, se détendre dans un salon de massages ou un spa cinq étoiles, boire des cocktails à la terrasse d’un lounge sur le port de Saint-Gilles, dîner dans des restaurants gastronomiques et se faire raccompagner par un chauffeur en livrée, Olivia en rêvait.
Carte blanche avec la carte bleue d’un autre !
Au fond de la propriété des Hakim, vrombissait le souffleur à l’aide duquel le jardinier rassemblait les feuilles mortes sur une bâche grise qu’il traînerait ensuite jusqu’à la benne réservée aux déchets verts. Il nettoyait les hibiscus, en contrebas du putting green où, certains dimanches, Tarik et Waël s’évertuaient à améliorer leur handicap de golf. Olivia enviait la douceur de vivre qui berçait les journées de sa voisine.
Un mouvement sur la gauche a attiré son attention. Elle a recentré les jumelles sur l’appartement d’Alexandre, ancien collègue, ancien amant, nouveau voisin.
Six mois plus tôt, il avait emménagé de l’autre côté de la rue, dans un appartement au premier étage qui faisait face à celui d’Olivia. Trop tard, elle s’était déjà lassée des soirées en duo, verre de vin et risotto. Le mouvement venait de plus bas. Elle a réglé la mise au point sur le balcon du rez-de-chaussée.
Accroupi derrière la haie de duranta qui bordait la route, Waël était en planque. Il essayait discrètement de se débarrasser d’un chien en train de renifler son bermuda. Qu’est-ce que le fils de Tarik et Soraya fabriquait à cet endroit-là, à cette heure-là ? Olivia a de nouveau orienté les jumelles vers Soraya.
Assise sur la margelle de la piscine, les pieds dans l’eau, Shéhérazade gesticulait en parlant au téléphone. Une robe courte à fleurs mauves moulait les trois bourrelets de son ventre, empilés l’un sur l’autre comme les galets d’un cairn. Olivia a rentré son ventre et tiré sur son chemisier pour décoller le tissu de son corps moite. Une fraction de seconde, elle a pensé que Soraya était grosse, puis s’est corrigée.
À une époque où l’on réécrivait les textes d’Agatha Christie, où on « lavait » les mots, ne devait-elle pas éplucher son vocabulaire ? Remisés les « vieux », « gros », « handicapé ». Place aux euphémismes censés éradiquer l’étroitesse d’esprit. Mais personne n’était dupe. Ce n’était plus le poisson que l’on noyait, c’étaient des baleines entières.
De nouveau, Olivia a balayé l’océan face à elle, à la recherche des cétacés. Rien ne venait troubler la ligne parfaite de l’horizon. Sur la plage, des dames à l’âge avancé se promenaient, main dans la main, le long du rivage, les pieds léchés par les vaguelettes.
Quand elle aurait soixante-dix ans, elle aussi marcherait sur le sable, toute de blanc vêtue, comme ces vacancières déambulant, hors saison, dans les rues de Saint-Gilles après les cours de yoga qui fleurissaient sur les plages.
De l’autre côté de la mer, loin, très loin, à des milliers de kilomètres, un territoire qu’elle aimait bien, où pourtant elle ne pourrait pas vivre. Un territoire de champs tachetés de coquelicots, de marais rouges, de villages aux toits de tuiles et aux volets clos, de ruelles désertes, été comme hiver. Un territoire aux quatre saisons, où elle était née, mais dont elle n’avait que peu de souvenirs.
La Camargue.
Salin-de-Giraud.
Elle bénissait ce jour de 1998 où une fée inspirée l’avait déposée à La Réunion d’un coup de baguette magique. Elle avait sept ans.
Les jumelles sont revenues se positionner sur Waël. De là où il se trouvait, il ne pouvait apercevoir ni sa mère ni Olivia. Avec précaution, il a escaladé la balustrade du rez-de-chaussée et a agrippé le rebord de la fenêtre de l’appartement d’Alexandre sous laquelle il s’était glissé. La sueur ruisselait sur son visage, mouillant le haut de son T-shirt Quiksilver. Olivia a dirigé les jumelles vers la fenêtre. Le soleil heurtant la vitre l’a aveuglée. Elle est revenue sur le garçon. Il s’était redressé et avait collé son visage rond contre la baie vitrée.
Qu’est-ce que Waël allait faire chez Alexandre ? Vérifier quelque chose ? Récupérer quelque chose ? Voler ?
Sur la paroi de verre, une trace de buée a dessiné un cercle. Sans se retourner, Waël a maugréé en agitant les mains après le chien qui jappait en dessous de lui et menaçait de faire capoter son plan. L’animal a relevé la truffe, secouant la queue de contentement. Une sorte de jouet allongé, en plastique bleu marine, pendouillait entre ses dents. Olivia a éternué. Le parfum du géranium qui montait du rez-de-chaussée lui irritait les narines. Elle avait demandé à son voisin de l’enlever. Mais il mettait plus de temps à réagir que lorsqu’elle avait laissé tomber son slip de bain sur le balcon de l’étage inférieur.
Soudain, les rideaux de l’appartement d’Alexandre ont bougé légèrement, attisant le voyeurisme insatiable d’Olivia.
Aussitôt, Waël s’est reculé, en équilibre sur la rambarde. Malgré elle, Olivia a retenu son souffle. L’ordinateur avait cessé de diffuser la musique. Le bloc extérieur du climatiseur déglingué d’Alexandre ronronnait au-dessus de la tête de l’adolescent. Olivia a fouillé la rue du regard, à la recherche de la voiture d’Alexandre. Pas de Mercedes noire. D’un bout à l’autre de la rue, une enfilade de pare-brise étincelants bordait les trottoirs.
À droite, Soraya avait repris sa lecture. Un roman de John Grisham : L’infiltré. Olivia enviait aussi sa tranquillité d’esprit. Si seulement elle pouvait prendre sa place ! Pas de course échevelée en escarpins pour débouler à l’heure au bureau le matin, dûment maquillée et parfumée. Pas de comptes d’apothicaire au moment de régler les factures. Pas de linge sale débordant du panier, rien qui dépasse.
Une maison modèle.
Un mari modèle.
Un fils modèle.
Une vie modèle.
Ou presque.
En face, alors que Waël s’était de nouveau hissé jusqu’à la fenêtre, un rictus a soudain déformé le visage du collégien. Ses mains ont lâché le rebord en béton et il est tombé dans l’herbe en criant :
— J’en étais sûr. Ils avaient raison au collège.
Le chien est revenu se frotter contre le gamin qui lui a aussitôt décoché un coup de pied dans l’arrière-train. Dans la gueule de l’animal, Olivia a reconnu une des chaussures bateau TBS bleu marine qu’Alexandre mettait quand il embarquait sur le catamaran de Tarik pour des dimanches de voile.
Sans femme ni enfant.
Au large.
Entre hommes.
Au pied des arbustes, Waël a ramassé une pierre qu’il a lancée de toutes ses forces sur la vitre qui a volé en éclats.
Olivia a visé l’échancrure laissée par les rideaux légèrement écartés et a fait tourner la molette des jumelles pour grossir le plan. D’abord flous, puis de plus en plus nets, Alexandre et le beau Tarik, le corps nu luisant de sueur et les cheveux en bataille, étaient en train de se rhabiller.
En contrebas, le chien agitait toujours la queue dans un mouvement crétin de contentement perpétuel.
Sur le deck de la maison voisine, Soraya, étendue à l’ombre sur une épaisse serviette turquoise, un casque sans fil sur les oreilles, dodelinait de la tête en tapotant en rythme les montants du transat.
Dans les jumelles, au large, une gerbe blanche a crevé la surface, projetant dans l’air limpide un panache de gouttelettes irisées. Un dos puissant gris foncé a fendu l’horizon puis, dans une lente ondulation, a disparu dans les profondeurs, la queue fouettant l’eau dans une éclaboussure géante.
La vie continuait, simple et tranquille.
D’une incroyable légèreté, presque absurde.
- Fin du chapitre -

Tous les contenus du site internet de Lectivia sont protégés par la loi sur les droits d'auteur. L'utilisation, le partage ou la reproduction de toute partie du contenu sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur ou des ayants droits ou de Lectivia sera punis par la loi en vertu des règlements sur la violation du droits d'auteur et la propriété intellectuelle.

Trois heures du matin.
La nuit avalait les heures où il aurait dû être endormi, à rêver qu’il escaladait les Trois Salazes ou qu’il redescendait en courant du piton des Neiges.
Merde !
Trois heures.
De l’autre côté du lit, le réveil le narguait. Lui tournant le dos, il a recouvert ses jambes du drap rêche tout en sortant les orteils au bout du matelas. Il n’aimait pas avoir les pieds coincés sous la couette.
Si, d’ici trente minutes, il était toujours là à fixer la pénombre comme un aveugle les étoiles, il allumerait son téléphone et, comme presque chaque nuit, il ferait défiler l’actualité à La Réunion, dans l’Hexagone, et jusque dans le monde entier. Quand il aurait terminé avec les mauvaises nouvelles de la planète, il réitérerait l’opération sur Facebook et Instagram.
Ce n’est pas ça qui l’aiderait à retrouver le sommeil, mais au moins, quand il aurait scrollé toutes ces pages inutiles, le jour se lèverait enfin.
Et lui avec.
Pascalin a repensé à la première fois qu’il avait entendu ce mot. C’était son fils qui l’avait prononcé : « Arrête de scroller, papa ! » Pascalin était installé au volant de sa Méhari, à attendre que son adorable fiston ait fini de se coiffer et de se recoiffer devant le miroir du pare-soleil.
Sur le moment, Pascalin l’avait regardé, perplexe.
— De faire quoi ?
— De scroller.
— Qu’est-ce que ça veut dire ?
— Faire défiler des pages sur un écran avec ton doigt. Démarre. À cause de toi, je vais être en retard au collège.
Trois heures sept.
La nuit prenait son temps. Cela faisait des jours que Pascalin ne dormait plus. Des semaines. Il avait épuisé toutes les recettes : des tisanes de camomille au bol de lait chaud avant de se coucher, en passant par le comptage méthodique des moutons et les exercices de respiration.
Parey bèf moka dann pant Bélèr…
Il avait fini par adopter une solution radicale : un soir, il avalait un anxiolytique ; le lendemain, un somnifère ; le troisième soir, un verre de vin, du rouge, du bon de préférence, et le quatrième, il recommençait le cycle. Cela marchait plus ou moins. Il s’endormait facilement. Mais, à trois heures pétantes, son horloge biologique sonnait le clairon.
Il a résisté à l’envie d’allumer. Surtout pas. Il grillerait le peu de chances qu’il lui restait de, peut-être, s’assoupir sans s’en rendre compte.
Roulé en boule au pied du lit, un chat sans nom ronronnait, inconscient du conflit qui se jouait sur les oreillers. D’un balayage de la main sous le sommier, Pascalin a vérifié que son Samsung était bien posé sur le carrelage refroidi par la fraîcheur des nuits de mai.
Par les vieux nako de la salle de bains, l’hiver austral s’infiltrait dans la case. Pascalin avait renoncé à colmater les fissures. De jour en jour, la température dégringolait.
Qu’est-ce qui l’empêchait de dormir ?
Il avait un toit, un boulot, le ventre plein, des amis, une femme à l’occasion. À trente-huit ans, il était en parfaite santé. Il jouait au volley le mercredi, au foot le samedi. Il avait un fils, un weekend sur deux. Comme tout le monde.
Il lui avait suffi de voir son frère se débattre avec ses trois marmay pour lui ôter toute idée d’en avoir d’autres.
Plutôt solitaire, il organisait sa vie selon son bon plaisir, ou ne l’organisait pas. Personne pour juger du temps qu’il passait sur Internet ou devant la télévision, pour calculer le nombre de bières Dodo qu’il ingurgitait le samedi ou vérifier s’il avait revissé le bouchon du tube de dentifrice.
Il a regardé le réveil.
Trois heures douze.
Il avait soif. Il a attrapé la bouteille d’Edena sur la table de chevet en évitant de toucher l’assiette où, sans nul doute, des fourmis nettoyaient les restes de son repas de la veille : un carri de poulet acheté au gîte Mussard, un peu plus bas dans la rue. Le long de sa gorge, le liquide a gargouillé en cascade. Son cou s’est tour à tour serré, puis dilaté pour déglutir. Dans l’obscurité, les sensations étaient vives. On entendait tout, on percevait tout. L’eau avait un drôle de goût, un goût de moisi.
Dans le silence de la chambre, son téléphone a bêlé. Deux bêlements de cabri. Un message de son frère installé dans l’Hexagone. Avec le décalage horaire, il n’était qu’une heure dix, là-bas. Il a souri. Attribuer des cris d’animaux au numéro de téléphone de son aîné, c’était une petite revanche. Signe distinctif du frangin : tignasse blonde qui tenait plus de la toison du mouton que de la crinière du lion. Quand Bertil passait la main dans ses cheveux, ses doigts restaient coincés dans les nœuds. Pascalin, lui, avait la coupe militaire : cinq millimètres de duvet noir couraient sur son crâne.
Qu’est-ce que Bertil lui voulait encore ?
Ils s’étaient parlé la veille. Cinq minutes, une fois par trimestre, suffisaient à passer en revue leur existence. À part le fait qu’ils ne se coiffaient pas, ils n’avaient pas grand-chose en commun, ou plus grand-chose. Il n’était rien arrivé pour les éloigner l’un de l’autre, mais rien non plus pour les rapprocher. Ils étaient différents et s’en accommodaient. Avec le temps, leurs enfants avaient grandi. Les réunions familiales s’étaient espacées, sans bruit ni fureur. Maintenant que leurs parents s’en étaient allés, dix mille kilomètres et onze heures de vol leur servaient de prétexte à une fausse impossibilité de se voir.
Ils étaient frères, de loin.
De plus en plus loin.
De moins en moins frères.
Pour Bertil, le bonheur, c’était toujours ailleurs.
Pour Pascalin, c’était d’ouvrir le matin les volets de bois et de prendre dans la figure les remparts de Cilaos, verdoyant dans l’ombre, couronnés du ciel immaculé de l’aube, tandis que les vaches meuglaient dans le Cirque.
Ici.
Trois heures dix-sept.
C’est ce bouquin, aussi, qui m’a mayé les neurones. Cette violence innommable, cette boucherie. J’irai jamais en Afrique. Faut être inconscient pour naviguer au large de la Somalie.
Il venait de terminer L’équation africaine de Yasmina Khadra, roman emprunté à la bibliothèque municipale la semaine précédente. Pascalin adorait lire, affalé sur le vieux canapé en skaï rouge de la terrasse, face à la paroi rocheuse qui protégeait le village retranché. Lire, gravir les montagnes.
Un calcul rapide : encore treize minutes avant trois heures trente.
Cela promettait d’être long. Treize minutes à réfléchir. Comment se rendormir en sachant que plus il activait son cerveau, plus celui-ci se cramponnerait à n’importe quelle idée qui passerait par-là ?
À tâtons, Pascalin a débranché la prise antimoustique qui saturait la pièce de l’odeur de citronnelle. À cette saison, les derniers insectes battaient en retraite. La facture d’électricité du mois d’avril avait été salée. Il fallait qu’il fasse attention.
Trois heures vingt.
Et cette fille dans le Duster ! On aurait dit qu’elle pleurait.
D’un geste de la main, elle l’avait invité à passer au stop de la rue de l’Embarcadère à L’Étang-Salé, à midi.
Et moi qui cale, comme un con. En plein carrefour. En pleine heure de pointe.
Il avait eu du mal à relancer sa vieille Méhari.
Saleté de bagnole.
À Cilaos comme partout dans l’île, il n’était pas rare qu’on laisse passer des véhicules bloqués à un stop. Pascalin pratiquait souvent cette courtoisie typique et originale qui faisait office de priorité. La plupart du temps, le conducteur reconnaissant agissait de même, à son tour, un peu plus loin. Pascalin croyait à l’effet boule de neige de la bienveillance.
Il n’avait jamais vu la neige, hormis sur les photos envoyées par Bertil. Son frère l’inondait de clichés : Bertil au ski, sa peau mate contrastant sur le jaune goyave de l’anorak ; Bertil à Paris, ébouriffé devant la tour Eiffel, sourire en tranche papaye ; Bertil aux champignons, à l’automne, en veste kaki ; Bertil à la chasse, sourire en tranche longani, minuscule, la chasse avait dû l’effrayer.
Trouillard.
Toujours à vouloir prouver quelque chose.
Quoi ?
Qu’il était le plus audacieux des deux, lui qui claquait des dents au bord de la moindre falaise. Bertil en était encore là.
Bertil devant des caméras en train de bat karé bordmèr en Normandie, au Pays basque ou sur la Côte d’Azur.
Bertil était partout.
Il prenait de la place.
Il avait toujours pris beaucoup de place.
Beaucoup trop.
Un peu comme le linge sale qui, au fur et à mesure, s’accumulait derrière la porte, envahissant l’espace de la chambre, jusqu’à ce que Pascalin n’ait plus rien à se mettre et se décide à porter le tout au Lavomatic du centre-ville.
Pascalin avait l’impression d’avoir déjà vu la fille au Duster. À la pharmacie ? Il travaillait à celle de La Rivière-Saint-Louis. Ou au stade de Bras Sec ? Ou encore à la sortie du collège ? Peut-être la jeune femme avec laquelle il avait partagé quelques nuits dans les Bas, le mois précédent. À vrai dire, il ne s’était guère attardé sur le visage de la tantine à ce moment-là. Elle avait d’autres atouts.
Trois heures vingt-huit.
Il ne tiendrait pas plus longtemps. Inutile d’attendre, il ne se rendormirait pas. Il le savait. Il le savait depuis le début.
Il a attrapé son smartphone. D’une pression sur le côté, il a rallumé l’écran dont l’éclat bleuté a jailli comme une présence rassurante. Il a composé son code à quatre chiffres et s’est engouffré sur le portail de Clicanoo.
Du procès d’un conjoint meurtrier, au Tampon, à la campagne « Nuits sans lumière » pour sauver les pétrels de Barau, il a scruté l’actualité locale avant d’être aspiré par les nouvelles aussi peu réjouissantes de l’Hexagone déchu : flambée des prix, trafic de crack, détournements de fonds, mouvements sociaux, réchauffement climatique, comment remplir sa déclaration d’impôts, comment perdre du poids ou bien dormir. Il a tout parcouru.
I-nu-ti-le.
Quatre heures vingt.
Il a surfé sur Google Actualités : la guerre en Ukraine, une énième tuerie de masse aux États-Unis, une autre en Serbie, la déportation des Ouïghours en Chine, la menace d’El Niño.
I-nu-ti-le.
Sauf pour grignoter quelques quarts d’heure sur la nuit.
Quatre heures cinquante-cinq.
Monde de fous.
Il a atterri sur Facebook.
Depuis le décès de ses parents, il s’était abonné au compte d’un médium qui affichait quotidiennement des contacts avec des défunts.
Ce matin, le voyant décrivait Francis, mort d’un cancer à cinquante-deux ans. Salopette d’ouvrier, boucle d’oreille en forme de serpent, paquet de Gitanes dans une main, fer à souder dans l’autre. Francis embrassait Josette, lui conseillant d’arrêter de pleurer et de refaire sa vie.
Pascalin était sceptique. Mais s’il existait des gens capables d’entrer en contact avec les disparus, ce serait dommage de passer à côté. Il a déroulé le fil d’actualité à la recherche des prénoms de ses parents.
Une chance sur des millions.
Ni Denis, ni Anne à l’horizon, bien sûr.
Qu’ils reposent en paix.
Lorsque sa famille était arrivée à La Réunion en 1987, Pascalin avait deux ans. Il n’en avait gardé aucun souvenir. Ses parents ne s’étaient jamais montrés très bavards sur le sujet. L’histoire familiale gisait maintenant dans une tombe à La Rivière-Saint-Louis. Les garçons savaient qu’il y avait eu un incendie. En une nuit, leur maison dans le nord de la France était partie en fumée.
Alors, les Turpin avaient pris un nouveau départ, loin, très loin. La mère de Pascalin avait un vague cousin à l’île de La Réunion, à Saint-Louis. Il n’en avait pas fallu plus pour entreprendre le voyage.
Un pop-up s’est affiché sur son compte Facebook : Jetecherche.fr. Par curiosité autant que pour brûler les heures, Pascalin a cliqué sur la publicité. C’était amusant. Des gens s’évertuaient à en retrouver d’autres. Vingt-trois nouvelles publications sur ce profil depuis la veille. Cent soixante-dix-huit mille membres dans ce groupe créé en janvier 2013.
« Je cherche Clothilde, ma meilleure amie de l’école primaire dans la classe de madame Archambaud, à Pont-à-Mousson, en 1995. »
Pascalin n’avait jamais rencontré de Clothilde. Ou peut-être dans Astérix ? Il ignorait où se trouvait Pont-à-Mousson.
« Qui connaît Marie-Rose Leblanc, fille de Lucie, née à Angers ? Elle doit avoir cinquante ans environ maintenant. »
« Depuis que j’ai appris que je n’étais pas le fils de mon père, je rêve de rencontrer mon géniteur. Ma mère se nomme Élisabeth Gros. Je suis né en Ardèche en 1994. Mes parents se sont rencontrés en Espagne, pendant des vacances d’été. Mon père biologique s’appellerait David. Il était informaticien. »
« Eh ben, bonne chance pour trouver l’aiguille dans la botte de foin », a pensé Pascalin.
Dehors, une pluie forte, très forte. Elle tapait le sol comme un régiment défilant au pas cadencé. La tôle grinçait, piaulait sous la bourrasque. Aussi brusquement qu’elle était arrivée, l’averse s’est tue, laissant place au chuintement du toit qui s’égoutte, aux craquements des tôles réveillées par le soleil.
« J’aimerais retrouver un copain, Guy Parent, qui était avec moi au service militaire, en 1974. Il m’a sauvé la vie. Il a soixante-dix ans. Nous avions participé à une mission sur Dortmund, le dix-huit février. »
« Si le nom Jehan de Brenne vous dit quelque chose, contactez-moi. Merci d’avance. »
Des centaines de commentaires et de photos jaunies accompagnaient les publications. Parfois, on avait localisé les gens, parfois les tombes. On donnait des pistes, des indices, des dates. On compatissait, on encourageait, on questionnait, on remerciait. Des internautes dénonçaient parfois des atteintes à la vie privée.
« Vous n’avez pas le droit de mentionner le nom de mon frère. Veuillez retirer le portrait que vous avez posté. »
Pascalin a déroulé des dizaines de visages plus ou moins flous, des textes. En quelques lignes des histoires s’écrivaient, des liens se nouaient, se renouaient. C’était incroyable. La vie surgissait de l’oubli, comme par magie, d’une simple phrase, d’un prénom.
« Ce “petit garçon” a maintenant trente-sept ans. Il est père de deux enfants. Il travaille avec moi au Gamm Vert de Laval et habite Allée des Déportés. »
« Il y a un François Marie-Broche employé par la commune de Peyrehorade. Vous pouvez le contacter sur Facebook. Son profil est Frncs Mr-Brch. »
Pascalin a oublié l’heure, l’insomnie, jusqu’à la fille au Duster.
De ses rayons blancs, le soleil du matin a criblé les volets mal ajustés. Pascalin parcourait les pages comme on parcourt les rues d’une ville inconnue, à la recherche de rien, s’attardant sur une histoire saugrenue ou des retrouvailles improbables, savourant le plaisir de voir des quêtes aboutir contre toute attente.
La réalité, c’est bien connu, dépasse la fiction.
Nul besoin d’être vraisemblable.
Ici, la logique volait en éclats.
Pascalin s’efforçait de rester rationnel. En théorie, c’était possible, bien sûr, mais quelle était la probabilité pour qu’un Jean-Jacques de Lyon mentionné par une Madeleine de Lille puisse être retrouvé par des internautes ?
Il était là à scroller, perplexe, quand, tout à coup, deux prénoms ont écorché son regard, comme écrits en relief.
« Pascal et Bertrand »
Dans la pénombre, sa vision s’est un instant brouillée. Un autre nom a surgi : « Mathilde », et quelques mots perdus dans le message : « incendie, adoption, cheveux blonds ». La lumière crue léchait l’écran. Pascalin a changé de position. Son cœur menaçait de défoncer sa poitrine.
C’est quoi c’délire ?
D’une main tremblante, il a posé le téléphone sur le lit, a allumé le plafonnier et a grossi l’affichage. Ses yeux ont réussi à faire une mise au point correcte sur le texte :
« À la suite d’un incendie qui a coûté la vie à mes parents, dans le Pas-de-Calais, il y a presque trente ans, j’ai été placée en famille d’accueil. Mes frères de deux et quatre ans, Pascal et Bertrand, ont été proposés à l’adoption. Je les cherche depuis quinze ans. Bertrand a la peau mate, des cheveux blonds épais et des yeux verts. Pascal, blond aussi, a une mince cicatrice horizontale sur le menton. Je n’ai pas de photos. Mes souvenirs sont vagues. Ils ont aujourd’hui trente et trente-deux ans. Je lance une bouteille à la mer. »
La fameuse aiguille dans la botte de foin, elle était là, devant lui, à lui crever les yeux.
La chance sur un million.
Au fil des huit années écoulées depuis la parution du message, il avait été peu commenté. Quelques « Bon courage, Mathilde. », « Vous allez bien finir par les retrouver ».
Instinctivement, Pascalin a tripoté le minuscule bourrelet disgracieux qui lui ridait le menton. Une chute de vélo quand il avait trois ans. Enfin, c’est ce qu’il croyait.
Il a relevé la tête. Le jour avait envahi le ciel. Son corps tout entier s’est mis à trembler. Il avait froid, mais nulle envie de se blottir au fond du lit. Il a jeté un coup d’œil à l’éphéméride suspendue à un clou, au-dessus de la table de chevet.
Mardi 16 mai 2023.
Ça, c’était la réalité. La réalité d’hier.
Il n’était pas fou.
Il s’est levé et a vérifié dans le miroir que ses cheveux étaient aussi noirs que la veille.
À sept heures, il a appelé son patron, à la pharmacie. Il n’irait pas travailler.
Toute la matinée, son esprit a remué les centaines d’idées qui affluaient. Il a touillé le mélange dans tous les sens. À midi, la mixture s’était décantée.
Qui était-il vraiment ?
D’où venait-il ?
C’était où le Pas-de-Calais ?
Il imaginait du brouillard, des moules-frites, de la bière.
Il a pensé à Bertil.
Devait-il le prévenir ? L’arracher à ses rêves éveillés ?
La Normandie, est-ce que c’était dans le Pas-de-Calais ?
Tout à coup il a réalisé que, si Bertil avait quatre ans à l’époque de l’incendie, alors il savait pour l’adoption. Forcément. À quatre ans…
Il n’aurait rien dit ? Pendant plus de trente ans ? Est-ce pour cela qu’il ne rêvait que de partir ailleurs ?
De repartir ?
En Pascalin, tout se mélangeait.
Ou peut-être que tout était mélangé depuis longtemps.
Un peu d’ici, un peu de là-bas. Ou plutôt, beaucoup d’ici, un peu de là-bas.
Rencontrer Mathilde ?
Qu’est-ce que cela changerait ?
Mais il n’était pas blond. Et il avait trente-huit ans.
Il a ouvert les volets.
La fenêtre du salon donnait sur l’église bleu et blanc inondée de soleil. Au fond, la route en lacets montait vers la forêt de cryptomérias et le départ des sentiers. Les camions qui acheminaient les matériaux de construction klaxonnaient dans les virages. En contrebas de la rue, dans la cour du gîte Mussard, des draps roses à carreaux séchaient sur une corde à linge. Sur une grande table en bois, des Zoizo-la-Vierge se régalaient des restes du déjeuner de grimpeurs qui avaient déjà filé sur Fleurs Jaunes, à l’assaut de la Crête des Mohicans.
Une porte s’ouvrait, que Pascalin s’empresserait de refermer.
À quoi bon ?
À quoi bon rectifier le destin ?
Il n’avait envie d’aller nulle part. Nulle part ailleurs. Et encore moins de douter le reste de sa vie.
Il n’était pas Bertil.
Il avançait, lui, et pas seulement en photo.
Il n’était pas Pascal non plus.
Il ne le serait jamais.
Il était Pascalin.
Pascalin Turpin.
Et fier de l’être.
Il a reculé, trébuchant sur son bertèl ouvert près de la porte. Oui, c’est ça qu’il était, un gars des Hauts qui randonnait en savates-deux-doigts et doublait, sur les sentiers, les touristes rouges et haletants. Un gars qui appréciait les choses simples.
Peu importait qu’il soit né ici ou ailleurs.
Il aimait le vent qui gonflait son T-shirt, quand il surgissait en haut du Taïbit, même pas essoufflé. Il aimait le soleil et la pluie tropicale qui avaient tanné son visage et sa cicatrice au menton. Il aimait la cascade de Bras Rouge et le fond sombre du canyon de la Chapelle.
Qu’est-ce que ça pouvait bien faire qu’il ait une sœur inconnue, ou même dix, dans le Nord de la France ou au fin fond de la Chine ? Il n’avait pas besoin de sœur. Il avait assez à faire avec un frère.
Il est sorti pieds nus dans la cour et a fixé les montagnes qui l’encerclaient comme un bouclier. La terre mouillée se glissait en petits boudins entre ses orteils. À la croisée des montants d’un poteau électrique, un bib tissait sa toile. Il a pissé sur les fourmis au pied du tamarinier.
Il n’y aurait pas de dilemme.
Il est rentré dans la case et a éteint le smartphone. Il a enfilé ses savates et mis son bertèl sur son dos.
Aujourd’hui, il monterait à la Caverne Dufour par Bras Sec.
- Fin du chapitre -

Tous les contenus du site internet de Lectivia sont protégés par la loi sur les droits d'auteur. L'utilisation, le partage ou la reproduction de toute partie du contenu sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur ou des ayants droits ou de Lectivia sera punis par la loi en vertu des règlements sur la violation du droits d'auteur et la propriété intellectuelle.

— Allez Sylvano, vas-y, demande-lui.
En short et débardeur, Jean-Eudes, le grand-père de mon copain Sylvano bricole toujours dans sa cour le dimanche après-midi. Sylvano et moi, on aime bien discuter avec lui. Moi, j’habite de l’autre côté de la rue, en face de la case des grands-parents de Sylvano. Leur maison est haute et blanche, avec un étage qui surplombe la ravine Sèche à l’arrière, un toit plat et des fenêtres à petits carreaux. Comme ses parents travaillent dans un restaurant à Saint-Pierre, mon copain y passe les weekends. Lui et moi, on s’ennuie le dimanche, la rue se vide, alors on traîne dans le quartier.
— J’ai pas envie, Jimmy.
— On a tiré au sort, t’as perdu, c’est toi qui dois le faire. Tu te dégonfles ?
En parlant, on s’est approchés de Jean-Eudes. Sylvano a pris son courage à deux mains.
— Papi, il te reste combien de temps à vivre ? lui a-t-il demandé en me regardant bien droit dans les yeux.
Moi, je fixais les bras de Jean-Eudes. Ils sont musclés et bronzés, mais le haut est tout blanc parce qu’il est pêcheur. Le soleil lui brûle la peau et on voit la marque que laisse le T-shirt qu’il porte sur son bateau. Je n’aimerais pas être pêcheur, je préférerais vendre du poisson dans une boutique.
Étonné, le gramoune a lâché les outils sur l’herbe. Les enfants posent de ces questions ! Il a enlevé son chapeau de paille et a passé la main sur le dessus de son crâne, puis il a remis son chapeau. Il réparait le baro, le portail que la mamie de Sylvano avait embouti la veille avec sa voiture qui n’avait plus de freins.
— Je ne sais pas. Il n’y a pas de règle, a répondu Jean-Eudes.
— Oui, mais t’es vieux quand même. T’as plus de cheveux. Jimmy dit que tu vas bientôt mourir.
Jimmy, c’est moi. Je suis au CE1.
— J’ai soixante-quinze ans, mais ça ne veut rien dire. Parfois, des jeunes partent avant, dans un accident, par exemple. D’autres se suicident.
Jean-Eudes s’est tu brusquement. Il nous a observés un instant. Il a les mêmes yeux bridés que Sylvano dont l’arrière-grand-mère est d’origine chinoise. D’ailleurs, mon père surnomme Jean-Eudes « Ti-Chinois ».
— Tu as raison, Sylvano, a-t-il repris en secouant la tête, les plus âgés s’en vont les premiers.
Sylvano et moi, on n’en sait pas plus. Les adultes nous cachent des choses. C’est comme lorsqu’on a demandé à Jean-Eudes dimanche dernier comment il s’appelait quand il était petit. Il a éclaté de rire : « Té, ben… Jean-Eudes ! » Comme si c’était une évidence. Ce n’est pas possible qu’un enfant s’appelle Jean-Eudes. Il n’a pas voulu nous répondre, c’est tout. À l’école, aucun garçon ne s’appelle Jean-Eudes. Sylvano est au CE2, mais on est dans la même classe avec le même maître.
Jean-Eudes a ouvert le capot de la voiture.
La tôle blanche nous a éblouis.
On a traversé la rue pour aller en face, dans mon jardin, et on a décidé de compter les gens de nos familles qui étaient déjà morts. D’habitude, le dimanche, à quatre pattes dans l’allée de gravier, on observe les fourmis avec la loupe que j’ai fauchée à l’école. On connaît toutes les fourmilières autour de ma maison et tant pis si les cailloux nous écorchent les genoux.
C’est moi qui ai eu l’idée de compter les morts parce que j’en ai marre de regarder défiler les colonies de fourmis. Pour une fois que j’ai une idée originale. Intéressé, Sylvano a proposé qu’on commence par ma famille.
Alors, j’ai réfléchi.
D’abord, quand j’étais au CP, il y a eu ma grand-mère Marie-Louise. « Saleté de cancer, saleté de chimio ! » qu’ils répétaient, les voisins, dans la rue des Lataniers où elle habitait. Emportée en quelques mois à peine, à soixante-dix-huit ans. Juste après son anniversaire, après les grandes vacances d’été.
Puis mon grand-père Jules a suivi. Soixante-dix-sept ans. Chagrin d’amour. « Ça en fait déjà deux » ai-je dit à Sylvano, le pouce et l’index levés.
Si on ne s’est pas trompés en faisant la liste, je suis le numéro dix-neuf, j’ai le temps. Sauf accident. Il n’y a pas de règle. Mes oncles et tantes font barrage mais on ne sait jamais. Mes cousins de Saint-Paul sont aussi plus âgés que moi. « On n’est jamais prêt quand ça arrive », répètent les adultes quand ils discutent de ça aux repas de famille.
Et maintenant que je suis au CE1, il y a ma tante Jeanne. Elle a glissé, elle est tombée, elle s’est cassée. À cause de Sylvano et moi. « Vous laverez les marches de l’entrée » nous avait demandé mon père, mercredi matin, avant de partir au travail. On les a savonnées et, parce que le tuyau d’arrosage fuyait, on est partis chercher un seau d’eau dans la cour de derrière pour les rincer. On était trempés de la tête aux pieds parce qu’on s’amusait à s’asperger. Tante Jeanne est sortie de la maison un peu trop tôt et un peu trop vite.
À l’hôpital de Terre-Sainte où, je me souviens, j’étais allé voir grand-mère Marie-Louise, ils ont dit que, pour tante Jeanne, il fallait attendre. Alors, on a attendu dans le couloir tout l’après-midi. Ils lui ont mis des tuyaux transparents dans le nez, reliés à un appareil. La machine faisait bip-bip, puis plus rien. J’ai voulu savoir si elle était morte. Les infirmiers m’ont répondu que non, que les pauses entre les bips, c’était normal. Après quelques secondes, le bruit reprenait toujours.
Et tante Jeanne avec, sûrement.
« Elle fait quoi entre les bips, tante Jeanne ? » ai-je demandé. Comme d’habitude, personne n’a entendu ma question.
Dans un coin de la salle d’attente, tonton Henri pleurait, recroquevillé sur un siège en plastique qui couinait quand il bougeait. Les chaises étaient emboîtées les unes dans les autres comme celles de la cantine. En plus propres. Tout le monde le consolait : « Il ne faut pas dramatiser, ça va aller ». Sauf que tonton pensait mourir avant tante Jeanne. Il a sept ans de plus qu’elle. Le papi de Sylvano, venu le soutenir, répétait qu’il n’y avait pas d’ordre, mais tonton Henri pensait le contraire. Ils discutaient de ça parfois quand on pique-niquait tous ensemble. D’ailleurs, si tante Jeanne mourait, on aurait la preuve que l’ordre n’est pas respecté. Moi, je préférerais qu’elle rentre chez elle.
Un os dans la gueule, le chien de Jean-Eudes est passé dans la rue en courant. Il sortait de la maison voisine de celle de Jean-Eudes. Kalbas est un voleur. Il a déjà pris un poulet chez moi, sur la table de la cuisine.
— Té, Sylvano, tu crois que Kalbas va vivre plus longtemps que nous ?
— Nan, il est malade.
— Qu’est-ce qu’il a ?
— La diarrhée. Il a attrapé un virus.
— C’est mieux que la rage, non ? Au moins, il n’est pas dangereux.
— J’sais pas c’qu’est mieux.
— Il va mourir ?
— Tu ne penses qu’à ça ou quoi ? s’est énervé Sylvano.
Ce n’est pas que je ne pense qu’à ça, c’est que je pose des questions quand je ne comprends pas. Un jour, tu es vivant, et le lendemain, tu es mort. Faut m’expliquer. Pourquoi il y en a qui meurent en tombant sur une pierre qui leur ouvre le crâne là où d’autres glissent, se rattrapent, et ne se cassent même pas un orteil ? Jean-Eudes dit que c’est parce que ce n’est pas ton heure. Pourtant, quand j’écoute bien les journalistes à la radio, les gens meurent à n’importe quelle heure. Sur Freedom, on l’entend tous les jours : « On nous prie d’annoncer le décès de madame Payet Juliane, née Cadet, décès survenu ce matin à son domicile de La Plaine des Cafres. » Parfois, c’est « décès survenu cette nuit », ou « hier soir. » Si j’ajoute Kalbas à ma liste, je suis en vingtième position. C’est déjà mieux…
À quatre heures, après le goûter, avec Sylvano, on a décidé d’aller au terrain de foot. Le dimanche, le stade Ramassamy s’anime quand il y a un match. Sur le chemin, Sylvano dégommait les cailloux à coups de savate. Sur une roche un peu plus grosse, sa savate s’est coupée en deux en plein milieu et il a crié : « Té, mon orteil ! Gard’ ça ! »
On a regardé. C’était moche, tout écorché et ça saignait. Son pied tremblait, sale et gris à cause de la poussière du sentier. Son ongle, fendu, pendait sur le dessus. Sylvano ne se coupe jamais les ongles. La chair à l’intérieur de son gros doigt était blanche et des gouttelettes de sang remontaient vers la surface.
— Tu crois qu’il faut enlever les grains de sable coincés sous la peau ?
— Toi, tu touches pas à mon pied. Viens, on va descendre à la rivière.
Sur les fesses, on a dévalé la pente qui longe le sentier et on s’est retrouvés au bord de la rivière du Ouaki. Le dimanche, des femmes y lavent du linge qui sèche ensuite au soleil sur les rochers. Sylvano a avancé ses pieds dans l’eau fraîche. Un bout de chair s’est décollé et s’est mis à s’agiter dans le courant comme un bichique affolé. D’habitude bavard, Sylvano se taisait. Il n’avait pas l’air d’avoir mal.
— Mon ti-père va me taper si je rentre avec une savate pétée, a-t-il fini par lancer, en jetant une pierre dans l’eau.
Sylvano habite près de l’école, en bordure d’une ravine. Son père est parti quand il avait cinq ans, depuis sa mère a un nouveau mari, un gars costaud qui gagne tous les concours de moringue. Sylvano n’aime pas les sports de combat. Moi non plus.
— On n’a qu’à en trouver une autre, ai-je suggéré, il t’en faut qu’une, c’est pas compliqué.
On est allés traîner là où les lavandières se déchaussent avant d’entrer dans l’eau, seulement leurs savates trop grandes, avec des dorures et des perles, ça aurait semblé bizarre au pied de Sylvano. Alors, on a eu une idée : aller à la plage de Saint-Pierre. Ce n’est pas loin de chez nous en voiture, et là-bas, les savates-deux doigts, ce n’est pas ce qui manque.
— Comment on va y aller ?
— Ben, on n’a qu’à faire du stop, a proposé Sylvano. Encore une idée de génie.
On s’est mis à l’ombre, sous un manguier, au bord de la nationale, le pouce levé. Quelques minutes après, une voiture s’est arrêtée.
— Ou sa zot y sa va, marmay ? (Où allez-vous ?)
— À la plage.
— Lé bon, alé, monte azot ! (Allez-y, montez !)
Il nous a embarqués dans une vieille Peugeot aux sièges en plastique noir. Sylvano s’est assis à l’avant, moi derrière lui. De la bourre sortait des coussins. On aurait dit le ventre de mon nounours quand Kalbas l’avait déchiqueté. Le gars roulait vite. Il sentait le rhum, la cigarette et la pisse de chien. Comme le ti-père de Sylvano. J’ai tout de suite repéré la pièce posée dans le vide-poche entre les sièges avant. J’ai pensé qu’on pourrait peut-être acheter une paire de savates. J’ai donné un coup de coude à Sylvano pour voir s’il avait compris. Il me faisait des signes en agitant la main en éventail devant son nez.
Au carrefour de la rue Hubert Delisle et de la rue Isautier, le chauffeur n’a pas vu la charrette à bœufs garée sur la droite. Il l’a emboutie, comme avait fait la mamie de Sylvano avec le portail. Sylvano n’était pas attaché. Il a giclé vers l’avant. Il a traversé le pare-brise. La dernière chose dont je me souviens, c’est sa savate bleue coincée dans les morceaux de verre.
J’ai entendu l’ambulance. Puis les bips-bips à l’hôpital de Terre-Sainte, comme pour tante Jeanne, sauf que Sylvano n’a rien pu faire entre les bips. Il est « parti » avant tante Jeanne.
Le lundi, à la radio, ils n’ont pas oublié mon meilleur ami : « On nous prie d’annoncer le décès de l’enfant Sylvano Lebon, décès survenu accidentellement à l’âge de neuf ans, hier, à Saint-Pierre. »
Voilà. Jean-Eudes avait raison. Il n’y a pas de règle. Lui, il est encore en vie.
Le conducteur de la voiture aussi.
Le ti-père de Sylvano ne saura jamais pour la savate.
Et c’est le plus important.
- Fin du chapitre -

Tous les contenus du site internet de Lectivia sont protégés par la loi sur les droits d'auteur. L'utilisation, le partage ou la reproduction de toute partie du contenu sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur ou des ayants droits ou de Lectivia sera punis par la loi en vertu des règlements sur la violation du droits d'auteur et la propriété intellectuelle.

Combien de temps mettrait-elle ? Cinq secondes ? Dix ?
Jamais il n’aurait pensé retomber amoureux, encore moins d’une femme aussi jeune. Il avait eu raison d’annuler son déménagement en juin. En juillet, Charlène Huet s’était installée dans la maison voisine.
Ses courses alignées sur le tapis roulant du Score, Stéphane patientait, tapant nerveusement de la pointe de ses baskets dans les paniers en plastique rouge empilés en bout de caisse. Il détestait attendre. Combien de temps faudrait-il à la cliente devant lui pour saisir le bâton métallique et séparer ses boîtes de conserve à elle de ses cinq sacs de riz à lui ? Ce bâton à microbes que les gens se passaient de l’ouverture du magasin à la fermeture, Stéphane n’y toucherait pas.
Quatre, cinq, six secondes déjà qu’il regardait cette dame ranger ses courses.
D’un coup d’œil, elle a vérifié qu’il avait compris qu’on ne mélangeait pas les torchons et les serviettes. Zafèr kabri lé pa zafèr mouton, comme on dit en créole. D’un geste discret, elle a repoussé les cinq sacs de riz de Stéphane. Il n’a pas bronché.
Sept, huit, neuf. Agacé, il a détourné le regard. Comme d’habitude, la file d’à côté, plus longue, avançait bien plus vite.
Nina l’avait appelé. Elle avait encore besoin de l’argent de papa. Trente ans passés et toujours pas capable de gérer son budget sans les rallonges de Stéphane. Il lui a fait la morale, un peu attendri, un peu énervé quand même. Jamais il n’aurait osé, à son âge, réclamer un sou à ses parents.
En plein soleil sur le parking, Charlène pestait, consternée par les coups de gueule des auditeurs à la radio. Dès que Stéphane a ouvert la portière, elle a éteint le poste. Son parfum avait envahi l’habitacle, effaçant celui de Paule, son ex-femme. La colère rendait Charlène encore plus attirante. Ses fossettes se creusaient, accentuant cette moue qu’il adorait. Stéphane a démarré. La vieille Toyota s’est faufilée dans les bouchons de midi au rond-point de Bruniquel.
— Il y a eu une attaque de requin, a lancé Charlène.
— Encore ! Où ça ?
— À Boucan Canot, au lever du jour, derrière les filets de protection. Les auditeurs se sont lâchés à la radio. Lamentable.
— Et la victime ?
— Un bodyboarder.
— Un touriste ?
— Je ne sais pas. Il a perdu une jambe.
— Si ça les amuse de surfer dans les eaux troubles après les pluies, à l’heure où les requins rappliquent, tant pis pour eux. Je n’irais pas me balader en forêt si les gens du coin me prévenaient qu’un ours y rôde.
— T’as le riz ?
Il appréciait Charlène pour son côté pragmatique, pas du genre rêveur.
— Oui. Je ne savais pas combien il en fallait pour cinquante personnes. J’ai pris cinq sachets de deux kilos.
— Nous, on a l’habitude de compter un verre pour deux.
D’un seul mot, elle le remettait à sa place. Il a entendu un « nous » exclusif. Pas celui du toi et moi. Le « nous » qui s’oppose au « vous ». Le « nous » d’une communauté. Pourtant, il savait utiliser le rice-cooker aussi bien qu’elle. Non, je n’achète pas le riz précuit, en sachet troué, à plonger deux minutes dans l’eau bouillante. Le truc dans une boîte orange avec un Noir au sourire en tranche papaye et un prénom américain. J’achète le riz comme toi, en vrac et, après l’avoir rincé, je le jette dans la marmite jusqu’à ce que le cliquetis du couvercle gigote dans un nuage de vapeur. Nina s’était même moquée de lui les premières fois où il avait dû le faire après le brusque départ de sa mère. Et s’il n’y avait eu que le riz ! Depuis, il avait fait des progrès dans la gestion des tâches domestiques. Bien obligé.
D’un seul pronom, Charlène lui a fait sentir que non, il n’appartenait pas au même groupe social qu’elle, qu’il n’était pas d’ici. Elle, elle savait. Être née à Saint-Denis, ça changeait tout. Elle était dans le secret des dieux. Lui, que connaissait-il d’ailleurs de sa ville de naissance ? Rien. Brest était un port lointain, avec des rues commerçantes, des crêperies et un crachin persistant, lui avait-on répété à longueur d’enfance. Pour que la chance leur sourie, les badauds touchaient le pompon des bérets que portaient les matelots qui déambulaient en ville. Stéphane pouvait compter sur les doigts d’une main les mots bretons qu’il connaissait : kenavo, l’incontournable Bloavez Mad du jour de l’An, Armor et Argoat qu’il lisait sur les panneaux d’autoroute.
Il aurait pu tenter un ironique : « Et pour le sucre dans le café, vous comptez comment ? »
Loin de lui l’envie de mettre un pied en terrain miné. Elle avait la peau brune, pas lui ; de longs cheveux noirs qu’elle lissait le soir à l’huile de coco, assise dans un hamac au fond du jardin. Lui, il avait des boucles blondes qui accentuaient la pâleur de son teint. Le regard velouté de Charlène, ses yeux sombres attiraient hommes et femmes. Lui, il avait les yeux trop clairs, sans éclat, la confiance en berne depuis son divorce d’avec Paule l’année précédente.
Il était amoureux de Charlène.
Elle semblait ne pas s’en rendre compte.
Elle n’était pas prétentieuse. Elle manquait juste d’empathie. Sa mère l’aurait trouvée bêcheuse. Un mot vieux comme sa Toyota qui s’essoufflait dans la montée de la Voie Cannière. Charlène lançait des phrases sans en réaliser la portée. De celles dont on dit après : « Oh pardon, je n’ai pas fait exprès. » Il aurait voulu qu’elle fasse exprès de faire attention, qu’elle mette plus de tact dans ses propos, qu’elle pense tout simplement à ce qu’il pouvait ressentir.
Il a rallumé la radio et baissé le volume : « … de l’identité réunionnaise aujourd’hui en 2017 : kréol, zarab, kaf, malbar, sinoi, malgas. »
Sa main est restée vissée sur le bouton de la radio dans un désir de revenir en arrière pour entendre le début de la phrase. Il avait dû louper un truc, là, dans ce que le chroniqueur avait appelé « identité réunionnaise ». Il manquait un mot.
Où était-il, lui, Stéphane Richard, dans ce melting-pot ? Oublié dans la liste ? Il avait l’impression d’être un pépin dans une salade de fruits. Ni kréol, ni zarab, ni kaf, ni malbar, ni sinoi, ni malgas, il se sentait pourtant Réunionnais. Combien de fois l’avait-on repris sur ses intonations chantantes, sur les expressions qu’il utilisait et qu’on ne comprenait pas dans l’Hexagone !
Planté ici en 1970, à peine âgé de cinq ans, comme une graine qui ne demande qu’à pousser, il n’était pas en transit, pas en partance, pas assis entre deux chaises. Non, il était là chez lui, ancré sur ses pieds, les orteils accrochés aux scories, les talons enfoncés dans la poussière rouge du Pas de Bellecombe ou dans le sable noir de la plage de L’Étang-Salé.
Contrairement à ceux qu’il avait vu débarquer à La Réunion, puis en repartir définitivement, il y était, lui, arrivé définitivement. Était-ce à cause des va-et-vient de ces oiseaux de passage qu’on l’ignorait ? Ou était-ce, comme son frère le lui avait laissé entendre un soir dans un gîte de randonnée : « Parce que, Stéph, comment veux-tu que les gens d’ici aiment ceux qui… » Pierre n’avait pas fini sa phrase. Il s’était retrouvé avec le nez cassé et la mâchoire déboîtée. Stéphane en avait assez. Ceux qui quoi ? Ceux qui avaient colonisé La Réunion au dix-septième siècle ? Ceux qui débarquaient, encaissaient des primes et repartaient aussitôt ? Ceux qui vivaient dans leur bulle entre Boucan Canot et La Saline ?
Stéphane en avait assez de culpabiliser à la place des autres. Il ne comprenait pas pourquoi il devait répondre des comportements de gens qui lui étaient étrangers. Il n’avait pas connu la vie de famille au sens large : les bruyantes tablées du dimanche avec les grands-parents, oncles, tantes, cousins et cousines. Les parties de foot après les pique-niques. La maisonnée s’était un jour réduite à deux parents aimants et un frère aîné bagarreur. Il n’avait jamais su pourquoi son père et sa mère avaient quitté la Bretagne. S’était-il passé quelque chose ? Ou était-ce leur manière, la trentaine venue, de rompre l’ennui d’une vie trop installée, de partir à l’aventure ?
Sa terre à lui était ici.
Son pays, c’était l’île.
Et les pique-niques du dimanche, sa famille les avait organisés avec leurs amis d’ici. Les grandes marmites sous les filaos de la plage de Saint-Leu, les parties de boules dans les allées du bord de mer, les matchs de volley sur le sable noir dans ce coin de la plage de L’Étang-Salé où la route bifurque et qu’on appelle Le Tournant.
Quand on lui demandait s’il rentrait pendant les vacances, il taquinait ses collègues :
— Rentrer ? Où ça ?
— Tu ne rentres pas en métropole ?
— Ah non, moi, quand je rentre, c’est ici.
Visiblement, auprès de Charlène, cela ne suffisait pas à lui accorder une quelconque légitimité, à faire de lui un Réunionnais à part entière. Il n’était pas « Réunionnais d’adoption », ni « Réunionnais de cœur » comme elle lui avait dit, un jour. Il était Réunionnais tout court.
Là-bas, dans l’Hexagone, quand il demandait où était le gabier ou s’il pouvait fermer les nako, on le regardait avec perplexité. À l’adolescence, il avait eu honte d’utiliser des mots différents, des mots d’ici à la signification purement locale. Des expressions « Royal Bourbon » pour désigner les chiens de rue sans pédigrée. C’est ce qu’il était : une âme sans pédigrée. Quand, réveillé à six heures chez ses cousins, il guettait un signe de vie dans les chambres voisines, il voyait bien qu’il n’était pas synchrone. Se lever tôt, là-bas, ça voulait dire huit heures, pas six.
Il parlait trop fort, lui rappelait-on. « Tu ris vraiment pour rien. » Il portait des habits trop colorés. Ça dérangeait. Une grosse tache de couleur au milieu des manteaux noirs en hiver. « On ne met pas un bermuda orange en cette saison, voyons. Tu n’as pas froid torse nu dans la maison ? Et ta manière de prononcer les « r »… On parle comme ça aux Antilles ? »
Voilà qui l’agaçait plus encore : personne n’avait l’air de savoir où se trouvait l’île qui était pour lui le centre du monde. Et le compliment de ce professeur de collège, un jour où il avait accompagné sa cousine en cours d’anglais : « À votre aisance en anglais, on voit que vous vivez dans un pays anglophone. » Trop bien élevé, Stéphane n’avait pas osé le contredire. Peut-être aurait-il dû, histoire de savourer une petite revanche pour une fois. D’habitude, la honte était de son côté.
Pour les métropolitains, il était sans nul doute de l’autre hémisphère, de celui où l’on marche la tête à l’envers, lui disait-on en plaisantant. Et pour ses semblables de La Réunion, d’où était-il ?
Il se sentait d’ici, et de nulle part ailleurs.
Réunionnais.
Réunionnais depuis cinquante-deux ans.
Il avait grandi ici, fréquenté l’école primaire de la SIDR, puis le lycée du Tampon dans les Hauts de l’île. Il avait épousé Paule en la mairie de cette commune où ils avaient fait construire une maison. Ses amis d’enfance vivaient aux quatre coins de l’île. Enfin, ceux qui, comme lui, avaient choisi de ne jamais en repartir. Ils avaient pris racine ici. Ses parents reposaient au cimetière marin de Saint-Leu, au milieu des frangipaniers. Une nuit d’août, trente ans plus tôt, alors qu’un front austral balayait la ville de Saint-Pierre, Paule avait accouché de Nina à l’hôpital de Terre-Sainte.
Et Nina, où était-elle dans la liste ?
Où était sa place, ici, dans cette île ?
À quoi sait-on que l’on appartient à un pays ? Est-ce parce qu’on en parle la langue ? Parce qu’on en saisit les subtilités culturelles dans la presse ? Parce qu’on est capable de chanter les refrains traditionnels ? Ou parce que le cœur se met à battre plus fort lorsque l’avion se pose enfin sur le tarmac de Roland Garros ?
Au Tampon, au carrefour de la quincaillerie Ah-Hot, Stéphane s’est rangé sur la voie pour tourner à gauche et s’engager dans la ruelle Paille-en-queue. Charlène rectifiait son maquillage dans le miroir du pare-soleil. Si féminine dans ces gestes familiers. Tourner à gauche, ça ne devrait même pas exister. Pourvu qu’il n’y ait pas un motard qui remonte la file ou un inconscient qui change de direction et lui coupe la route sans crier gare.
Pourquoi Nina avait-elle évoqué son prochain départ pour l’Hexagone ? Il n’avait pas écouté ce qu’elle racontait au téléphone, obnubilé par tout le riz à acheter. Ne pas déplaire à Charlène. Se montrer à la hauteur. Ne pas refaire les mêmes erreurs qu’avec Paule. Son corps de nageur et son sourire pourraient ne pas suffire à la séduire. Est-ce que Nina partait en vacances ? Ou est-ce qu’elle avait enfin trouvé un boulot ?
Un coup de klaxon a interrompu le flot de ses réflexions.
— Quoi encore ? Qu’est-ce qu’il a celui-là ?
— Laisse-le passer, on n’est pas pressés, a articulé Charlène tout en pinçant les lèvres pour étaler du rouge.
Il a ralenti pour laisser le véhicule le doubler. Une Clio blanche avec le phare arrière gauche cassé. C’était la voiture de Nina. Mais elle n’était pas dedans. Au volant, un de ses copains rastas qu’il n’aimait guère. Celui qui l’avait tutoyé et appelé par son prénom le jour où Nina le lui avait présenté. « Bonjour, Stéphane, tu es un lève-tôt comme ta fille ? » Faudrait que Nina arrête la fumette, ce serait bien. Qu’elle cesse de s’entourer de cette bande de charlots, de traîne-savates qu’on voyait sur la plage et pas au boulot. De quoi vivaient-ils, d’ailleurs ? Est-ce qu’ils avaient tous, comme elle, un gentil papa généreux ? Est-ce qu’ils allaient travailler en tongs ?
Il se souvenait de ses copains du lycée du Tampon qui descendaient autrefois de la Plaine des Cafres en savates-deux-doigts. À sept heures trente, au mois d’août, il faisait parfois à peine dix degrés. Ils n’avaient pas le choix. Ils auraient préféré avoir des chaussures fermées, des chaussettes aussi. Lui, il aurait trouvé déplacé d’aller au lycée en savates alors qu’il pouvait se permettre ce « luxe ». Il n’était jamais allé au bureau en tongs — un mot de touristes en vacances — et il trouvait bizarres ces collègues qui arrivaient en tenue décontractée sous prétexte qu’ils étaient sous les tropiques.
Il s’est tourné vers Charlène qui refermait sa trousse à maquillage :
— T’as prévenu ta mère qu’on déposerait les courses avant d’aller à la cérémonie ?
La mère et le père de Charlène avaient décidé de renouveler leurs vœux après trente ans de mariage. Stéphane ne comprenait pas à quoi cela servait. Les serments, les promesses, il en avait soupé. Il aurait préféré piquer une tête au large de Kélonia, la plage aux tortues, mais bon, vu la météo, il serait de toute façon resté à la case. Il avait plu à verse pendant trois jours. À l’embouchure des ravines, les eaux étaient troubles, la mer agitée. Il n’avait pas envie de se retrouver nez à nez avec un squale, même si ces derniers n’attaquaient pas les plongeurs. Il passerait chez Nina à Saint-Pierre, après le pique-nique à Grande Anse. Il avait promis de lui installer un hamac semblable à celui de Charlène. Nina en rêvait depuis des semaines.
Stéphane s’est garé dans l’allée des Hibiscus déjà encombrée de gens endimanchés. Charlène, aussi à l’aise sur des talons aiguille que dans des baskets, est descendue à la rencontre de ses oncles, tantes, cousins. Au milieu des rires et des interpellations, il a déchargé le coffre et porté les paniers à la cuisine où le père de Charlène terminait d’enfiler des brochettes en écoutant les informations à la radio.
— Ça va, Stéph ? Y a encore un surfeur qui s’est fait attaquer ce matin. Paraît que c’est un jeune.
— Âge tendre, tête de bois. C’est cher payé quand même, non ?
— On croit toujours que ça n’arrive qu’aux autres, tu sais bien.
— Je plains les parents.
— Bon, j’ai presque fini. Charlène et toi, vous monterez dans la voiture de Nono, il reste de la place pour vous deux.
Stéphane aurait préféré faire la route seul avec Charlène encore un peu. Quand se déciderait-il à lui dire qu’il l’aimait ? Qu’organiser des choses ensemble, c’était agréable, mais qu’il voyait plus loin, qu’il voulait plus que ça. Il ne resterait pas toute sa vie l’adorable voisin de Charlène Huet. Qu’elle n’ait que quelques années de plus que Nina ne le gênait pas. Mais la différence d’âge était peut-être la raison pour laquelle Charlène ne semblait pas le considérer comme un prétendant potentiel. Il manquait de discernement dès qu’il s’agissait de sa vie amoureuse. Il avait essayé d’aborder le sujet, mais quand elle avait évoqué ses déboires avec son ancien compagnon, il avait compris qu’il faisait fausse route. Il ne cherchait pas à être son confident. Il devrait se montrer plus habile. Il fallait qu’il trouve un moment aujourd’hui pour discuter avec Charlène. Inutile de tergiverser plus longtemps. Il prendrait son courage à deux mains cet après-midi. Le punch et le champagne lui donneraient des ailes. Dans la foulée, il mettrait les points sur les « i » à Nina aussi. Il était temps qu’elle dégote un vrai boulot, de vrais copains, et qu’elle atterrisse dans la vraie vie.
Hier encore, alors qu’il taillait les bougainvilliers — prétexte pour jeter des coups d’œil au hamac, de l’autre côté de la clôture —, il s’était reproché de ne pas assez oser. « Ose vivre », s’était-il répété entre deux coups de sécateur. Il avait perdu son audace naturelle depuis que Paule l’avait quitté. Son divorce avait été le fiasco final d’une série de catastrophes.
Tout avait commencé, un soir de septembre 2015, par un banal accident de voiture qui avait réformé sa Chevrolet. Une histoire de stop masqué par des branches trop longues à la sortie de l’allée, chez Nina. Il en était sorti indemne.
Puis un matin d’octobre, pas encore bien réveillé, il avait par mégarde mis le feu à la cuisine en confondant la prise de la machine à café avec celle du barbecue acheté à Score la veille et installé juste à côté. Quelle idée aussi toutes ces prises noires identiques ! Le temps que le percolateur chauffe, il était parti bricoler sur sa voiture. L’odeur de brûlé l’avait fait rappliquer. Trop tard ! Le barbecue était en feu, les sets de table et la nappe en plastique posés dessus avaient fondu. Les flammes attaquaient les placards de cuisine suspendus au-dessus de l’évier. Il s’en était voulu pendant des semaines, trois semaines où des experts en assurance, des décontamineurs, des peintres, des menuisiers, des artisans en tous genres avaient défilé pour réparer sa connerie. Paule et Nina s’étaient moquées de lui. « Comment peux-tu brancher un barbecue à la place de la machine à café ? » Tous leurs amis avaient été mis au courant. La blague de la semaine. La maison empestait le plastique brûlé. Il n’avait pas apprécié le jeu de mots de son assureur sur le barbecue « flambant neuf ».
Quelques jours plus tard, Nina avait pris le relais en squattant les lieux pour fêter ses trente ans avec sa bande de copains pas réglos : tapage nocturne, alcool à tous les étages, zamal à volonté. À quatre heures du matin, les voisins d’en face avaient envoyé les flics. Convocation à la gendarmerie, rappel à la loi.
Un mois après, Paule avait été hospitalisée d’urgence pour une hémorragie interne. En son absence, il avait fait du rangement et était tombé sur une série de lettres qu’elle avait échangées avec un de ses collègues à lui. Il lui aurait fracassé la tête si ce dernier n’avait pas déjà quitté l’île. À sa sortie de l’hôpital, Paule était partie se mettre au vert, dans les Hauts. « Seule », avait-elle précisé, avant de claquer la porte.
Un matin de février 2016, Stéphane avait reçu la demande de divorce par la Poste. Sa vie avait déraillé. Au marqueur noir, il avait barré rageusement le nom de Paule sur la boîte aux lettres. Ses amis lui avaient conseillé de voir un psy, mais la résilience et tous ces machins, il estimait ne pas en avoir besoin. Le lâcher-prise, il avait essayé : quatre-vingts euros perdus en quarante minutes chez une sophrologue.
Quand ça n’allait pas, il chaussait ses palmes, ajustait masque et tuba, et se laissait glisser dans le lagon. Il se sentait bien dans le silence absolu au fond de l’eau, bercé par le mouvement de la houle. La solitude du nageur de fond. Serpenter entre les massifs coralliens, croiser une murène, une langouste ou, parfois, un requin juvénile aussi surpris que lui.
En juillet 2017, sa route avait croisé celle de Charlène lorsqu’elle avait emménagé dans la maison voisine de la sienne, au 10, Chemin des Ananas. Elle avait des jambes à rendre amoureux n’importe qui…
Le père de Charlène a désigné un bol en verre posé sur la table.
— Prends les achards dans le frigo et mets-les dans le saladier. Il ne me reste que trois brochettes à préparer.
Sur le réfrigérateur, Stéphane a reconnu une photo en noir et blanc qu’il avait déjà vue sur le bureau de l’avocat consulté pour son divorce. On y distinguait un monsieur pieds nus, vêtu d’une chemisette à carreaux, le pantalon flottant autour de jambes maigres, qui suivait un chemin poussiéreux à côté d’une charrette de cannes tirée par deux bœufs.
Son téléphone a sonné. Numéro inconnu. Donc, ce n’était pas Nina qui le relançait pour le hamac ou pour l’argent qu’elle avait déjà dépensé. Peut-être que Paule était prête à rentrer à la maison. À choisir entre Charlène et Paule…
— Allo ?
— Oui, bonjour, c’est la gendarmerie de Saint-Paul.
Il a sorti la barquette d’achards, l’a posée sur la table.
— La gendarmerie ?
— Oui. Monsieur Stéphane Richard ?
— Oui, c’est moi.
Il a ouvert le tiroir à couverts à la recherche d’une fourchette, puis a saisi le saladier.
— Votre fille a été attaquée par un requin, au lever du jour, alors qu’elle surfait à Boucan Canot. Elle a été transportée au CHU de Saint-Denis. Elle est en réanimation. Je suis désolé…
Le saladier a explosé sur le sol.
- Fin du chapitre -

Tous les contenus du site internet de Lectivia sont protégés par la loi sur les droits d'auteur. L'utilisation, le partage ou la reproduction de toute partie du contenu sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur ou des ayants droits ou de Lectivia sera punis par la loi en vertu des règlements sur la violation du droits d'auteur et la propriété intellectuelle.

Nous étions six et tout tenait dans deux malles. Six vies bien rangées dans deux cantines d’occasion en fer, déjà cabossées, avant même de quitter la maison. Des vêtements d’été, de la vaisselle, les livres de maman. Des choses futiles comme le nounours pelé d’Armand ; d’autres, utiles, comme la corne de brume de papa et mon répertoire téléphonique.
Là-bas, pas de téléphone, nous avait-on prévenus.
On verrait bien.
Aucun de nous six n’avait jamais pris l’avion. Nuit et jour, des rêves de récifs coralliens, d’éruption volcanique, de marches sur le feu, caracolaient dans nos têtes. Malgré nous, nos corps excités gesticulaient.
— Non, Arnaud, pas dans la malle bleue, dans la verte, celle qu’on ouvrira en premier.
— Comme tu voudras.
— On ne va pas tout déballer en arrivant.
Maman régnait sur l’organisation. Papa obéissait en sifflotant. Les cantines avalaient les cartons de bibelots, les sacs de linge, les paniers de jouets. Un mois plus tôt, les meubles avaient valsé lors du passage musclé des déménageurs.
Un matin d’août 1972, le taxi qui s’est garé devant notre petite maison, au sud de Paris, n’était pas celui que j’avais imaginé, mais nous étions six avec deux malles.
Les portières du véhicule se sont ouvertes sur trois rangées de banquettes en tissu rouge. Personne n’est monté à côté du chauffeur. Était-ce interdit ? Papa et maman avaient-ils peur de s’asseoir à la place du mort ?
Quand nous quittions Paris pour les vacances et roulions des heures en direction de la mer, maman criait toujours :
— Moins vite, Arnaud, c’est moi qui suis à la place du mort.
Alors, parfois, pour lui faire plaisir, papa ralentissait. Parfois, il accélérait. Exprès. Pour son plaisir, car la vitesse le grisait. Et nous, à l’arrière, nous l’encouragions en chantant :
— Papa, si t’es champion, appuie-eu, appuie-eu, papa, si t’es champion, appuie sur l’champignon.
Quand un panneau indiquait un dos-d’âne, nous le suppliions d’accélérer encore. La vieille Peugeot bondissait et nos derrières décollaient des banquettes, comme les crêpes de la poêle à la Chandeleur. On riait aux éclats. Sauf maman. Elle ne disait plus rien. Enfoncée dans son siège, elle regardait par la fenêtre du mort.
Donc, le jour du départ, mes parents ont pris place à l’avant, sans doute pour donner les indications au chauffeur :
— À l’aéroport d’Orly, s’il vous plaît.
Maman portait sa belle robe violette à manches courtes, un gilet blanc avec des franges aux poignets et des sandales neuves. Ses cheveux bouclés dégringolaient sur son visage rond et s’entortillaient dans son collier de perles multicolores. Papa avait ciré ses chaussures. En pantalon marron, chemisette kaki et veste en toile, rasé de près, il avait l’air plus jeune.
Depuis des semaines, l’évocation de l’aéroport éperonnait notre imagination. Derrière les parents se sont installés les deux grands, Anna et Adrian, et, tout au fond, mon petit frère Armand et moi. Dans le coffre, les bagages empilés. Sur la plage arrière, les vieux chandails (au cas où) qu’on laisserait sûrement à l’aéroport. Là où nous allions, la chaleur nous « habillerait », avait plaisanté mon grand-père, debout sur le trottoir, la larme à l’œil, appuyé sur son éternel parapluie « au cas où… ».
Le chauffeur a disparu derrière la casquette d’Adrian qui s’asseyait toujours à côté d’Anna, sinon il se chamaillait avec Armand. La voiture a démarré. Une avalanche de pulls nous a engloutis.
Avalanche avec un grand A, comme nos prénoms.
Longtemps, j’ai cru que tous les prénoms commençaient par un A, jusqu’à ce que je découvre, à six ans, qu’il s’agissait d’une fantaisie de mon père. Il ne rêvait pas d’une famille. Il rêvait d’une équipe de football. Onze joueurs, tous pareils, qui se passeraient un ballon en s’encourageant jusqu’à ce que victoire s’ensuive. Ne pouvant nous affubler d’un dossard de couleur, il avait choisi l’initiale A en signe de ralliement. Nous l’avions échappé belle : j’aurais pu m’appeler Atchoum, et Armand, Abracadabra.
Dans le taxi, papa, renseigné par un de ses collègues habitué aux voyages en avion, nous a tout expliqué : le chewing-gum à mâcher au décollage et à l’atterrissage, le risque de dépressurisation, les masques à élastique qui tombent sous le nez, le sac à vomi dans la pochette du dossier de devant, les boutons des sièges sur lesquels, pour une fois, nous aurions le droit d’appuyer à volonté.
Après une escale à quatre heures du matin, dans la fournaise de l’aéroport de Djibouti, le Boeing 707 d’Air France s’est posé à dix mille kilomètres de Paris, sur une langue de bitume qui empiétait sur l’océan Indien. Nous avons dîné, regardé un film sur un petit écran à l’avant de la cabine, dormi. Au petit-déjeuner, nous avons mangé une omelette avec des saucisses. À force de triturer le bouton pour l’incliner et le redresser, Armand a déglingué son siège. Assis, allongé, assis, allongé, assis, cassé.
Nous sommes enfin arrivés à La Réunion.
Sur la gauche de la piste d’atterrissage, la mer, rien que la mer.
Sur la droite, des plumets roses qui dansaient dans le vent au bout de longues tiges vertes semblables à des roseaux, et une montagne, au loin.
Adrian et Anna ont aidé papa à ranger les bagages dans le coffre d’un taxi. Nous avons quitté l’aéroport de Gillot où deux ventilateurs brassaient au ralenti un mélange d’air chaud et de poussière.
Le chauffeur avait la peau noire. Je n’avais jamais vu d’homme noir. Des gens à la peau marron, oui, comme la cousine de maman, ou le père de Martine qui nous gardait le jeudi après-midi. J’ai demandé à maman si nous allions changer de couleur, nous aussi. Elle voulait toujours qu’on bronze pendant les vacances.
— Oui, c’est sûr. Vous ne serez plus aussi pâlichons, hein, Arnaud ?
Elle souriait bêtement.
(Adrian prétend qu’être amoureux donne l’air idiot).
Ensuite, elle a lancé à papa :
— Regarde, les champs de canne, Arnaud. Comme sur les photos.
Et papa de préciser :
— C’est de la canne à sucre, les enfants.
Du sucre poussait dans les champs !
— J’ai faim. Qu’est-ce qu’on va manger ?
Armand ne pensait qu’à ça. Son ventre gargouillait.
— Un p’tit rien calvende jaune, a rétorqué maman, pour lui clouer le bec.
Au Tampon, le chauffeur nous a déposés au fond d’une ruelle. Une bâtisse beige à étage se cachait derrière un jardin aussi touffu que la jungle de Mowgli. Comme les tentacules d’une pieuvre géante, les racines des arbres avançaient sur la terre rouge.
Dès le lendemain, l’immense terrain vague tout autour accueillerait nos jeux quotidiens. Des cris d’enfants résonnaient jusqu’à nous et, tous les quatre, nous vibrions déjà de l’envie de nous mêler à eux.
— Vous irez jouer tout à l’heure. Pour le moment, on s’installe. Chacun récupère ses affaires et les transporte dans sa chambre. C’est valable pour toi aussi, Armand.
En sortant les bagages, Adrian et papa ont laissé tomber une malle sur la terrasse dont le sol carrelé ressemblait à l’échiquier d’Adrian. Maman s’est énervée.
— Faites un peu attention, vous deux !
Et moi d’ajouter :
— De toute façon, elle est tellement cabossée qu’une cabosse de plus ou une de moins, ça ne se verra pas.
Mais là, elle n’était plus cabossée, elle était explosée. Des livres ouverts à plat ventre et des jouets s’étalaient partout. Des soutiens-gorge rampaient sur le damier comme des serpents sur des cailloux. Adrian a shooté dans le nounours d’Armand qui s’est retrouvé accroché à une branche, comme un koala à son eucalyptus. Armand s’est mis à pleurer. Des larmes de crocodile.
Le lendemain, maman est allée faire des courses pendant que nous filions vers le terrain vague.
— Vous n’allez pas me croire ! s’est-elle exclamée en revenant.
La ville du Tampon comptait quatre boutik. Ce qui se mangeait s’achetait Chez Georges, une supérette tenue par un vieux Chinois en centre-ville. On trouvait le reste à la quincaillerie Ah-Hot, au carrefour de Bérive, au magasin de meubles de M. Mohamed derrière l’église, et, pour le pain et les gâteaux, à la boulangerie-pâtisserie Chane-Ky, sur la route principale qui traversait la ville.
— Croire quoi, maman ?
— Figurez-vous qu’à la caisse, je m’étonnais qu’à six heures et demie à peine la nuit soit tombée. Et voilà la jeune caissière qui me répond : « Ne vous inquiétez pas, madame, la nuit, c’est comme le jour, sauf qu’il fait noir. »
L’hilarité a stoppé net, cependant, lorsque maman a ajouté :
— Ici, l’école commence à huit heures. Au collège, Adrian, le principal a prévenu que les cours débutent à sept heures trente.
Plus personne n’a eu envie de rigoler. Huit heures ? Sept heures trente ? Pas possible ! À quelle heure allait-il falloir se lever ? De toute façon, c’était pour cette raison que nous avions quitté Paris, non ?
Pour changer les habitudes.
Démarrer une nouvelle vie.
Et à six heures du matin, le soleil irradiait d’est en ouest. Le chant des tisserins emplissait déjà de joie l’immense ciel bleu.
Pour rejoindre l’école de la SIDR, Anna et moi traversions un champ de canne, en contrebas du lotissement Lassays. Le sentier caillouteux zigzaguait entre les tiges géantes qui bruissaient sous les alizés. Nous n’avions pas reçu notre déménagement, mais rien ne nous manquait. M. Mohamed nous avait prêté des lits, une table, des chaises et deux armoires, en attendant qu’arrive la commande passée à son magasin.
— Tu te rends compte, Arnaud, il nous prête tout ça.
— C’est un signe, Agathe. Nous serons bien ici, bien mieux qu’à Paris.
Avec ses nouveaux copains du collège, Adrian avait construit une cabane sur le terrain vague où, le mercredi et les weekends, nous retrouvions les enfants du quartier. Depuis la rentrée, le congé du mercredi avait remplacé celui du jeudi. Au goûter, nous achetions, en francs CFA, un macatia et un Solpak à la boutique Ti-Louis, au coin de la rue. Des volets en bois, pas de porte ni de vitre, une pancarte Orangina en fer sur le mur. Nous étions plus heureux que nous ne l’avions jamais été, plus vivants, à courir en short et savates dans les herbes, à jouer kanèt ou au mèr, et à nous cacher dans les buissons.
La vie était simple : les fins de mois n’avaient plus rien d’inquiétant.
Nous avons commencé à prendre racine.
Le dimanche en fin de journée, nous nous rendions chez les voisins, M. et Mme Auguste. Ils avaient le téléphone. On appelait la métropole. Cela marchait rarement du premier coup. Quand papa en avait assez de composer et de recomposer le numéro, il passait le combiné à maman.
— Tiens, Agathe, essaye, toi, tu es née sous une bonne étoile.
À son tour, elle enchaînait les tentatives sur le cadran jusqu’à en avoir mal aux doigts.
Quand le contact s’établissait enfin, ça sonnait, là-bas, dans l’hémisphère Nord, et, souvent, les mots rebondissaient en écho sur la ligne. Nous imaginions les grands-parents, oncles et tantes, les cousins, la famille agglutinée autour de l’unique écouteur, dans un hall d’école, seul endroit où ils pouvaient recevoir un appel. D’une voix enjouée, maman leur décrivait la vie que nous menions.
Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Non, on n’a pas le téléphone. Pas encore. Oui, on a acheté une voiture d’occasion. Une Fiat marron assez nerveuse qui monte sans problème les pentes très raides d’ici. Je ne suis pas douée pour les démarrages en côte. On n’a pas l’habitude. Non, Arnaud n’a pas écrit cette semaine. Il travaille beaucoup à l’agence et, le weekend, il bricole dans la maison. Oui, les petits se portent bien. Ils ont des copains à l’école et au collège. Les gens sont accueillants, c’est pas Paris. Le dimanche, on retrouve des collègues à la plage de l’Hermitage. Il fait beau tous les jours, c’est incroyable. Oui, le cyclone nous a épargnés.
Sauf qu’il avait déchiqueté mon cerf-volant. Ça, personne n’en parlait.
Bon, on raccroche, sinon ça va coûter une fortune. On vous rappelle la semaine prochaine. On vous embrasse.
*
Un matin de juillet 1974, près de deux ans après notre arrivée, il a débarqué de l’autre bout du monde.
Sans prévenir.
Un bonhomme costaud, au visage mal rasé, comme les cow-boys dans les films en noir et blanc que nous regardions à la télévision, le dimanche après-midi. Au risque de se faire engloutir sous un éboulement de la falaise surplombant la route en Corniche, papa était allé le récupérer à l’aéroport de Gillot. Nous allions rarement à Saint-Denis. Le trajet était trop risqué.
— C’est la roulette russe là-dessous, disait papa.
Plus rien n’a été pareil.
On nous l’a présenté comme un ami. Un ami comme quoi ? Moi, j’en avais de toutes sortes. Maman disait : « Il y a des Amis avec un grand A. »
Il s’appelait Alexandre. Plus jeune que papa, plus bronzé, plus musclé aussi. La ligne de ses dents bien blanches barrait son large visage carré. Il portait des jeans, un ceinturon en cuir et des chemises à carreaux. On ne nous a expliqué ni d’où il venait ni combien de temps il resterait à la case.
Papa a lancé :
— Il a pris un chemin de traverse.
Nous avons fait semblant de comprendre.
La chambre d’Anna a été réquisitionnée pour qu’il s’y installe. Elle a déménagé dans celle, plus petite, d’Armand. Elle ronchonnait. Elle n’aimait pas dormir avec un bébé qui pleurniche. Adrian a insinué que c’était pour la punir parce que, à dix ans, elle suçait son pouce. En même temps, la chambre d’Anna, c’était celle où, la nuit, des cafards aux antennes dressées naviguaient vers la cuisine, alors elle ne perdait pas grand-chose.
Alexandre n’allait pas travailler. J’ignorais ce qu’il fabriquait toute la journée. On se réveillait, il était là ; on partait, il était là ; on rentrait, il était là ; à table, à midi, il était là ; à table, le soir, il était là ; on se couchait, il était là. Le dimanche, il était là. J’ai demandé à maman s’il était malade.
— Pourquoi voudrais-tu qu’il soit malade ?
Non, je ne voulais pas qu’il soit malade. S’il vomissait, ça sentirait comme dans l’avion. Est-ce qu’elle lui avait bien mis un sac à vomi dans la chambre ?
J’avais beau l’observer, il ne ressemblait pas à papa. Ni à maman non plus. Il ne ressemblait à rien. Il était juste comme les cow-boys des westerns du dimanche. Mais un cow-boy sans cheval.
Maman était énervée. Elle répétait en douce :
— Sept, ce n’est pas pratique, Arnaud. Dans la voiture, un des petits doit s’asseoir sur ses genoux. À table, les grands sont serrés. Et les couverts, ça va par six, pas par sept.
Papa lui rétorquait invariablement :
— Ça ne va pas durer, Agathe, tu sais bien. Il est de passage, le temps que, là-bas…
Papa jetait vers nous un coup d’œil discret, puis il se taisait. Maman ne disait plus rien.
— Maman, qu’est-ce qu’il voulait dire, papa ? demandions-nous à tour de rôle.
— Un p’tit rien calvende jaune, répondait-elle.
Donc, il était là le temps que…
La nuit, la chambre de mes parents résonnait de murmures inquiétants. Des mots bizarres ponctuaient leurs conversations : adultère, frasque, opprobre.
Un soir, j’ai cru entendre « pension ». Ils ne pouvaient pas le mettre en pension. Il était beaucoup trop vieux. Qui en aurait voulu ? J’ai eu peur qu’ils nous y envoient, nous. Adrian m’a rassuré : il n’y en avait pas dans les écoles d’ici. À mille milles de toute terre habitée… Moi, je ne pensais pas au Petit Prince. Je pensais au Petit Poucet. Les plans macabres que ses parents élaboraient la nuit peuplaient mon sommeil.
— Maman, c’est quoi une pension ? ai-je demandé un matin.
— Un p’tit rien calvende jaune.
J’ai fait comme si j’avais compris.
Un autre soir, j’ai entendu :
— Ils se sont réconciliés. Elle va arriver.
Ce n’était pas possible qu’on en ajoute une. À moins qu’ils ne la mettent avec Alexandre et les cafards.
Anna et moi avons continué d’aller à l’école à travers champs. Quand les cannes étaient coupées, la vue sur la mer absorbait l’horizon. Maman a continué d’aller travailler au collège de la Ravine des Cabris, papa à l’agence immobilière Isautier, à Saint-Pierre. Alexandre a continué de rester à la case. Continuer de ne rien faire, ça m’aurait plu à moi aussi. Armand et Adrian ont continué de se chamailler parce qu’Armand s’amusait à lui piquer des stylos ou une casquette dans sa chambre. Papa et maman ont continué de chuchoter le soir, dans leur lit.
Nous avons grandi.
Sur le chambranle de la porte de la salle de bains, papa nous mesurait une fois par trimestre. Tout en haut, au feutre rouge, trônait le trait pour Alexandre. Un peu plus bas, celui de papa. Quelques centimètres en dessous, celui de maman. Nous, on essayait de les rattraper.
Souvent, Alexandre venait nous chercher à l’école. De l’autre côté du passage clouté, il nous attendait en plein soleil.
Un après-midi, en arrivant à la maison, nous avons croisé les gendarmes qui en repartaient. Deux bonshommes secs et blancs en short bleu marine court, chemise bleu ciel, couverts d’une casquette toute raide. Des chaussettes hautes comme celles des joueurs de football remontaient sur leurs mollets poilus et une matraque pendait à leur ceinturon. La lumière du soleil de cinq heures teintait la varangue d’une couleur orangée et allongeait les ombres des banians.
Assise sur le canapé en rotin, des papiers administratifs à la main, maman pleurait en silence. Papa n’était pas rentré de l’agence. D’une voix déterminée, elle a interpelé Alexandre qui s’apprêtait à entrer dans la cuisine pour prendre une bière dans le frigo, comme d’habitude :
— Elle est morte, Alexandre. Morte.
Alexandre est revenu sur ses pas.
Il est resté planté devant elle, sans un mot, comme moi devant l’instituteur, M. Gérard, le jour où j’avais oublié d’apprendre ma table de huit. Les feuilles tremblaient dans la main de maman.
— Qui ça ?
— Elle s’est tuée.
— De qui tu parles ?
Les doigts d’Alexandre tripotaient la boucle métallique de son ceinturon. La sueur dégoulinait de son front. De grosses gouttes répugnantes ont éclaboussé le carrelage.
— Astrid.
— Astrid ?
— Elle a eu un accident.
— En voiture ?
Dans le cou d’Alexandre, une espèce de boule ovale montait et descendait, comme s’il était en train d’avaler un noyau de letchi. Cela m’a rappelé la gorge de papa à l’enterrement de grand-mère.
— Oui. Seulement, certains détails ne collent pas. Les gendarmes pensent qu’elle a pu volontairement précipiter la voiture dans la ravine. Au-dessus de Bras de Pontho. Pas loin de l’endroit où nous sommes allés pique-niquer, le weekend dernier.
— Pourquoi elle aurait fait ça ?
— Je ne sais pas. Peut-être que, toi, tu as une idée.
— J’y suis pour rien.
— Les gendarmes voulaient savoir qui elle fréquentait.
— Tu leur as donné mon nom ?
Maman s’est levée en haussant les épaules.
Alexandre a disparu. On ne l’a revu que trois semaines plus tard, après les vacances de mai. Je m’étais renseigné.
— C’est qui Astrid, maman ?
— Une très bonne amie à moi. La dame à la voiture rouge qui était venue au pique-nique à Bras de Pontho. Celle qui t’a offert le pistolet à eau.
— C’est une amie d’Alexandre aussi ?
— Oui.
— Vous avez les mêmes amis ?
— Non. Juste Astrid.
Quand Alexandre est réapparu, papa et maman étaient moins amis avec lui. Peut-être même plus amis du tout. Une gêne palpable flottait dans l’air.
En silence, Alexandre a rassemblé ses affaires. Sur le buffet, j’avais pris soin de mettre en évidence tout ce qu’il avait laissé traîner pour qu’il n’ait pas à revenir : un étui à lunettes en plastique, une boîte de plaquettes antimoustiques, des clés, un tube de crème solaire Nivea tout gras et une pochette noire en cuir.
Du courrier ouvert était tombé sur le sol. Une carte postale du port de Marseille.
Mon chéri,
Comme prévu, je serai à l’aéroport avec les enfants, le dix janvier. L’avion atterrit à sept heures trente. Tu as bien fait de partir en éclaireur. Cette séparation nous aura permis d’éloigner la menace d’un divorce. Tu as beaucoup manqué aux filles. À moi aussi. Il me tarde de t’embrasser et de découvrir cette île dont tu parles avec tant d’enthousiasme.
Bientôt, nous prendrons un nouveau départ tous les cinq. Pour le meilleur.
Je t’aime,
Ta femme,
Maude.
Un peu plus loin sur le carrelage, un message griffonné au crayon de papier, d’une écriture maladroite.
Mon amour,
C’est ainsi que notre histoire s’achève. Avec l’arrivée ici de celle que tu prétendais ne plus aimer. J’ai cru, à tort, que tu aurais le courage de la quitter. Tous ces mois au vol suspendu n’ont été pour toi qu’un jeu, pour moi un piège.
Je n’aurai pas cette force que tu n’as pas eue.
Ni celle de te serrer la main quand tu me la présenteras.
Je t’ai aimé.
Adieu,
Astrid
J’avais tout ramassé vite fait et déposé la carte sur le buffet.
Pas la lettre d’Astrid.
Après le départ d’Alexandre, j’ai interrogé maman :
— C’est quoi un « éclaireur » ?
— Quelqu’un qu’on envoie devant pour vérifier que l’on peut continuer à avancer en sécurité.
— Comme Alexandre ?
— Alexandre ?
— Oui.
— Non, Amaury, pourquoi Alexandre serait-il un éclaireur ?
— Je ne sais pas.
— Qu'est-ce que tu caches derrière ton dos ?
— Un p’tit rien calvende jaune.
— Un quoi ?
— Un p’tit rien calvende jaune.
— …
— C’est ce que tu dis, toi.
— Amaury, ce que je dis c’est : un p’tit-rien-qui a-le-ven-tre jaune.
- Fin du chapitre -

Tous les contenus du site internet de Lectivia sont protégés par la loi sur les droits d'auteur. L'utilisation, le partage ou la reproduction de toute partie du contenu sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur ou des ayants droits ou de Lectivia sera punis par la loi en vertu des règlements sur la violation du droits d'auteur et la propriété intellectuelle.

Le jour s’est levé, sans moi.
Les volets mal joints filtrent la lumière crue.
Toujours impossible de me tenir debout.
Cinquième jour de fièvre. Cinquième jour de douleurs dans le thorax et les membres. Cinquième nuit de draps trempés à changer, dans la confusion d’un esprit qui grelotte. À tâtons, je cherche un énième Doliprane sur la table de chevet où, dans l’obscurité de la chambre, des chiffres rouges clignotent sur le réveil au rythme des bzz bzz séducteurs que les moustiques femelles envoient aux mâles. Un mouvement de trop et le flacon d’alcool et le thermomètre dégringolent sur le carrelage. Sans que j’aie la force de réagir, le liquide s’étale au pied du lit, disparaît sous le sommier.
Changer de position ? Un enfer. Garder la même ? Intenable. La lumière ? Je ne sais plus où sont la lampe et l’interrupteur. Telle une branche morte, mon bras pend le long du lit. Mes doigts effleurent les carreaux que la climatisation a refroidis.
Où est la créature qui m’a piquée ?
Cet insecte de quelques millimètres, aux ailes tigrées, à la trompe sûrement éclaboussée de sang, a l’arrogance de ne même pas mourir après la piqûre. Deux jours, une semaine, un mois, que lui et ses congénères ont contaminé les habitants de l’île.
Le journal télévisé, la semaine dernière, a signalé une épidémie touchant des centaines de personnes. Clouées au fond de leur lit, quand elles ne sont pas alignées sur les chaises en plastique vert du laboratoire d’analyses médicales, les victimes s’ajoutent les unes aux autres, comme autant de trophées au palmarès des moustiques.
« À Saint-Leu, déjà onze morts », a annoncé le journaliste, affichant un air de circonstance.
Un rayon de soleil éclaire le papier chiffonné sur lequel, toutes les six heures, j’écris que j’avale un gramme de paracétamol. Et ma température dépasse trente-neuf. Mémoire de papier. Pour peu que celle de l’esprit, léchée par le feu, vienne à faire défaut. Perplexe devant les résultats de mes analyses, le médecin avait rappelé hier soir, m’a dit Louis, au réveil. Mon foie se révolte. La bestiole qui me ronge a ciblé mon point faible.
Il a dû faire beau hier.
Avant-hier aussi.
Et tous les jours d’avant.
Quel jour sommes-nous ?
Nous sommes en février, ça, j’en suis sûre. Dehors, c’est l’été. La chaleur moite, presque épaisse, amortit les ronronnements des moteurs de voiture, les cris des enfants.
Où sont mes enfants ?
Entre fièvre et délire, je les appelle :
— Théo ? Marie ?
Est-ce qu’ils s’amusent dans le jardin à débusquer les lézards, à atteindre les noix de coco d’un jet de cailloux, ou est-ce qu’ils sont à l’école, en train de faire une dictée ou de jouer au mèr, dans la cour de récréation ?
Où est Louis ?
Que fait-il ?
M’en veut-il toujours ?
Dans la nuit, les cosmonautes aux combinaisons blanches de l’Agence Régionale de Santé ont bruyamment démoustiqué le quartier à grand renfort d’insecticide. Mort aux anophèles ! Mort aux suceurs de sang qui s’agitent dans les eaux stagnantes qu’a laissées la pluie. Gaz à volonté. Pendant que de la lave en fusion pulse dans mes veines. Les bonbonnes de produit ont une taille démesurée comparée à celle des insectes. J’en ai vu dans une benne de camion, près de l’hôpital où je travaille.
Quelqu’un est entré dans la chambre. Sur la table de chevet, un bol de café noir refroidit. Quelqu’un murmure qu’il faut que je me lève. Je l’entends à peine. On tapote les oreillers informes, le fond des draps poisseux. On remet tout au carré, sans savoir que les vibrations irradient en ondes de choc dans mon squelette qui gît sur le matelas comme un mannequin tombé dans une allée de magasin.
Par la porte entrouverte, la lumière fond sur moi et déclenche des roulements de tambour dans mon crâne.
Tout me fait mal.
Tout.
Sauf l’approche de ma rupture avec Louis. Plus de force pour l’envisager, la juguler. Je dois la reléguer à un temps où la lutte redeviendra possible. Il faut être bien vivant pour rompre. J’ai abdiqué.
Un courant d’air tiède survole mon corps. Je frissonne. Ce souffle m’effraie. Il véhicule les moustiques aussi sûrement que le bus de sept heures emmène les collégiens à l’autre bout de la ville.
Qu’on ferme la porte. Qu’on remette la climatisation. Qu’on chasse l’air du dehors. Sur la commode en bois, le long du mur, un flacon d’huile de citronnelle débouché exhale un parfum trop fort qui me donne la nausée. Trop loin pour que je puisse l’atteindre.
J’entends la Ford de Louis démarrer devant la maison, puis plus rien. On doit être lundi, c’est le jour où il « monte » à Saint-Denis afin de préparer avec ses associés de l’agence l’agenda de la semaine.
Sont-ils au courant de ses déboires conjugaux ?
J’ai ouvert les yeux. Furtivement, un gecko a fui un cadre pour se glisser derrière un autre qui penche. Plus il y aura de geckos, moins il y aura de moustiques. J’ai réussi à attraper le roman de Joseph Conrad posé sur la table. Au cœur des ténèbres. C’est la troisième fois que je le lis. Depuis l’enfance, l’univers de Conrad me fascine. J’ai parcouru des yeux quatre lignes. Puis, submergée par la fièvre, je m’enfonce dans la jungle d’un cauchemar, pataugeant dans la fange, tombant tantôt sur un Kurtz assis au milieu d’une tribu mystérieuse, tantôt sur un Marlowe fumant le cigare, à la barre d’un caboteur, tantôt sur un marchand d’ivoire planqué dans les vapeurs d’un fleuve africain. La climatisation qui redémarre vrombit comme un hélicoptère. Des bruits inconnus peuplent mon rêve d’heures interminables et rouges.
C’est l’été, au beau milieu de l’océan Indien. Un été tropical. Un été de plages paradisiaques, de sable blanc à perte de vue, de récif corallien, de lagon transparent. Un été de filaos que berce la brise venue du large.
Mon vingtième à La Réunion.
Le vingtième de Louis aussi.
La saison chaude.
Une saison de pluies parfois diluviennes qui inondent la moindre parcelle de terre cuite cassée, de bidon creux ou de troncs de bananier, berceaux des larves meurtrières qui grouillent à fleur d’eau douce, dès le retour du soleil. Elles se nourriront en filtrant l’eau, puis se transformeront en monstres tueurs.
J’ai soif. Par terre, une bouteille d’Edena, presque vide. Il faudrait ramper des heures pour y arriver. J’ai trop de poids sur le dos. Mes vêtements mouillés, mon sac lourd, mes chaussures trempées de boue me ralentissent. Trop longs et emmêlés, mes cheveux se collent sur mon visage couvert d’un liquide saumâtre. Aucun son ne sort de ma bouche pâteuse. Ma soif attendra. Louis reviendra. Il connaît le chemin dans la jungle. Ce chemin jusqu’à moi, il l’a déjà parcouru tant de fois.
Le temps s’égoutte. Fuligineux. Il se dilate. De nouveau le rotor d’un hélicoptère. Non, une débroussailleuse. Elle me tire de ma léthargie. Couper l’herbe sous les pattes des moustiques. Leurs longues pattes fines comme des aiguilles. Un feu liquide me perce les chevilles. Le drap m’écrase.
Hier, le docteur Fontaine a prescrit d’autres analyses :
— Demain, tu essaieras de te lever.
Où sont mes jambes ? Enfouies dans les profondeurs du tissu dont les pliures m’écorchent la peau.
Une infirmière floue navigue dans la pièce. Mon regard n’arrive plus à faire la mise au point. Comment se fait-il qu’une infirmière sorte, comme ça, du fleuve embourbé, sans une seule tache humide sur sa robe ? Comme une sangsue, elle attrape mon poignet de ses mains ventouses, cherche les vaisseaux gonflés qui surgissent en réseau, sur ma peau. Elle pique. Mes veines roulent. L’aiguille dérape. Elle repique. Elle remplit les tubes du sang infecté qui me dégoûte. D’un geste énergique, elle secoue les flacons. Je ne la vois pas repartir. J’ai déjà replongé dans la torpeur de la jungle. Dans l’eau du fleuve où je me débats, un serpent me frôle, zigzaguant entre mes jambes, tandis que mon esprit louvoie entre hallucination et réalité.
Louis ne reviendra peut-être pas. Peut-être plus. Cette douleur-là ne m’atteint plus. Pas de place pour elle. J’en ai oublié jusqu’à la raison pour laquelle il veut me quitter. Son agence de voyages est au bord de la faillite, et alors ? Les touristes craignent la dengue, le chikungunya, les requins, le volcan, les scorpions, les noix de coco qui dégringolent des arbres. « Elles ne tombent que sur les imbéciles », dit-on. L’île intense. L’île à grand spectacle est devenue l’île de tous les dangers. Moi, j’aime les cocotiers, le ciel rougi les soirs d’éruption, les lagons peu profonds.
Moi, j’aime Louis.
Ah oui, je m’en souviens, maintenant. Louis veut me quitter car un bébé flotte dans l’eau croupie, au fond de moi. C’est une bonne raison. Une raison d’homme. Louis ne veut pas de bébé.
Aussi sûrement que le jour s’était levé, la nuit est revenue envelopper de son linceul noir les miasmes qui stagnent dans l’air enfiévré de la chambre. Sous la porte, un rai de lumière trahit une présence dans la maison. Une assiette vide et sale témoigne que j’ai mangé quelque chose. Quelque chose d’orange. Je ne sais plus quoi. Un peu de riz et de carri, sans doute, ou une mangue.
Je n’ai pas le souvenir d’avoir réussi à me lever.
Quelle heure est-il ?
Louis est-il rentré ?
Avec l’arrivée de la nuit, la débroussailleuse s’est tue. Mes sens sont en alerte. Ils guettent la moindre vibration de battements d’ailes. À La Réunion, les moustiques, on vit avec. On les observe, on les chasse, on les tue. Mais c’est la première fois que j’en ai peur.
Enchevêtrant les draps aux lianes entre lesquelles j’essaie de trouver un chemin, les flots m’engloutissent de nouveau. Je dois sortir du fleuve. Indemne, si possible. Rejoindre la terre ferme.
Après, on verra.
Louis ne veut pas de bébé.
Moi, non plus.
Louis ne veut plus de moi avec le bébé.
Moi non plus, je ne veux plus de moi avec le bébé.
Sixième jour de dengue. Phobie des moustiques. J’ai frappé dans mes mains pour en tuer un qui vrombissait, au-dessus du lit. Une tache de sang sépia reproduit le même motif dans chacune de mes paumes. Des pattes écrasées, des rayures, un bout d’aile qui s’agite encore. Envie de vomir. Mon corps me démange. Le premier gramme de paracétamol de la journée est dans mon estomac depuis une heure. La prochaine dose, pas avant midi. Le médecin a interdit l’aspirine et les anti-inflammatoires. Ils ne feraient qu’aggraver le risque d’hémorragie.
Peut-être que la dengue tuera le bébé.
Alors, Louis reviendra.
Peut-être.
J’ai beau ramper dans mes cauchemars fangeux, ils ne sont nulle part. Ni le bébé que j’avais cru entrevoir, ni Louis. Le ventre et l’espérance rongés par la fièvre, j’émerge de ce délire dans lequel flottent les débris de l’amour de Louis.
Mes jumeaux sont debout, au pied du lit.
— Maman, on va chez mamie. Papa est parti, et il a laissé ça pour toi.
Marie me tend une petite enveloppe blanche.
Les enfants disparaissent en courant, insouciants. Je déchire le papier : pas de message, juste l’alliance de Louis.
- Fin du chapitre -

Tous les contenus du site internet de Lectivia sont protégés par la loi sur les droits d'auteur. L'utilisation, le partage ou la reproduction de toute partie du contenu sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur ou des ayants droits ou de Lectivia sera punis par la loi en vertu des règlements sur la violation du droits d'auteur et la propriété intellectuelle.

9 septembre 2010.
Il y a une semaine, j’ai atterri à Orly. À moins de flotter dans les limbes, il faut bien atterrir quelque part. J’ai dix-huit ans et des études à poursuivre. Un avenir à construire. Des tas de choses devant moi, m’a-t-on dit. Je ne pense qu’à celles laissées derrière moi, dans mon île. Une valise de vingt-trois kilos, une seule, pour affronter la vie. Pas de soleil dans mes bagages.
L’année universitaire n’est pas encore commencée.
Comme le ressassent à l’envi les soldats qui marchent de force vers les lignes ennemies, je me dis qu’il faut que j’aille de l’avant.
La tête haute.
La chambre, située au cinquième étage d’un immeuble parisien, sans ascenseur, est petite, presque vide, sombre. Deux fenêtres étroites, barrées d’un croisillon en bois écaillé, donnent sur l’impasse. La rare lumière qui y pénètre s’enfonce dans la peur qui m’habite. Une peur à noircir les murs. Au-dehors, des toits de zinc et d’ardoise noyés dans la brume qui plombe la ville, nuit et jour.
Une terre inconnue qui ne me deviendra jamais familière. Le « là-bas » de mon enfance. Celui dont on rêvait et disait : « Un jour, j’irai là-bas ».
Ici, à Paris, rien ne me ressemble.
Du gris, du gris, du gris.
Cette peur qui s’infiltre en moi, comme un poison, où l’ai-je attrapée ?
J’ai essayé de me lever. Il m’a fallu cinq minutes pour déplier mes jambes, les poser sur la descente de lit râpée. Mon corps fonctionne au ralenti. Mon esprit aussi. « Lève-toi et marche », nous répétait maman, pour nous secouer, mes frères et moi, le dimanche matin. Pas de messe aujourd’hui. Pas de Dieu. Où est-Il, Celui-là, quand on a besoin de Lui ?
J’ai réussi à me redresser. J’ai fait trois pas, pieds nus, titubant sous le poids de cette saleté entre mes jambes.
Dix-sept heures.
L’intérieur de mon corps a perdu de sa substance, enseveli sous une coulée de boue. Je me suis approchée de la fenêtre. Dehors règne un calme ordinaire. Des passants regagnent leur domicile, emmitouflés dans leurs pensées de fin de journée. Des anonymes. Comme celui qui m’a agressée, hier. Des gens qu’il vaut mieux ne pas croiser.
Je n’ai pas eu cette chance. Je l’ai croisé. Un couloir de métro que je n’aurais pas emprunté, si j’avais su. Surtout pas à minuit. Avec, en plus, le bout de terrain vague à traverser à la sortie.
J’ai tourné la tête vers le réveil jaune posé sur le bureau.
Dix-sept heures trente.
Le réveil qu’Armand en pleurs m’a donné à l’aéroport de Gillot. « Tiens, comme ça tu penseras à moi tous les matins, quand tu seras à Paris. » Je n’ai pas besoin de ça pour penser à mon frère, pour penser à La Réunion.
Dix-sept heures trente seulement ! J’ai l’impression que cela fait des jours que je suis restée là, recroquevillée dans mon lit, les mains sur mon ventre douloureux, alors qu’il ne s’est écoulé que quelques heures.
Quelques petites heures.
Une éternité, pourtant.
J’ai soulevé un pan du rideau. Une voiture est passée dans la rue en bas. Comme d’habitude, elle a klaxonné pour faire accélérer un piéton négligent qui traversait au milieu de la chaussée. De l’ordinaire sous ma fenêtre dont je suis maintenant à des années-lumière. Tout ce que je perçois suinte par un filtre si épais que ne m’en parviennent plus que des bribes saccadées, comme si je voyais s’agiter des marionnettes sur une scène de carton-pâte. En quelques heures, mon monde est devenu un théâtre de guignols, la vie s’est fondue dans un décor blafard où s’agitent des pantins pressés. Je n’ai plus prise sur ce qui se passe alentour. Je ne pense qu’à mon ventre, ma déchirure, et à ce type que je n’aurais pas dû croiser. Je me sens sale. Humiliée. Aussi ridicule qu’Armand quand il s’est cassé la figure sur l’estrade, lors du spectacle de fin d’année au collège. Rires dans la salle.
Après bien des recherches dans les rues de Paris et, faute de moyens, j’ai fini par louer cette chambre, ruelle de L’Ermitage, réminiscence d’un autre Hermitage, situé sur la côte ouest de l’île. J’ai pensé que je n’étais pas arrivée dans ce quartier par hasard. Oui, mon Hermitage à moi s’étale à dix mille kilomètres de là, sous un soleil qui ne se laisse pas regarder, une lumière crue à vous aveugler. Une plage de la Saline-les-Bains. Du sable blanc à perte de vue.
J’ai vu son visage. Pas celui du soleil, non. Son visage à lui, dans ce couloir du métro. Le teint blême, les yeux resserrés en haut du nez. Un visage étroit, pointu. Tout en lui était pointu. Pointu à faire mal. Un regard sans expression. Comme si ses yeux n’étaient pas reliés à son cerveau. Je n’avais jamais vu ça avant. Jamais sur un être humain. Des yeux qu’on colle sur les poupées pour enfants. Des yeux vitreux inanimés, froids et bleus. Pas le bleu de la mer, plage de l’Hermitage, non.
Des yeux sans rien dedans.
Vides.
Des pas dans l’escalier me font sursauter. Cela doit être Michel qui rentre. Il habite à l’étage au-dessus. Il a marqué un temps d’arrêt sur le palier de mon appartement. Peut-être a-t-il songé à sonner ? J’ai fait sa connaissance il y a quatre jours. Il est passé boire un café à la sortie de ses cours. Je n’ouvrirai pas. Il secoue son trousseau de clés, et de nouveau ses pas s’éloignent. Réguliers, rassurants. Puis Michel a marché au-dessus de ma tête. Son cartable de prof est tombé sur le parquet, il a allumé la télé et tiré la chasse d’eau.
C’est la même routine tous les soirs.
La vie continue.
Celle des autres.
J’ai rabattu le pan de rideau.
Il est difficile de fuir l’intérieur de soi, surtout s’il a été envahi.
Mon regard a balayé la pièce comme si je ne la connaissais pas. Un bureau, un lit, une armoire, une chaise. Un grand miroir. Celui-là, il faudrait que je le décroche pour ne plus me voir. Mes yeux commencent aussi à perdre toute expression.
Des bips sur mon portable. Les textos attendront. L’urgence n’est plus ni mes études, ni mes amis, ni ma famille dans l’hémisphère Sud.
L’urgence est que j’appelle la police.
J’ai été prise de vertige. Mes mains moites ont glissé le long du montant en bois de la fenêtre. Je me suis agrippée à la seule chaise de la pièce. Qu’est-ce qu’ils me demanderont, les policiers ? Qu’est-ce que je leur dirai ? Je rentrais chez moi en métro, à minuit, quand il m’a…
Quand il m’a fait quoi ?
Je me suis assise. Épuisée. Il m’avait parlé. Tout d’abord dans un français saccadé, tandis qu’il tremblait sous son bonnet de laine et sa vieille veste en jean. Oui, le bonnet, je leur dirai, à la police, pour le bonnet. Je m’en souviens maintenant. Un bonnet marron plein de taches, déchiré sur le côté, avec un revers plus foncé. Le bonnet a glissé. J’ai vu qu’il n’avait pas de cheveux. J’aurais dû me méfier. Il marmonnait des choses que je ne comprenais pas. Je me suis approchée. J’ai cru qu’il avait des traces de sang sur sa veste, qu’il était blessé à la tête. Il m’a saisie au cou. Puis j’ai oublié. La lumière du jour m’a réveillée dans le terrain vague qui jouxte la ruelle.
Un vertige encore dans le silence de la chambre.
Un démon qui passe.
De la terre sur mes mollets. Des brins d’herbe collés. Et ces taches marron sur mes cuisses et mes jambes.
Encore un texto. Intrusion du monde extérieur. J’ai attrapé le portable, je l’ai éteint et jeté sur la table. Fini. Tais-toi. L’autre aussi, il s’est tu. Il ne bégaiera plus. Mais je n’ai pas fini de l’entendre.
Il hurle dans ma tête.
Je suis restée longtemps assise là, devant la fenêtre, sans penser à rien. « Ici et maintenant » disait mon prof de philo en terminale. J’aimerais mieux être ailleurs et plus tard. Bien plus tard. Ou alors, encore mieux, avant, oui, bien avant. Avant que je ne quitte mon île, mon pays, et les jours heureux. Avant que ma route ne croise celle du type au bonnet sale.
Pourquoi a-t-il croisé ma route ? Avait-il réfléchi à ça ? M’avait-il suivie les jours précédents ? Il n’y a que le silence pour me répondre. Bientôt, il n’y aura plus que du silence.
Faut que j’appelle la police.
À l’autre bout du monde, le soleil se couche. Au pays d’où je viens. Au territoire auquel j’appartiens. Une île de l’océan Indien. Tropique du Capricorne. C’est l’heure où Armand allume les tortillons antimoustiques, puis enfonce la paille dans son troisième Solpak. C’est l’heure où maman rentre la voiture dans la cour en enclenchant la marche arrière. Qu’est-ce que je fais seule ici ? Les gens disent que j’ai un accent qui chante. Ils voient bien que je ne suis pas de chez eux. Ils ne comprennent pas quand je leur demande d’arrêter de se moquer de ma façon de parler.
Ploc !
Une goutte de sang a atterri sur le parquet. Il y en a plusieurs par terre.
Ploc, ploc, ploc.
Des traces brunes le long de mes jambes et du sang plus rouge le long de mes mains. Écœurant. Je n’aurais jamais pensé que cela pût gicler si fort. Je ne lui ai donné qu’un seul coup de couteau. Je n’ai rien trouvé d’autre, sur le moment, pour me défendre, non, que ce couteau suisse que j’ai toujours dans la poche. Au cas où… On va me jeter en prison.
Personne ne comprendra.
Toc !
Ploc !
Toc !
Ploc !
Toc !
Ploc !
Quelqu’un frappe à la porte.
Je secoue mon délire.
Je rêve de retourner là-bas, de retourner en enfance.
- Fin du chapitre -

Tous les contenus du site internet de Lectivia sont protégés par la loi sur les droits d'auteur. L'utilisation, le partage ou la reproduction de toute partie du contenu sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur ou des ayants droits ou de Lectivia sera punis par la loi en vertu des règlements sur la violation du droits d'auteur et la propriété intellectuelle.