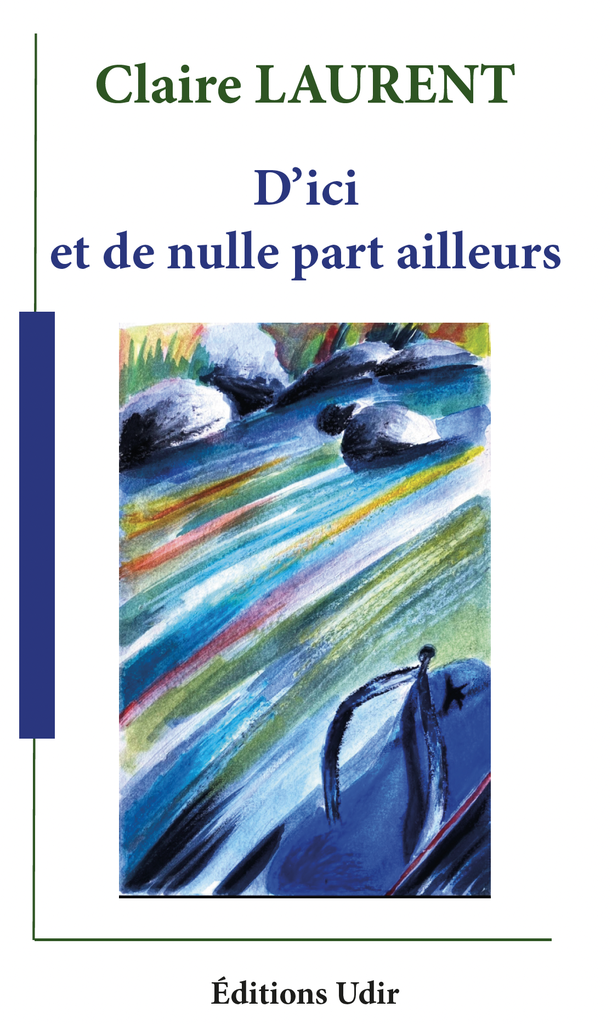
D'ici et de nulle part ailleurs
Editeur : UDIR
Auteur : Claire LAURENT
ISBN : 978-2-87863-104-3
Description :
Dans son livre D’ici et de nulle part ailleurs, Claire Laurent nous livre des histoires percutantes, tirées au cordeau, qui retracent les destins d’hommes, de femmes, d’enfants soumis aux affres de la vie. Un fil rouge relie ces histoires entre elles : La Réunion. En effet, l’île bouleverse et transforme la vie des personnages de ces douze nouvelles, comme elle a transformé la vie de l’auteure qui, dans un style réaliste et épuré, nous questionne sur l’absurdité, le tragique, les raisons de l’existence.
Laetitia Samlong Ah-Kiem
| Mis en ligne par | Lectivia |
|---|---|
| Dernière mise à jour | 09/12/2024 |
| Lecteur(s) | 1 |
Partager ce cours
Partager le lien
Partager sur les réseaux sociaux
Partager par email
Veuillez s'inscrire afin de partager ce D'ici et de nulle part ailleurs par email.

Chapitre 1 : Là-bas, mon enfance
9 septembre 2010.
Il y a une semaine, j’ai atterri à Orly. À moins de flotter dans les limbes, il faut bien atterrir quelque part. J’ai dix-huit ans et des études à poursuivre. Un avenir à construire. Des tas de choses devant moi, m’a-t-on dit. Je ne pense qu’à celles laissées derrière moi, dans mon île. Une valise de vingt-trois kilos, une seule, pour affronter la vie. Pas de soleil dans mes bagages.
L’année universitaire n’est pas encore commencée.
Comme le ressassent à l’envi les soldats qui marchent de force vers les lignes ennemies, je me dis qu’il faut que j’aille de l’avant.
La tête haute.
La chambre, située au cinquième étage d’un immeuble parisien, sans ascenseur, est petite, presque vide, sombre. Deux fenêtres étroites, barrées d’un croisillon en bois écaillé, donnent sur l’impasse. La rare lumière qui y pénètre s’enfonce dans la peur qui m’habite. Une peur à noircir les murs. Au-dehors, des toits de zinc et d’ardoise noyés dans la brume qui plombe la ville, nuit et jour.
Une terre inconnue qui ne me deviendra jamais familière. Le « là-bas » de mon enfance. Celui dont on rêvait et disait : « Un jour, j’irai là-bas ».
Ici, à Paris, rien ne me ressemble.
Du gris, du gris, du gris.
Cette peur qui s’infiltre en moi, comme un poison, où l’ai-je attrapée ?
J’ai essayé de me lever. Il m’a fallu cinq minutes pour déplier mes jambes, les poser sur la descente de lit râpée. Mon corps fonctionne au ralenti. Mon esprit aussi. « Lève-toi et marche », nous répétait maman, pour nous secouer, mes frères et moi, le dimanche matin. Pas de messe aujourd’hui. Pas de Dieu. Où est-Il, Celui-là, quand on a besoin de Lui ?
J’ai réussi à me redresser. J’ai fait trois pas, pieds nus, titubant sous le poids de cette saleté entre mes jambes.
Dix-sept heures.
L’intérieur de mon corps a perdu de sa substance, enseveli sous une coulée de boue. Je me suis approchée de la fenêtre. Dehors règne un calme ordinaire. Des passants regagnent leur domicile, emmitouflés dans leurs pensées de fin de journée. Des anonymes. Comme celui qui m’a agressée, hier. Des gens qu’il vaut mieux ne pas croiser.
Je n’ai pas eu cette chance. Je l’ai croisé. Un couloir de métro que je n’aurais pas emprunté, si j’avais su. Surtout pas à minuit. Avec, en plus, le bout de terrain vague à traverser à la sortie.
J’ai tourné la tête vers le réveil jaune posé sur le bureau.
Dix-sept heures trente.
Le réveil qu’Armand en pleurs m’a donné à l’aéroport de Gillot. « Tiens, comme ça tu penseras à moi tous les matins, quand tu seras à Paris. » Je n’ai pas besoin de ça pour penser à mon frère, pour penser à La Réunion.
Dix-sept heures trente seulement ! J’ai l’impression que cela fait des jours que je suis restée là, recroquevillée dans mon lit, les mains sur mon ventre douloureux, alors qu’il ne s’est écoulé que quelques heures.
Quelques petites heures.
Une éternité, pourtant.
J’ai soulevé un pan du rideau. Une voiture est passée dans la rue en bas. Comme d’habitude, elle a klaxonné pour faire accélérer un piéton négligent qui traversait au milieu de la chaussée. De l’ordinaire sous ma fenêtre dont je suis maintenant à des années-lumière. Tout ce que je perçois suinte par un filtre si épais que ne m’en parviennent plus que des bribes saccadées, comme si je voyais s’agiter des marionnettes sur une scène de carton-pâte. En quelques heures, mon monde est devenu un théâtre de guignols, la vie s’est fondue dans un décor blafard où s’agitent des pantins pressés. Je n’ai plus prise sur ce qui se passe alentour. Je ne pense qu’à mon ventre, ma déchirure, et à ce type que je n’aurais pas dû croiser. Je me sens sale. Humiliée. Aussi ridicule qu’Armand quand il s’est cassé la figure sur l’estrade, lors du spectacle de fin d’année au collège. Rires dans la salle.
Après bien des recherches dans les rues de Paris et, faute de moyens, j’ai fini par louer cette chambre, ruelle de L’Ermitage, réminiscence d’un autre Hermitage, situé sur la côte ouest de l’île. J’ai pensé que je n’étais pas arrivée dans ce quartier par hasard. Oui, mon Hermitage à moi s’étale à dix mille kilomètres de là, sous un soleil qui ne se laisse pas regarder, une lumière crue à vous aveugler. Une plage de la Saline-les-Bains. Du sable blanc à perte de vue.
J’ai vu son visage. Pas celui du soleil, non. Son visage à lui, dans ce couloir du métro. Le teint blême, les yeux resserrés en haut du nez. Un visage étroit, pointu. Tout en lui était pointu. Pointu à faire mal. Un regard sans expression. Comme si ses yeux n’étaient pas reliés à son cerveau. Je n’avais jamais vu ça avant. Jamais sur un être humain. Des yeux qu’on colle sur les poupées pour enfants. Des yeux vitreux inanimés, froids et bleus. Pas le bleu de la mer, plage de l’Hermitage, non.
Des yeux sans rien dedans.
Vides.
Des pas dans l’escalier me font sursauter. Cela doit être Michel qui rentre. Il habite à l’étage au-dessus. Il a marqué un temps d’arrêt sur le palier de mon appartement. Peut-être a-t-il songé à sonner ? J’ai fait sa connaissance il y a quatre jours. Il est passé boire un café à la sortie de ses cours. Je n’ouvrirai pas. Il secoue son trousseau de clés, et de nouveau ses pas s’éloignent. Réguliers, rassurants. Puis Michel a marché au-dessus de ma tête. Son cartable de prof est tombé sur le parquet, il a allumé la télé et tiré la chasse d’eau.
C’est la même routine tous les soirs.
La vie continue.
Celle des autres.
J’ai rabattu le pan de rideau.
Il est difficile de fuir l’intérieur de soi, surtout s’il a été envahi.
Mon regard a balayé la pièce comme si je ne la connaissais pas. Un bureau, un lit, une armoire, une chaise. Un grand miroir. Celui-là, il faudrait que je le décroche pour ne plus me voir. Mes yeux commencent aussi à perdre toute expression.
Des bips sur mon portable. Les textos attendront. L’urgence n’est plus ni mes études, ni mes amis, ni ma famille dans l’hémisphère Sud.
L’urgence est que j’appelle la police.
J’ai été prise de vertige. Mes mains moites ont glissé le long du montant en bois de la fenêtre. Je me suis agrippée à la seule chaise de la pièce. Qu’est-ce qu’ils me demanderont, les policiers ? Qu’est-ce que je leur dirai ? Je rentrais chez moi en métro, à minuit, quand il m’a…
Quand il m’a fait quoi ?
Je me suis assise. Épuisée. Il m’avait parlé. Tout d’abord dans un français saccadé, tandis qu’il tremblait sous son bonnet de laine et sa vieille veste en jean. Oui, le bonnet, je leur dirai, à la police, pour le bonnet. Je m’en souviens maintenant. Un bonnet marron plein de taches, déchiré sur le côté, avec un revers plus foncé. Le bonnet a glissé. J’ai vu qu’il n’avait pas de cheveux. J’aurais dû me méfier. Il marmonnait des choses que je ne comprenais pas. Je me suis approchée. J’ai cru qu’il avait des traces de sang sur sa veste, qu’il était blessé à la tête. Il m’a saisie au cou. Puis j’ai oublié. La lumière du jour m’a réveillée dans le terrain vague qui jouxte la ruelle.
Un vertige encore dans le silence de la chambre.
Un démon qui passe.
De la terre sur mes mollets. Des brins d’herbe collés. Et ces taches marron sur mes cuisses et mes jambes.
Encore un texto. Intrusion du monde extérieur. J’ai attrapé le portable, je l’ai éteint et jeté sur la table. Fini. Tais-toi. L’autre aussi, il s’est tu. Il ne bégaiera plus. Mais je n’ai pas fini de l’entendre.
Il hurle dans ma tête.
Je suis restée longtemps assise là, devant la fenêtre, sans penser à rien. « Ici et maintenant » disait mon prof de philo en terminale. J’aimerais mieux être ailleurs et plus tard. Bien plus tard. Ou alors, encore mieux, avant, oui, bien avant. Avant que je ne quitte mon île, mon pays, et les jours heureux. Avant que ma route ne croise celle du type au bonnet sale.
Pourquoi a-t-il croisé ma route ? Avait-il réfléchi à ça ? M’avait-il suivie les jours précédents ? Il n’y a que le silence pour me répondre. Bientôt, il n’y aura plus que du silence.
Faut que j’appelle la police.
À l’autre bout du monde, le soleil se couche. Au pays d’où je viens. Au territoire auquel j’appartiens. Une île de l’océan Indien. Tropique du Capricorne. C’est l’heure où Armand allume les tortillons antimoustiques, puis enfonce la paille dans son troisième Solpak. C’est l’heure où maman rentre la voiture dans la cour en enclenchant la marche arrière. Qu’est-ce que je fais seule ici ? Les gens disent que j’ai un accent qui chante. Ils voient bien que je ne suis pas de chez eux. Ils ne comprennent pas quand je leur demande d’arrêter de se moquer de ma façon de parler.
Ploc !
Une goutte de sang a atterri sur le parquet. Il y en a plusieurs par terre.
Ploc, ploc, ploc.
Des traces brunes le long de mes jambes et du sang plus rouge le long de mes mains. Écœurant. Je n’aurais jamais pensé que cela pût gicler si fort. Je ne lui ai donné qu’un seul coup de couteau. Je n’ai rien trouvé d’autre, sur le moment, pour me défendre, non, que ce couteau suisse que j’ai toujours dans la poche. Au cas où… On va me jeter en prison.
Personne ne comprendra.
Toc !
Ploc !
Toc !
Ploc !
Toc !
Ploc !
Quelqu’un frappe à la porte.
Je secoue mon délire.
Je rêve de retourner là-bas, de retourner en enfance.
- Fin du chapitre -

Tous les contenus du site internet de Lectivia sont protégés par la loi sur les droits d'auteur. L'utilisation, le partage ou la reproduction de toute partie du contenu sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur ou des ayants droits ou de Lectivia sera punis par la loi en vertu des règlements sur la violation du droits d'auteur et la propriété intellectuelle.

9 septembre 2010.
Il y a une semaine, j’ai atterri à Orly. À moins de flotter dans les limbes, il faut bien atterrir quelque part. J’ai dix-huit ans et des études à poursuivre. Un avenir à construire. Des tas de choses devant moi, m’a-t-on dit. Je ne pense qu’à celles laissées derrière moi, dans mon île. Une valise de vingt-trois kilos, une seule, pour affronter la vie. Pas de soleil dans mes bagages.
L’année universitaire n’est pas encore commencée.
Comme le ressassent à l’envi les soldats qui marchent de force vers les lignes ennemies, je me dis qu’il faut que j’aille de l’avant.
La tête haute.
La chambre, située au cinquième étage d’un immeuble parisien, sans ascenseur, est petite, presque vide, sombre. Deux fenêtres étroites, barrées d’un croisillon en bois écaillé, donnent sur l’impasse. La rare lumière qui y pénètre s’enfonce dans la peur qui m’habite. Une peur à noircir les murs. Au-dehors, des toits de zinc et d’ardoise noyés dans la brume qui plombe la ville, nuit et jour.
Une terre inconnue qui ne me deviendra jamais familière. Le « là-bas » de mon enfance. Celui dont on rêvait et disait : « Un jour, j’irai là-bas ».
Ici, à Paris, rien ne me ressemble.
Du gris, du gris, du gris.
Cette peur qui s’infiltre en moi, comme un poison, où l’ai-je attrapée ?
J’ai essayé de me lever. Il m’a fallu cinq minutes pour déplier mes jambes, les poser sur la descente de lit râpée. Mon corps fonctionne au ralenti. Mon esprit aussi. « Lève-toi et marche », nous répétait maman, pour nous secouer, mes frères et moi, le dimanche matin. Pas de messe aujourd’hui. Pas de Dieu. Où est-Il, Celui-là, quand on a besoin de Lui ?
J’ai réussi à me redresser. J’ai fait trois pas, pieds nus, titubant sous le poids de cette saleté entre mes jambes.
Dix-sept heures.
L’intérieur de mon corps a perdu de sa substance, enseveli sous une coulée de boue. Je me suis approchée de la fenêtre. Dehors règne un calme ordinaire. Des passants regagnent leur domicile, emmitouflés dans leurs pensées de fin de journée. Des anonymes. Comme celui qui m’a agressée, hier. Des gens qu’il vaut mieux ne pas croiser.
Je n’ai pas eu cette chance. Je l’ai croisé. Un couloir de métro que je n’aurais pas emprunté, si j’avais su. Surtout pas à minuit. Avec, en plus, le bout de terrain vague à traverser à la sortie.
J’ai tourné la tête vers le réveil jaune posé sur le bureau.
Dix-sept heures trente.
Le réveil qu’Armand en pleurs m’a donné à l’aéroport de Gillot. « Tiens, comme ça tu penseras à moi tous les matins, quand tu seras à Paris. » Je n’ai pas besoin de ça pour penser à mon frère, pour penser à La Réunion.
Dix-sept heures trente seulement ! J’ai l’impression que cela fait des jours que je suis restée là, recroquevillée dans mon lit, les mains sur mon ventre douloureux, alors qu’il ne s’est écoulé que quelques heures.
Quelques petites heures.
Une éternité, pourtant.
J’ai soulevé un pan du rideau. Une voiture est passée dans la rue en bas. Comme d’habitude, elle a klaxonné pour faire accélérer un piéton négligent qui traversait au milieu de la chaussée. De l’ordinaire sous ma fenêtre dont je suis maintenant à des années-lumière. Tout ce que je perçois suinte par un filtre si épais que ne m’en parviennent plus que des bribes saccadées, comme si je voyais s’agiter des marionnettes sur une scène de carton-pâte. En quelques heures, mon monde est devenu un théâtre de guignols, la vie s’est fondue dans un décor blafard où s’agitent des pantins pressés. Je n’ai plus prise sur ce qui se passe alentour. Je ne pense qu’à mon ventre, ma déchirure, et à ce type que je n’aurais pas dû croiser. Je me sens sale. Humiliée. Aussi ridicule qu’Armand quand il s’est cassé la figure sur l’estrade, lors du spectacle de fin d’année au collège. Rires dans la salle.
Après bien des recherches dans les rues de Paris et, faute de moyens, j’ai fini par louer cette chambre, ruelle de L’Ermitage, réminiscence d’un autre Hermitage, situé sur la côte ouest de l’île. J’ai pensé que je n’étais pas arrivée dans ce quartier par hasard. Oui, mon Hermitage à moi s’étale à dix mille kilomètres de là, sous un soleil qui ne se laisse pas regarder, une lumière crue à vous aveugler. Une plage de la Saline-les-Bains. Du sable blanc à perte de vue.
J’ai vu son visage. Pas celui du soleil, non. Son visage à lui, dans ce couloir du métro. Le teint blême, les yeux resserrés en haut du nez. Un visage étroit, pointu. Tout en lui était pointu. Pointu à faire mal. Un regard sans expression. Comme si ses yeux n’étaient pas reliés à son cerveau. Je n’avais jamais vu ça avant. Jamais sur un être humain. Des yeux qu’on colle sur les poupées pour enfants. Des yeux vitreux inanimés, froids et bleus. Pas le bleu de la mer, plage de l’Hermitage, non.
Des yeux sans rien dedans.
Vides.
Des pas dans l’escalier me font sursauter. Cela doit être Michel qui rentre. Il habite à l’étage au-dessus. Il a marqué un temps d’arrêt sur le palier de mon appartement. Peut-être a-t-il songé à sonner ? J’ai fait sa connaissance il y a quatre jours. Il est passé boire un café à la sortie de ses cours. Je n’ouvrirai pas. Il secoue son trousseau de clés, et de nouveau ses pas s’éloignent. Réguliers, rassurants. Puis Michel a marché au-dessus de ma tête. Son cartable de prof est tombé sur le parquet, il a allumé la télé et tiré la chasse d’eau.
C’est la même routine tous les soirs.
La vie continue.
Celle des autres.
J’ai rabattu le pan de rideau.
Il est difficile de fuir l’intérieur de soi, surtout s’il a été envahi.
Mon regard a balayé la pièce comme si je ne la connaissais pas. Un bureau, un lit, une armoire, une chaise. Un grand miroir. Celui-là, il faudrait que je le décroche pour ne plus me voir. Mes yeux commencent aussi à perdre toute expression.
Des bips sur mon portable. Les textos attendront. L’urgence n’est plus ni mes études, ni mes amis, ni ma famille dans l’hémisphère Sud.
L’urgence est que j’appelle la police.
J’ai été prise de vertige. Mes mains moites ont glissé le long du montant en bois de la fenêtre. Je me suis agrippée à la seule chaise de la pièce. Qu’est-ce qu’ils me demanderont, les policiers ? Qu’est-ce que je leur dirai ? Je rentrais chez moi en métro, à minuit, quand il m’a…
Quand il m’a fait quoi ?
Je me suis assise. Épuisée. Il m’avait parlé. Tout d’abord dans un français saccadé, tandis qu’il tremblait sous son bonnet de laine et sa vieille veste en jean. Oui, le bonnet, je leur dirai, à la police, pour le bonnet. Je m’en souviens maintenant. Un bonnet marron plein de taches, déchiré sur le côté, avec un revers plus foncé. Le bonnet a glissé. J’ai vu qu’il n’avait pas de cheveux. J’aurais dû me méfier. Il marmonnait des choses que je ne comprenais pas. Je me suis approchée. J’ai cru qu’il avait des traces de sang sur sa veste, qu’il était blessé à la tête. Il m’a saisie au cou. Puis j’ai oublié. La lumière du jour m’a réveillée dans le terrain vague qui jouxte la ruelle.
Un vertige encore dans le silence de la chambre.
Un démon qui passe.
De la terre sur mes mollets. Des brins d’herbe collés. Et ces taches marron sur mes cuisses et mes jambes.
Encore un texto. Intrusion du monde extérieur. J’ai attrapé le portable, je l’ai éteint et jeté sur la table. Fini. Tais-toi. L’autre aussi, il s’est tu. Il ne bégaiera plus. Mais je n’ai pas fini de l’entendre.
Il hurle dans ma tête.
Je suis restée longtemps assise là, devant la fenêtre, sans penser à rien. « Ici et maintenant » disait mon prof de philo en terminale. J’aimerais mieux être ailleurs et plus tard. Bien plus tard. Ou alors, encore mieux, avant, oui, bien avant. Avant que je ne quitte mon île, mon pays, et les jours heureux. Avant que ma route ne croise celle du type au bonnet sale.
Pourquoi a-t-il croisé ma route ? Avait-il réfléchi à ça ? M’avait-il suivie les jours précédents ? Il n’y a que le silence pour me répondre. Bientôt, il n’y aura plus que du silence.
Faut que j’appelle la police.
À l’autre bout du monde, le soleil se couche. Au pays d’où je viens. Au territoire auquel j’appartiens. Une île de l’océan Indien. Tropique du Capricorne. C’est l’heure où Armand allume les tortillons antimoustiques, puis enfonce la paille dans son troisième Solpak. C’est l’heure où maman rentre la voiture dans la cour en enclenchant la marche arrière. Qu’est-ce que je fais seule ici ? Les gens disent que j’ai un accent qui chante. Ils voient bien que je ne suis pas de chez eux. Ils ne comprennent pas quand je leur demande d’arrêter de se moquer de ma façon de parler.
Ploc !
Une goutte de sang a atterri sur le parquet. Il y en a plusieurs par terre.
Ploc, ploc, ploc.
Des traces brunes le long de mes jambes et du sang plus rouge le long de mes mains. Écœurant. Je n’aurais jamais pensé que cela pût gicler si fort. Je ne lui ai donné qu’un seul coup de couteau. Je n’ai rien trouvé d’autre, sur le moment, pour me défendre, non, que ce couteau suisse que j’ai toujours dans la poche. Au cas où… On va me jeter en prison.
Personne ne comprendra.
Toc !
Ploc !
Toc !
Ploc !
Toc !
Ploc !
Quelqu’un frappe à la porte.
Je secoue mon délire.
Je rêve de retourner là-bas, de retourner en enfance.
- Fin du chapitre -

Tous les contenus du site internet de Lectivia sont protégés par la loi sur les droits d'auteur. L'utilisation, le partage ou la reproduction de toute partie du contenu sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur ou des ayants droits ou de Lectivia sera punis par la loi en vertu des règlements sur la violation du droits d'auteur et la propriété intellectuelle.

Le jour s’est levé, sans moi.
Les volets mal joints filtrent la lumière crue.
Toujours impossible de me tenir debout.
Cinquième jour de fièvre. Cinquième jour de douleurs dans le thorax et les membres. Cinquième nuit de draps trempés à changer, dans la confusion d’un esprit qui grelotte. À tâtons, je cherche un énième Doliprane sur la table de chevet où, dans l’obscurité de la chambre, des chiffres rouges clignotent sur le réveil au rythme des bzz bzz séducteurs que les moustiques femelles envoient aux mâles. Un mouvement de trop et le flacon d’alcool et le thermomètre dégringolent sur le carrelage. Sans que j’aie la force de réagir, le liquide s’étale au pied du lit, disparaît sous le sommier.
Changer de position ? Un enfer. Garder la même ? Intenable. La lumière ? Je ne sais plus où sont la lampe et l’interrupteur. Telle une branche morte, mon bras pend le long du lit. Mes doigts effleurent les carreaux que la climatisation a refroidis.
Où est la créature qui m’a piquée ?
Cet insecte de quelques millimètres, aux ailes tigrées, à la trompe sûrement éclaboussée de sang, a l’arrogance de ne même pas mourir après la piqûre. Deux jours, une semaine, un mois, que lui et ses congénères ont contaminé les habitants de l’île.
Le journal télévisé, la semaine dernière, a signalé une épidémie touchant des centaines de personnes. Clouées au fond de leur lit, quand elles ne sont pas alignées sur les chaises en plastique vert du laboratoire d’analyses médicales, les victimes s’ajoutent les unes aux autres, comme autant de trophées au palmarès des moustiques.
« À Saint-Leu, déjà onze morts », a annoncé le journaliste, affichant un air de circonstance.
Un rayon de soleil éclaire le papier chiffonné sur lequel, toutes les six heures, j’écris que j’avale un gramme de paracétamol. Et ma température dépasse trente-neuf. Mémoire de papier. Pour peu que celle de l’esprit, léchée par le feu, vienne à faire défaut. Perplexe devant les résultats de mes analyses, le médecin avait rappelé hier soir, m’a dit Louis, au réveil. Mon foie se révolte. La bestiole qui me ronge a ciblé mon point faible.
Il a dû faire beau hier.
Avant-hier aussi.
Et tous les jours d’avant.
Quel jour sommes-nous ?
Nous sommes en février, ça, j’en suis sûre. Dehors, c’est l’été. La chaleur moite, presque épaisse, amortit les ronronnements des moteurs de voiture, les cris des enfants.
Où sont mes enfants ?
Entre fièvre et délire, je les appelle :
— Théo ? Marie ?
Est-ce qu’ils s’amusent dans le jardin à débusquer les lézards, à atteindre les noix de coco d’un jet de cailloux, ou est-ce qu’ils sont à l’école, en train de faire une dictée ou de jouer au mèr, dans la cour de récréation ?
Où est Louis ?
Que fait-il ?
M’en veut-il toujours ?
Dans la nuit, les cosmonautes aux combinaisons blanches de l’Agence Régionale de Santé ont bruyamment démoustiqué le quartier à grand renfort d’insecticide. Mort aux anophèles ! Mort aux suceurs de sang qui s’agitent dans les eaux stagnantes qu’a laissées la pluie. Gaz à volonté. Pendant que de la lave en fusion pulse dans mes veines. Les bonbonnes de produit ont une taille démesurée comparée à celle des insectes. J’en ai vu dans une benne de camion, près de l’hôpital où je travaille.
Quelqu’un est entré dans la chambre. Sur la table de chevet, un bol de café noir refroidit. Quelqu’un murmure qu’il faut que je me lève. Je l’entends à peine. On tapote les oreillers informes, le fond des draps poisseux. On remet tout au carré, sans savoir que les vibrations irradient en ondes de choc dans mon squelette qui gît sur le matelas comme un mannequin tombé dans une allée de magasin.
Par la porte entrouverte, la lumière fond sur moi et déclenche des roulements de tambour dans mon crâne.
Tout me fait mal.
Tout.
Sauf l’approche de ma rupture avec Louis. Plus de force pour l’envisager, la juguler. Je dois la reléguer à un temps où la lutte redeviendra possible. Il faut être bien vivant pour rompre. J’ai abdiqué.
Un courant d’air tiède survole mon corps. Je frissonne. Ce souffle m’effraie. Il véhicule les moustiques aussi sûrement que le bus de sept heures emmène les collégiens à l’autre bout de la ville.
Qu’on ferme la porte. Qu’on remette la climatisation. Qu’on chasse l’air du dehors. Sur la commode en bois, le long du mur, un flacon d’huile de citronnelle débouché exhale un parfum trop fort qui me donne la nausée. Trop loin pour que je puisse l’atteindre.
J’entends la Ford de Louis démarrer devant la maison, puis plus rien. On doit être lundi, c’est le jour où il « monte » à Saint-Denis afin de préparer avec ses associés de l’agence l’agenda de la semaine.
Sont-ils au courant de ses déboires conjugaux ?
J’ai ouvert les yeux. Furtivement, un gecko a fui un cadre pour se glisser derrière un autre qui penche. Plus il y aura de geckos, moins il y aura de moustiques. J’ai réussi à attraper le roman de Joseph Conrad posé sur la table. Au cœur des ténèbres. C’est la troisième fois que je le lis. Depuis l’enfance, l’univers de Conrad me fascine. J’ai parcouru des yeux quatre lignes. Puis, submergée par la fièvre, je m’enfonce dans la jungle d’un cauchemar, pataugeant dans la fange, tombant tantôt sur un Kurtz assis au milieu d’une tribu mystérieuse, tantôt sur un Marlowe fumant le cigare, à la barre d’un caboteur, tantôt sur un marchand d’ivoire planqué dans les vapeurs d’un fleuve africain. La climatisation qui redémarre vrombit comme un hélicoptère. Des bruits inconnus peuplent mon rêve d’heures interminables et rouges.
C’est l’été, au beau milieu de l’océan Indien. Un été tropical. Un été de plages paradisiaques, de sable blanc à perte de vue, de récif corallien, de lagon transparent. Un été de filaos que berce la brise venue du large.
Mon vingtième à La Réunion.
Le vingtième de Louis aussi.
La saison chaude.
Une saison de pluies parfois diluviennes qui inondent la moindre parcelle de terre cuite cassée, de bidon creux ou de troncs de bananier, berceaux des larves meurtrières qui grouillent à fleur d’eau douce, dès le retour du soleil. Elles se nourriront en filtrant l’eau, puis se transformeront en monstres tueurs.
J’ai soif. Par terre, une bouteille d’Edena, presque vide. Il faudrait ramper des heures pour y arriver. J’ai trop de poids sur le dos. Mes vêtements mouillés, mon sac lourd, mes chaussures trempées de boue me ralentissent. Trop longs et emmêlés, mes cheveux se collent sur mon visage couvert d’un liquide saumâtre. Aucun son ne sort de ma bouche pâteuse. Ma soif attendra. Louis reviendra. Il connaît le chemin dans la jungle. Ce chemin jusqu’à moi, il l’a déjà parcouru tant de fois.
Le temps s’égoutte. Fuligineux. Il se dilate. De nouveau le rotor d’un hélicoptère. Non, une débroussailleuse. Elle me tire de ma léthargie. Couper l’herbe sous les pattes des moustiques. Leurs longues pattes fines comme des aiguilles. Un feu liquide me perce les chevilles. Le drap m’écrase.
Hier, le docteur Fontaine a prescrit d’autres analyses :
— Demain, tu essaieras de te lever.
Où sont mes jambes ? Enfouies dans les profondeurs du tissu dont les pliures m’écorchent la peau.
Une infirmière floue navigue dans la pièce. Mon regard n’arrive plus à faire la mise au point. Comment se fait-il qu’une infirmière sorte, comme ça, du fleuve embourbé, sans une seule tache humide sur sa robe ? Comme une sangsue, elle attrape mon poignet de ses mains ventouses, cherche les vaisseaux gonflés qui surgissent en réseau, sur ma peau. Elle pique. Mes veines roulent. L’aiguille dérape. Elle repique. Elle remplit les tubes du sang infecté qui me dégoûte. D’un geste énergique, elle secoue les flacons. Je ne la vois pas repartir. J’ai déjà replongé dans la torpeur de la jungle. Dans l’eau du fleuve où je me débats, un serpent me frôle, zigzaguant entre mes jambes, tandis que mon esprit louvoie entre hallucination et réalité.
Louis ne reviendra peut-être pas. Peut-être plus. Cette douleur-là ne m’atteint plus. Pas de place pour elle. J’en ai oublié jusqu’à la raison pour laquelle il veut me quitter. Son agence de voyages est au bord de la faillite, et alors ? Les touristes craignent la dengue, le chikungunya, les requins, le volcan, les scorpions, les noix de coco qui dégringolent des arbres. « Elles ne tombent que sur les imbéciles », dit-on. L’île intense. L’île à grand spectacle est devenue l’île de tous les dangers. Moi, j’aime les cocotiers, le ciel rougi les soirs d’éruption, les lagons peu profonds.
Moi, j’aime Louis.
Ah oui, je m’en souviens, maintenant. Louis veut me quitter car un bébé flotte dans l’eau croupie, au fond de moi. C’est une bonne raison. Une raison d’homme. Louis ne veut pas de bébé.
Aussi sûrement que le jour s’était levé, la nuit est revenue envelopper de son linceul noir les miasmes qui stagnent dans l’air enfiévré de la chambre. Sous la porte, un rai de lumière trahit une présence dans la maison. Une assiette vide et sale témoigne que j’ai mangé quelque chose. Quelque chose d’orange. Je ne sais plus quoi. Un peu de riz et de carri, sans doute, ou une mangue.
Je n’ai pas le souvenir d’avoir réussi à me lever.
Quelle heure est-il ?
Louis est-il rentré ?
Avec l’arrivée de la nuit, la débroussailleuse s’est tue. Mes sens sont en alerte. Ils guettent la moindre vibration de battements d’ailes. À La Réunion, les moustiques, on vit avec. On les observe, on les chasse, on les tue. Mais c’est la première fois que j’en ai peur.
Enchevêtrant les draps aux lianes entre lesquelles j’essaie de trouver un chemin, les flots m’engloutissent de nouveau. Je dois sortir du fleuve. Indemne, si possible. Rejoindre la terre ferme.
Après, on verra.
Louis ne veut pas de bébé.
Moi, non plus.
Louis ne veut plus de moi avec le bébé.
Moi non plus, je ne veux plus de moi avec le bébé.
Sixième jour de dengue. Phobie des moustiques. J’ai frappé dans mes mains pour en tuer un qui vrombissait, au-dessus du lit. Une tache de sang sépia reproduit le même motif dans chacune de mes paumes. Des pattes écrasées, des rayures, un bout d’aile qui s’agite encore. Envie de vomir. Mon corps me démange. Le premier gramme de paracétamol de la journée est dans mon estomac depuis une heure. La prochaine dose, pas avant midi. Le médecin a interdit l’aspirine et les anti-inflammatoires. Ils ne feraient qu’aggraver le risque d’hémorragie.
Peut-être que la dengue tuera le bébé.
Alors, Louis reviendra.
Peut-être.
J’ai beau ramper dans mes cauchemars fangeux, ils ne sont nulle part. Ni le bébé que j’avais cru entrevoir, ni Louis. Le ventre et l’espérance rongés par la fièvre, j’émerge de ce délire dans lequel flottent les débris de l’amour de Louis.
Mes jumeaux sont debout, au pied du lit.
— Maman, on va chez mamie. Papa est parti, et il a laissé ça pour toi.
Marie me tend une petite enveloppe blanche.
Les enfants disparaissent en courant, insouciants. Je déchire le papier : pas de message, juste l’alliance de Louis.
- Fin du chapitre -

Tous les contenus du site internet de Lectivia sont protégés par la loi sur les droits d'auteur. L'utilisation, le partage ou la reproduction de toute partie du contenu sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur ou des ayants droits ou de Lectivia sera punis par la loi en vertu des règlements sur la violation du droits d'auteur et la propriété intellectuelle.

Nous étions six et tout tenait dans deux malles. Six vies bien rangées dans deux cantines d’occasion en fer, déjà cabossées, avant même de quitter la maison. Des vêtements d’été, de la vaisselle, les livres de maman. Des choses futiles comme le nounours pelé d’Armand ; d’autres, utiles, comme la corne de brume de papa et mon répertoire téléphonique.
Là-bas, pas de téléphone, nous avait-on prévenus.
On verrait bien.
Aucun de nous six n’avait jamais pris l’avion. Nuit et jour, des rêves de récifs coralliens, d’éruption volcanique, de marches sur le feu, caracolaient dans nos têtes. Malgré nous, nos corps excités gesticulaient.
— Non, Arnaud, pas dans la malle bleue, dans la verte, celle qu’on ouvrira en premier.
— Comme tu voudras.
— On ne va pas tout déballer en arrivant.
Maman régnait sur l’organisation. Papa obéissait en sifflotant. Les cantines avalaient les cartons de bibelots, les sacs de linge, les paniers de jouets. Un mois plus tôt, les meubles avaient valsé lors du passage musclé des déménageurs.
Un matin d’août 1972, le taxi qui s’est garé devant notre petite maison, au sud de Paris, n’était pas celui que j’avais imaginé, mais nous étions six avec deux malles.
Les portières du véhicule se sont ouvertes sur trois rangées de banquettes en tissu rouge. Personne n’est monté à côté du chauffeur. Était-ce interdit ? Papa et maman avaient-ils peur de s’asseoir à la place du mort ?
Quand nous quittions Paris pour les vacances et roulions des heures en direction de la mer, maman criait toujours :
— Moins vite, Arnaud, c’est moi qui suis à la place du mort.
Alors, parfois, pour lui faire plaisir, papa ralentissait. Parfois, il accélérait. Exprès. Pour son plaisir, car la vitesse le grisait. Et nous, à l’arrière, nous l’encouragions en chantant :
— Papa, si t’es champion, appuie-eu, appuie-eu, papa, si t’es champion, appuie sur l’champignon.
Quand un panneau indiquait un dos-d’âne, nous le suppliions d’accélérer encore. La vieille Peugeot bondissait et nos derrières décollaient des banquettes, comme les crêpes de la poêle à la Chandeleur. On riait aux éclats. Sauf maman. Elle ne disait plus rien. Enfoncée dans son siège, elle regardait par la fenêtre du mort.
Donc, le jour du départ, mes parents ont pris place à l’avant, sans doute pour donner les indications au chauffeur :
— À l’aéroport d’Orly, s’il vous plaît.
Maman portait sa belle robe violette à manches courtes, un gilet blanc avec des franges aux poignets et des sandales neuves. Ses cheveux bouclés dégringolaient sur son visage rond et s’entortillaient dans son collier de perles multicolores. Papa avait ciré ses chaussures. En pantalon marron, chemisette kaki et veste en toile, rasé de près, il avait l’air plus jeune.
Depuis des semaines, l’évocation de l’aéroport éperonnait notre imagination. Derrière les parents se sont installés les deux grands, Anna et Adrian, et, tout au fond, mon petit frère Armand et moi. Dans le coffre, les bagages empilés. Sur la plage arrière, les vieux chandails (au cas où) qu’on laisserait sûrement à l’aéroport. Là où nous allions, la chaleur nous « habillerait », avait plaisanté mon grand-père, debout sur le trottoir, la larme à l’œil, appuyé sur son éternel parapluie « au cas où… ».
Le chauffeur a disparu derrière la casquette d’Adrian qui s’asseyait toujours à côté d’Anna, sinon il se chamaillait avec Armand. La voiture a démarré. Une avalanche de pulls nous a engloutis.
Avalanche avec un grand A, comme nos prénoms.
Longtemps, j’ai cru que tous les prénoms commençaient par un A, jusqu’à ce que je découvre, à six ans, qu’il s’agissait d’une fantaisie de mon père. Il ne rêvait pas d’une famille. Il rêvait d’une équipe de football. Onze joueurs, tous pareils, qui se passeraient un ballon en s’encourageant jusqu’à ce que victoire s’ensuive. Ne pouvant nous affubler d’un dossard de couleur, il avait choisi l’initiale A en signe de ralliement. Nous l’avions échappé belle : j’aurais pu m’appeler Atchoum, et Armand, Abracadabra.
Dans le taxi, papa, renseigné par un de ses collègues habitué aux voyages en avion, nous a tout expliqué : le chewing-gum à mâcher au décollage et à l’atterrissage, le risque de dépressurisation, les masques à élastique qui tombent sous le nez, le sac à vomi dans la pochette du dossier de devant, les boutons des sièges sur lesquels, pour une fois, nous aurions le droit d’appuyer à volonté.
Après une escale à quatre heures du matin, dans la fournaise de l’aéroport de Djibouti, le Boeing 707 d’Air France s’est posé à dix mille kilomètres de Paris, sur une langue de bitume qui empiétait sur l’océan Indien. Nous avons dîné, regardé un film sur un petit écran à l’avant de la cabine, dormi. Au petit-déjeuner, nous avons mangé une omelette avec des saucisses. À force de triturer le bouton pour l’incliner et le redresser, Armand a déglingué son siège. Assis, allongé, assis, allongé, assis, cassé.
Nous sommes enfin arrivés à La Réunion.
Sur la gauche de la piste d’atterrissage, la mer, rien que la mer.
Sur la droite, des plumets roses qui dansaient dans le vent au bout de longues tiges vertes semblables à des roseaux, et une montagne, au loin.
Adrian et Anna ont aidé papa à ranger les bagages dans le coffre d’un taxi. Nous avons quitté l’aéroport de Gillot où deux ventilateurs brassaient au ralenti un mélange d’air chaud et de poussière.
Le chauffeur avait la peau noire. Je n’avais jamais vu d’homme noir. Des gens à la peau marron, oui, comme la cousine de maman, ou le père de Martine qui nous gardait le jeudi après-midi. J’ai demandé à maman si nous allions changer de couleur, nous aussi. Elle voulait toujours qu’on bronze pendant les vacances.
— Oui, c’est sûr. Vous ne serez plus aussi pâlichons, hein, Arnaud ?
Elle souriait bêtement.
(Adrian prétend qu’être amoureux donne l’air idiot).
Ensuite, elle a lancé à papa :
— Regarde, les champs de canne, Arnaud. Comme sur les photos.
Et papa de préciser :
— C’est de la canne à sucre, les enfants.
Du sucre poussait dans les champs !
— J’ai faim. Qu’est-ce qu’on va manger ?
Armand ne pensait qu’à ça. Son ventre gargouillait.
— Un p’tit rien calvende jaune, a rétorqué maman, pour lui clouer le bec.
Au Tampon, le chauffeur nous a déposés au fond d’une ruelle. Une bâtisse beige à étage se cachait derrière un jardin aussi touffu que la jungle de Mowgli. Comme les tentacules d’une pieuvre géante, les racines des arbres avançaient sur la terre rouge.
Dès le lendemain, l’immense terrain vague tout autour accueillerait nos jeux quotidiens. Des cris d’enfants résonnaient jusqu’à nous et, tous les quatre, nous vibrions déjà de l’envie de nous mêler à eux.
— Vous irez jouer tout à l’heure. Pour le moment, on s’installe. Chacun récupère ses affaires et les transporte dans sa chambre. C’est valable pour toi aussi, Armand.
En sortant les bagages, Adrian et papa ont laissé tomber une malle sur la terrasse dont le sol carrelé ressemblait à l’échiquier d’Adrian. Maman s’est énervée.
— Faites un peu attention, vous deux !
Et moi d’ajouter :
— De toute façon, elle est tellement cabossée qu’une cabosse de plus ou une de moins, ça ne se verra pas.
Mais là, elle n’était plus cabossée, elle était explosée. Des livres ouverts à plat ventre et des jouets s’étalaient partout. Des soutiens-gorge rampaient sur le damier comme des serpents sur des cailloux. Adrian a shooté dans le nounours d’Armand qui s’est retrouvé accroché à une branche, comme un koala à son eucalyptus. Armand s’est mis à pleurer. Des larmes de crocodile.
Le lendemain, maman est allée faire des courses pendant que nous filions vers le terrain vague.
— Vous n’allez pas me croire ! s’est-elle exclamée en revenant.
La ville du Tampon comptait quatre boutik. Ce qui se mangeait s’achetait Chez Georges, une supérette tenue par un vieux Chinois en centre-ville. On trouvait le reste à la quincaillerie Ah-Hot, au carrefour de Bérive, au magasin de meubles de M. Mohamed derrière l’église, et, pour le pain et les gâteaux, à la boulangerie-pâtisserie Chane-Ky, sur la route principale qui traversait la ville.
— Croire quoi, maman ?
— Figurez-vous qu’à la caisse, je m’étonnais qu’à six heures et demie à peine la nuit soit tombée. Et voilà la jeune caissière qui me répond : « Ne vous inquiétez pas, madame, la nuit, c’est comme le jour, sauf qu’il fait noir. »
L’hilarité a stoppé net, cependant, lorsque maman a ajouté :
— Ici, l’école commence à huit heures. Au collège, Adrian, le principal a prévenu que les cours débutent à sept heures trente.
Plus personne n’a eu envie de rigoler. Huit heures ? Sept heures trente ? Pas possible ! À quelle heure allait-il falloir se lever ? De toute façon, c’était pour cette raison que nous avions quitté Paris, non ?
Pour changer les habitudes.
Démarrer une nouvelle vie.
Et à six heures du matin, le soleil irradiait d’est en ouest. Le chant des tisserins emplissait déjà de joie l’immense ciel bleu.
Pour rejoindre l’école de la SIDR, Anna et moi traversions un champ de canne, en contrebas du lotissement Lassays. Le sentier caillouteux zigzaguait entre les tiges géantes qui bruissaient sous les alizés. Nous n’avions pas reçu notre déménagement, mais rien ne nous manquait. M. Mohamed nous avait prêté des lits, une table, des chaises et deux armoires, en attendant qu’arrive la commande passée à son magasin.
— Tu te rends compte, Arnaud, il nous prête tout ça.
— C’est un signe, Agathe. Nous serons bien ici, bien mieux qu’à Paris.
Avec ses nouveaux copains du collège, Adrian avait construit une cabane sur le terrain vague où, le mercredi et les weekends, nous retrouvions les enfants du quartier. Depuis la rentrée, le congé du mercredi avait remplacé celui du jeudi. Au goûter, nous achetions, en francs CFA, un macatia et un Solpak à la boutique Ti-Louis, au coin de la rue. Des volets en bois, pas de porte ni de vitre, une pancarte Orangina en fer sur le mur. Nous étions plus heureux que nous ne l’avions jamais été, plus vivants, à courir en short et savates dans les herbes, à jouer kanèt ou au mèr, et à nous cacher dans les buissons.
La vie était simple : les fins de mois n’avaient plus rien d’inquiétant.
Nous avons commencé à prendre racine.
Le dimanche en fin de journée, nous nous rendions chez les voisins, M. et Mme Auguste. Ils avaient le téléphone. On appelait la métropole. Cela marchait rarement du premier coup. Quand papa en avait assez de composer et de recomposer le numéro, il passait le combiné à maman.
— Tiens, Agathe, essaye, toi, tu es née sous une bonne étoile.
À son tour, elle enchaînait les tentatives sur le cadran jusqu’à en avoir mal aux doigts.
Quand le contact s’établissait enfin, ça sonnait, là-bas, dans l’hémisphère Nord, et, souvent, les mots rebondissaient en écho sur la ligne. Nous imaginions les grands-parents, oncles et tantes, les cousins, la famille agglutinée autour de l’unique écouteur, dans un hall d’école, seul endroit où ils pouvaient recevoir un appel. D’une voix enjouée, maman leur décrivait la vie que nous menions.
Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Non, on n’a pas le téléphone. Pas encore. Oui, on a acheté une voiture d’occasion. Une Fiat marron assez nerveuse qui monte sans problème les pentes très raides d’ici. Je ne suis pas douée pour les démarrages en côte. On n’a pas l’habitude. Non, Arnaud n’a pas écrit cette semaine. Il travaille beaucoup à l’agence et, le weekend, il bricole dans la maison. Oui, les petits se portent bien. Ils ont des copains à l’école et au collège. Les gens sont accueillants, c’est pas Paris. Le dimanche, on retrouve des collègues à la plage de l’Hermitage. Il fait beau tous les jours, c’est incroyable. Oui, le cyclone nous a épargnés.
Sauf qu’il avait déchiqueté mon cerf-volant. Ça, personne n’en parlait.
Bon, on raccroche, sinon ça va coûter une fortune. On vous rappelle la semaine prochaine. On vous embrasse.
*
Un matin de juillet 1974, près de deux ans après notre arrivée, il a débarqué de l’autre bout du monde.
Sans prévenir.
Un bonhomme costaud, au visage mal rasé, comme les cow-boys dans les films en noir et blanc que nous regardions à la télévision, le dimanche après-midi. Au risque de se faire engloutir sous un éboulement de la falaise surplombant la route en Corniche, papa était allé le récupérer à l’aéroport de Gillot. Nous allions rarement à Saint-Denis. Le trajet était trop risqué.
— C’est la roulette russe là-dessous, disait papa.
Plus rien n’a été pareil.
On nous l’a présenté comme un ami. Un ami comme quoi ? Moi, j’en avais de toutes sortes. Maman disait : « Il y a des Amis avec un grand A. »
Il s’appelait Alexandre. Plus jeune que papa, plus bronzé, plus musclé aussi. La ligne de ses dents bien blanches barrait son large visage carré. Il portait des jeans, un ceinturon en cuir et des chemises à carreaux. On ne nous a expliqué ni d’où il venait ni combien de temps il resterait à la case.
Papa a lancé :
— Il a pris un chemin de traverse.
Nous avons fait semblant de comprendre.
La chambre d’Anna a été réquisitionnée pour qu’il s’y installe. Elle a déménagé dans celle, plus petite, d’Armand. Elle ronchonnait. Elle n’aimait pas dormir avec un bébé qui pleurniche. Adrian a insinué que c’était pour la punir parce que, à dix ans, elle suçait son pouce. En même temps, la chambre d’Anna, c’était celle où, la nuit, des cafards aux antennes dressées naviguaient vers la cuisine, alors elle ne perdait pas grand-chose.
Alexandre n’allait pas travailler. J’ignorais ce qu’il fabriquait toute la journée. On se réveillait, il était là ; on partait, il était là ; on rentrait, il était là ; à table, à midi, il était là ; à table, le soir, il était là ; on se couchait, il était là. Le dimanche, il était là. J’ai demandé à maman s’il était malade.
— Pourquoi voudrais-tu qu’il soit malade ?
Non, je ne voulais pas qu’il soit malade. S’il vomissait, ça sentirait comme dans l’avion. Est-ce qu’elle lui avait bien mis un sac à vomi dans la chambre ?
J’avais beau l’observer, il ne ressemblait pas à papa. Ni à maman non plus. Il ne ressemblait à rien. Il était juste comme les cow-boys des westerns du dimanche. Mais un cow-boy sans cheval.
Maman était énervée. Elle répétait en douce :
— Sept, ce n’est pas pratique, Arnaud. Dans la voiture, un des petits doit s’asseoir sur ses genoux. À table, les grands sont serrés. Et les couverts, ça va par six, pas par sept.
Papa lui rétorquait invariablement :
— Ça ne va pas durer, Agathe, tu sais bien. Il est de passage, le temps que, là-bas…
Papa jetait vers nous un coup d’œil discret, puis il se taisait. Maman ne disait plus rien.
— Maman, qu’est-ce qu’il voulait dire, papa ? demandions-nous à tour de rôle.
— Un p’tit rien calvende jaune, répondait-elle.
Donc, il était là le temps que…
La nuit, la chambre de mes parents résonnait de murmures inquiétants. Des mots bizarres ponctuaient leurs conversations : adultère, frasque, opprobre.
Un soir, j’ai cru entendre « pension ». Ils ne pouvaient pas le mettre en pension. Il était beaucoup trop vieux. Qui en aurait voulu ? J’ai eu peur qu’ils nous y envoient, nous. Adrian m’a rassuré : il n’y en avait pas dans les écoles d’ici. À mille milles de toute terre habitée… Moi, je ne pensais pas au Petit Prince. Je pensais au Petit Poucet. Les plans macabres que ses parents élaboraient la nuit peuplaient mon sommeil.
— Maman, c’est quoi une pension ? ai-je demandé un matin.
— Un p’tit rien calvende jaune.
J’ai fait comme si j’avais compris.
Un autre soir, j’ai entendu :
— Ils se sont réconciliés. Elle va arriver.
Ce n’était pas possible qu’on en ajoute une. À moins qu’ils ne la mettent avec Alexandre et les cafards.
Anna et moi avons continué d’aller à l’école à travers champs. Quand les cannes étaient coupées, la vue sur la mer absorbait l’horizon. Maman a continué d’aller travailler au collège de la Ravine des Cabris, papa à l’agence immobilière Isautier, à Saint-Pierre. Alexandre a continué de rester à la case. Continuer de ne rien faire, ça m’aurait plu à moi aussi. Armand et Adrian ont continué de se chamailler parce qu’Armand s’amusait à lui piquer des stylos ou une casquette dans sa chambre. Papa et maman ont continué de chuchoter le soir, dans leur lit.
Nous avons grandi.
Sur le chambranle de la porte de la salle de bains, papa nous mesurait une fois par trimestre. Tout en haut, au feutre rouge, trônait le trait pour Alexandre. Un peu plus bas, celui de papa. Quelques centimètres en dessous, celui de maman. Nous, on essayait de les rattraper.
Souvent, Alexandre venait nous chercher à l’école. De l’autre côté du passage clouté, il nous attendait en plein soleil.
Un après-midi, en arrivant à la maison, nous avons croisé les gendarmes qui en repartaient. Deux bonshommes secs et blancs en short bleu marine court, chemise bleu ciel, couverts d’une casquette toute raide. Des chaussettes hautes comme celles des joueurs de football remontaient sur leurs mollets poilus et une matraque pendait à leur ceinturon. La lumière du soleil de cinq heures teintait la varangue d’une couleur orangée et allongeait les ombres des banians.
Assise sur le canapé en rotin, des papiers administratifs à la main, maman pleurait en silence. Papa n’était pas rentré de l’agence. D’une voix déterminée, elle a interpelé Alexandre qui s’apprêtait à entrer dans la cuisine pour prendre une bière dans le frigo, comme d’habitude :
— Elle est morte, Alexandre. Morte.
Alexandre est revenu sur ses pas.
Il est resté planté devant elle, sans un mot, comme moi devant l’instituteur, M. Gérard, le jour où j’avais oublié d’apprendre ma table de huit. Les feuilles tremblaient dans la main de maman.
— Qui ça ?
— Elle s’est tuée.
— De qui tu parles ?
Les doigts d’Alexandre tripotaient la boucle métallique de son ceinturon. La sueur dégoulinait de son front. De grosses gouttes répugnantes ont éclaboussé le carrelage.
— Astrid.
— Astrid ?
— Elle a eu un accident.
— En voiture ?
Dans le cou d’Alexandre, une espèce de boule ovale montait et descendait, comme s’il était en train d’avaler un noyau de letchi. Cela m’a rappelé la gorge de papa à l’enterrement de grand-mère.
— Oui. Seulement, certains détails ne collent pas. Les gendarmes pensent qu’elle a pu volontairement précipiter la voiture dans la ravine. Au-dessus de Bras de Pontho. Pas loin de l’endroit où nous sommes allés pique-niquer, le weekend dernier.
— Pourquoi elle aurait fait ça ?
— Je ne sais pas. Peut-être que, toi, tu as une idée.
— J’y suis pour rien.
— Les gendarmes voulaient savoir qui elle fréquentait.
— Tu leur as donné mon nom ?
Maman s’est levée en haussant les épaules.
Alexandre a disparu. On ne l’a revu que trois semaines plus tard, après les vacances de mai. Je m’étais renseigné.
— C’est qui Astrid, maman ?
— Une très bonne amie à moi. La dame à la voiture rouge qui était venue au pique-nique à Bras de Pontho. Celle qui t’a offert le pistolet à eau.
— C’est une amie d’Alexandre aussi ?
— Oui.
— Vous avez les mêmes amis ?
— Non. Juste Astrid.
Quand Alexandre est réapparu, papa et maman étaient moins amis avec lui. Peut-être même plus amis du tout. Une gêne palpable flottait dans l’air.
En silence, Alexandre a rassemblé ses affaires. Sur le buffet, j’avais pris soin de mettre en évidence tout ce qu’il avait laissé traîner pour qu’il n’ait pas à revenir : un étui à lunettes en plastique, une boîte de plaquettes antimoustiques, des clés, un tube de crème solaire Nivea tout gras et une pochette noire en cuir.
Du courrier ouvert était tombé sur le sol. Une carte postale du port de Marseille.
Mon chéri,
Comme prévu, je serai à l’aéroport avec les enfants, le dix janvier. L’avion atterrit à sept heures trente. Tu as bien fait de partir en éclaireur. Cette séparation nous aura permis d’éloigner la menace d’un divorce. Tu as beaucoup manqué aux filles. À moi aussi. Il me tarde de t’embrasser et de découvrir cette île dont tu parles avec tant d’enthousiasme.
Bientôt, nous prendrons un nouveau départ tous les cinq. Pour le meilleur.
Je t’aime,
Ta femme,
Maude.
Un peu plus loin sur le carrelage, un message griffonné au crayon de papier, d’une écriture maladroite.
Mon amour,
C’est ainsi que notre histoire s’achève. Avec l’arrivée ici de celle que tu prétendais ne plus aimer. J’ai cru, à tort, que tu aurais le courage de la quitter. Tous ces mois au vol suspendu n’ont été pour toi qu’un jeu, pour moi un piège.
Je n’aurai pas cette force que tu n’as pas eue.
Ni celle de te serrer la main quand tu me la présenteras.
Je t’ai aimé.
Adieu,
Astrid
J’avais tout ramassé vite fait et déposé la carte sur le buffet.
Pas la lettre d’Astrid.
Après le départ d’Alexandre, j’ai interrogé maman :
— C’est quoi un « éclaireur » ?
— Quelqu’un qu’on envoie devant pour vérifier que l’on peut continuer à avancer en sécurité.
— Comme Alexandre ?
— Alexandre ?
— Oui.
— Non, Amaury, pourquoi Alexandre serait-il un éclaireur ?
— Je ne sais pas.
— Qu'est-ce que tu caches derrière ton dos ?
— Un p’tit rien calvende jaune.
— Un quoi ?
— Un p’tit rien calvende jaune.
— …
— C’est ce que tu dis, toi.
— Amaury, ce que je dis c’est : un p’tit-rien-qui a-le-ven-tre jaune.
- Fin du chapitre -

Tous les contenus du site internet de Lectivia sont protégés par la loi sur les droits d'auteur. L'utilisation, le partage ou la reproduction de toute partie du contenu sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur ou des ayants droits ou de Lectivia sera punis par la loi en vertu des règlements sur la violation du droits d'auteur et la propriété intellectuelle.