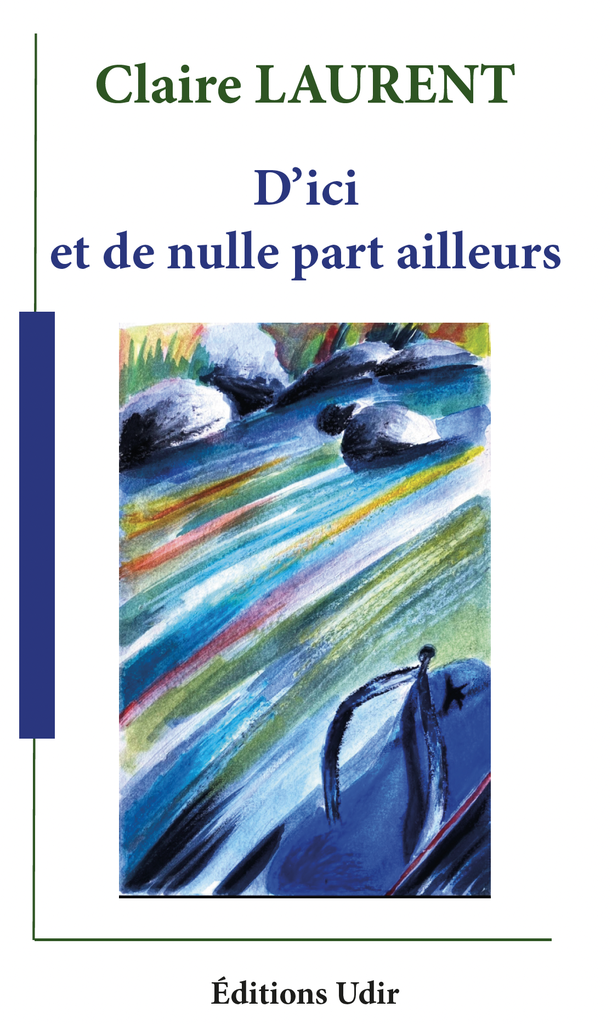
D'ici et de nulle part ailleurs
Editeur : UDIR
Auteur : Claire LAURENT
ISBN : 978-2-87863-104-3
Description :
Dans son livre D’ici et de nulle part ailleurs, Claire Laurent nous livre des histoires percutantes, tirées au cordeau, qui retracent les destins d’hommes, de femmes, d’enfants soumis aux affres de la vie. Un fil rouge relie ces histoires entre elles : La Réunion. En effet, l’île bouleverse et transforme la vie des personnages de ces douze nouvelles, comme elle a transformé la vie de l’auteure qui, dans un style réaliste et épuré, nous questionne sur l’absurdité, le tragique, les raisons de l’existence.
Laetitia Samlong Ah-Kiem
| Mis en ligne par | Lectivia |
|---|---|
| Dernière mise à jour | 09/12/2024 |
| Lecteur(s) | 1 |
Partager ce cours
Partager le lien
Partager sur les réseaux sociaux
Partager par email
Veuillez s'inscrire afin de partager ce D'ici et de nulle part ailleurs par email.

Chapitre 12 : La fille au bertèl
Les fêtes de Noël approchaient.
À la sortie d’un virage, debout devant un muret de pierre, une fille faisait du stop en fumant une cigarette. Quand je me suis garée le long du chemin herbeux, elle a lancé son mégot dans le caniveau en jetant un coup d’œil à la maison voisine aux volets clos. Personne d’autre à l’horizon que cette auto-stoppeuse en rade, entre le Tévelave et Les Avirons, un samedi après-midi.
Moi, je revenais d’une promenade dans la forêt. J’ai descendu la vitre, côté passager. L’air chaud s’est engouffré dans la voiture. La fille s’est approchée. Seize ou dix-sept ans, pas plus.
— Bonjour, je peux monter ?
D’emblée, le paille-en-queue tatoué sur son bras gauche m’a rendu le personnage sympathique, même si je n’apprécie guère les tatouages. Marquer sa peau à vie d’un oiseau si élégant, c’est le signe d’un esprit tout en finesse, ai-je pensé.
— Oui, oui. Où allez-vous ?
— Je descends sur Saint-Leu.
— Vous pouvez mettre votre sac à l’arrière, il y a de la place.
Ses cheveux roux, bouclés, encadraient un visage qui semblait n’avoir jamais vu le soleil. Sur ses épaules, les pans d’un bertèl s’écartaient comme s’ils retenaient un objet trop volumineux. D’habitude, les jeunes que je prenais en stop se baladaient plutôt avec un sac à dos. Elle a posé le bertèl sur la banquette arrière avant de s’installer à côté de moi. Une odeur de nature a envahi l’habitacle, une odeur des Hauts, à la fois fraîche et âcre, un mélange de géranium, de feuilles séchées et de viandes boucanées.
J’ai redémarré.
Les effluves aigres des mangues tombées dans le fossé flottaient dans l’air tiède. Un peu plus loin, à l’arrêt de bus, trois chiens efflanqués se disputaient une carcasse de poulet couverte de mouches. Je n’ai pu m’empêcher de chercher du regard le sachet en plastique qui sert à transporter les offrandes déposées à l’issue d’une cérémonie tamoule. À la croisée de deux voies bitumées, j’ai contourné des restes de safran, de fleurs, de morceaux de noix de coco délaissés par les chiens. « La malédiction peut toucher celui qui roule dessus », aimait à dire ma grand-mère. Malgré mes efforts, la malédiction avait frappé six mois plus tôt. Et grand-mère s’en était allée vers, peut-être, une autre vie.
— Il y en a partout.
— Quoi ? Des restes d’offrandes ? ai-je demandé.
— Non, des chiens errants. Des hordes de chiens errants. Mon frère en a trouvé un qui avait été battu à mort et jeté dans un sentier comme un détritus, les pattes cassées, les oreilles découpées, la queue arrachée. Il l’a emmené chez le vétérinaire, mais c’était trop tard.
J’ai eu envie de vomir.
Sur le bord de la route, des flamboyants coloraient ciel et terre de leurs pétales écarlates. J’ai essayé de remplacer l’image du chien torturé par celle des fleurs rouges. Pratiquer la pensée positive, c’était à la mode et bon pour le karma, mais la couleur me ramenait au sang qui avait dû gicler des blessures de l’animal.
— Vous habitez au Tévelave ?
Elle n’a pas répondu. Par la vitre ouverte, elle regardait défiler les tamariniers tandis que sa main droite tapotait le rebord de l’accoudoir.
— Vous attendiez depuis longtemps ?
— Non, je n’attends jamais bien longtemps.
— Vous faites souvent du stop ?
Pas de réponse. Elle a fait craquer les jointures de ses doigts. Ce bruit désagréable m’a rappelé ma fille. Le mois prochain, Lola aurait eu seize ans si j’étais allée la chercher à Cilaos pendant les vacances de mai, au lieu de la laisser rentrer de randonnée en stop. Lola faisait toujours craquer ses articulations avant de jouer du piano. Elle n’aurait jamais seize ans. Ne ferait plus d’auto-stop. Le couvercle du piano avait été refermé.
Pour l’éternité.
Amen.
Le piano avait été mis en vente.
En octobre, Lola aurait dû danser à Saint-Louis pour le Dipavali, la fête de la lumière. Désormais, des fleurs de frangipaniers voletaient sur sa tombe au cimetière de Saint-Leu où je me rendais les samedis en me demandant : « À quoi bon ? »
Si j’avais su…
Ma passagère a cherché quelque chose dans les poches de son jean. Quelque chose qu’elle n’a pas trouvé. Dépitée, elle a secoué la tête. Puis elle a déplié le pare-soleil et s’est observée quelques secondes dans le petit miroir, avant de relever le battant en plastique et de se retourner pour surveiller son sac.
À ce moment-là, j’ai réalisé que je n’avais jamais vu une fille avec un bertèl sur le dos. Ce genre de sac en vacoas tressé, c’était les coupeurs de canne à sucre qui le portaient pour y ranger leur sabre. Qu’est-ce qui faisait saillir les pans du bertèl ? Des vêtements roulés en boule ? Un duvet ? Des fruits ?
— Comment vous appelez-vous ?
— Audrey.
— C’est joli, Audrey.
— Vous, vous êtes la mère de Lola.
— Comment le savez-vous ?
— J’ai vu des photos de vous sur Insta.
— Insta, c’est Instagram ?
— Ben oui. Des femmes métisses malbar, ça ne court pas les rues au Tévelave.
Sa réflexion sur la couleur de ma peau m’a interloquée. Oui, j’avais une mère malbar et un père à la peau blanche. En quoi cela la dérangeait-il ?
Arrivé à La Réunion en 1968, comme Volontaire de l’Aide Technique (VAT), mon père avait rencontré ma mère, alors infirmière à l’hôpital de Saint-Pierre. La naissance de deux enfants avait transformé le service civil de mon père en installation définitive. Créolisé, réunionnisé, malbarisé, et fier de l’être. Mon père était heureux. Et nous avec.
Je mangeais du bœuf aussi, si la demoiselle assise à côté de moi voulait le savoir. Lola, elle, était végétarienne. Elle me reprochait de me nourrir de cadavres. Elle prétendait que les enfants de sa génération finiraient tous par ne plus tuer les animaux. Elle comparait le poulet ou le poisson dans mon assiette à notre chien, qui répondait au nom de Massalé.
— Ça ne te viendrait pas à l’idée de manger Massalé, quand même ?
Non, je ne mangerais pas Massalé, mais j’aimais bien le poisson. Comme les ados de son âge, ma fille passait des heures sur son téléphone, à poster je ne sais trop quoi à je ne sais trop qui.
— Vous faites ça, vous aussi ?
— Faire quoi ?
— Afficher des photos de vos parents sur votre profil ?
— Alors, d’abord, les photos, c’est pas sur le profil, c’est dans le fil d’actualité. Ensuite, Lola ne postait pas de photos de son père, juste de vous.
C’est sûr que les relations entre Lola et son père n’étaient pas au beau fixe. Aux yeux de Lola, il passait trop de temps à régler les problèmes des jeunes qu’il recevait à son cabinet de psy, sans être capable de trouver de solution aux dilemmes autrement plus importants de sa fille unique.
« Elle me fatigue avec ses histoires de droits et de liberté », me confiait-il certains soirs.
« Il ne prend jamais le temps de m’écouter », se plaignait-elle.
— Vous êtes une amie de Lola ?
— J’étais.
— Oui, bien sûr, maintenant qu’elle n’est plus là…
— On n’était plus amies de toute façon.
Le ton sec d’Audrey m’a fait hésiter à mener l’investigation plus avant, bien que sa dernière remarque semble destinée à aiguiser ma curiosité. Elle m’était soudain moins sympathique. J’ai ralenti. Il était à peine quinze heures. J’avais du temps devant moi. Le tapotement sur l’accoudoir s’est interrompu. Elle a de nouveau tâté les poches de son pantalon.
— Vous avez du feu ?
— On ne fume pas dans la voiture, désolée.
Elle a soupiré, a recommencé à tapoter sur l’accoudoir avant d’ajouter :
— Vous ne fumez pas ?
— Non.
— Lola fumait. Et pas que des cigarettes.
— Pardon ?
— Vous avez très bien entendu.
— Qu’est-ce que vous insinuez ?
— J’insinue rien du tout, c’est la vérité. Ça vous choque ?
— Ça devrait ?
— Mon frère lui vendait du zamal. Elle passait le voir le mercredi, après son cours de piano chez madame Rivière. On habite juste à côté de la prof de musique, pas loin de la boutique de Piton Vert, derrière la boulangerie Payet. Elle garait son scooter bien en évidence, le long de la clôture mitoyenne.
La voiture a fait une embardée. Cette fille me provoquait sans que je comprenne la raison de son animosité. Après tout, c’était grâce à moi qu’elle n’était plus en train de poireauter sur le bord de la route. Est-ce qu’elle en voulait à ma fille ? Et si elle n’était pas montée dans ma voiture par hasard ?
Le soleil trônait dans un ciel d’azur, aveuglant. J’ai abaissé le pare-soleil. Une photo de Lola était scotchée sur le plastique noir. Ma fille sur la plage de rochers de la Pointe au sel, en maillot de bain fluo et chapeau de paille, le jour de ses dix ans. En équilibre sur un énorme bloc, elle avait répété des mouvements de son spectacle de danse de fin d’année. J’ai cru entendre un gémissement ténu qui émanait du bertèl.
— Ce n’est pas un bébé que vous transportez, quand même ?
— Non, non. Je n’aime pas les bébés. Ils ne font que manger, dormir et pleurer.
— Ma fille aimait bien les bébés.
— Je sais. C’est comme ça qu’elle a piégé mon frère. Elle lui a fait croire qu’ils se marieraient et qu’ils auraient un bébé, mais tout ce qu’elle voulait, au fond, c’était qu’il continue à lui vendre du zamal.
Au carrefour, j’ai failli brûler le stop à l’entrée des Avirons. Les ceintures de sécurité se sont tendues d’un coup sec quand j’ai pilé. Les pneus de la Nissan ont crissé sur l’asphalte. J’ai repensé aux traces laissées par la Ford du gars qui avait pris ma fille en stop à Cilaos, six mois plus tôt. Deux longues traînées noires là où la végétation avait été arrachée, en bordure du ravin, avant que le véhicule ne bascule dans le vide.
Si j’avais su…
Si j’avais su, j’aurais annulé mon stage de yoga le dernier weekend de mai, et au lieu de raccompagner mes copines chez elles, je serais allée récupérer ma fille chérie au fin fond du cirque de Cilaos pour la ramener vivante à la maison.
Vivante.
Les images de son cercueil m’ont assaillie, envahissant tout l’espace de mon cerveau comme une vague de tsunami qui s’engouffre dans un bâtiment sans issue. Un cercueil en bois de tamarin, lisse, sans fioritures, couvert de fleurs, de photos, de messages colorés. Le cercueil et l’odeur d’encens brûlé le jour de ses funérailles, voilà ce qu’il me restait de ma fille.
Derrière moi, un camion a klaxonné. J’ai de nouveau atterri dans la réalité : les cours de piano au Tévelave, les bébés, un frère amoureux et du cannabis.
— Du zamal ? Vous racontez n’importe quoi. Jamais Lola n’aurait fumé un truc pareil. De toute façon, elle n’avait pas d’argent pour en acheter.
— Vous croyez vraiment ce que vous dites ?
— On va arrêter cette conversation qui dérape. Si vous n’aimiez pas Lola, c’est votre droit.
— Vous voulez savoir comment Lola s’est acheté son dernier iPhone ? Celui avec la coque jaune pâle et la vitre rayée. À moins que, là aussi, vous n’ayez rien vu…
Une bouffée d’angoisse me submergeait chaque fois que cette sauvageonne sortie de nulle part prononçait le prénom de ma fille.
— Lola n’avait pas d’iPhone, vous vous trompez.
— Mon frère était fou amoureux d’elle.
— Ça suffit maintenant.
— Les filles métisses, il dit que c’est son style, qu’elles ont un truc en plus.
C’est ce qu’avait dit mon mari quand je l’avais rencontré.
Audrey a continué :
— Lola débarquait à la maison une fois par semaine et mon frère lui donnait tout ce qu’elle voulait. Il a même réparé son scooter le jour où elle a glissé sur la route mouillée et qu’elle a cassé la béquille.
Je ne comprenais pas de quoi elle parlait, comme si la vie de ma fille défilait et que je l’observais de l’extérieur.
— Moi, mon scooter, il est en panne depuis un mois, mais il s’en fout. Elle l’a mené en bateau, du début à la fin. Elle ne l’aimait pas, ça se voyait, elle se servait de lui pour faire du fric.
— Comment ça ?
— Ben, le zamal, elle le revendait au lycée.
J’ai commencé à avoir mal au ventre. Mes boyaux se tordaient, réveillant une douleur bien connue depuis quelques mois. J’ai ouvert le vide-poche où je laissais le jeton pour le caddie du supermarché et j’ai attrapé un sachet de Gaviscon. J’en avais disséminé partout : dans la voiture, dans mes sacs à main, dans mon panier de plage. Mes doigts ont heurté un porte-clés aux motifs traditionnels aborigènes, souvenir d’Australie rapporté à Lola par ma mère, deux ans plus tôt. En même temps qu’une partie de moi était tentée d’en savoir plus sur la vie cachée de ma fille, une autre craignait que je ne puisse le supporter.
— Taisez-vous ou je vous dépose.
— Là ?
— Oui, là, tout de suite.
— J’me tairai pas. Vous allez faire quoi ? Me balancer par-dessus bord ?
— Par exemple.
— Le gars qui a raté son virage à Cilaos, il ne l’a pas prise en stop par hasard. Elle le connaissait. Elle projetait de partir avec lui.
— …
— Vous n’êtes pas au courant, non plus ? Elle rêvait d’aller en Inde, de voir le Taj Mahal et Bollywood. C’est pour ça qu’elle revendait du zamal.
Chaque phrase qu’elle prononçait était pire que la précédente et me déchirait le ventre comme un coup de couteau. Il fallait que cette folle se taise, qu’elle arrête de déverser sa rancœur, qu’elle ferme sa bouche infecte.
— Vous vous rendez compte des accusations que vous portez ?
La sale gamine avait une tache sur le menton, comme une trace de salive. Je me suis mise à essuyer mon propre menton.
C’était quoi cette histoire de zamal ? Lola était plus maligne que tous ces petits dealers occasionnels du lycée.
— Vous connaissiez le gars qui l’a embarquée à Cilaos ?
— Non, jamais vu, mais Lola en parlait beaucoup. Il était guide de montagne et moniteur de canyoning. C’est comme ça qu’elle l’a rencontré. Ils ont descendu en rappel les gorges de Fleurs Jaunes, vers Ilet à Cordes.
Je me suis souvenue d’une enveloppe mauve que Lola avait ouverte, le jour de son anniversaire. Mes beaux-parents nous avaient consultés, quelques semaines plus tôt, avec l’idée de lui offrir une expérience de canyoning pour ses quinze ans. Lola était sportive, elle adorait la nature et la montagne. L’idée était originale.
— Lola m’a montré des photos du guide. Elle les cachait dans le coffre de son scooter. Un grand gars au visage fin, d’une trentaine d’années, tout en muscles, avec un sourire à faire de la pub pour du dentifrice. Plus beau que tous les mecs du lycée. Et plus mûr aussi.
J’ai reconnu le discours de Lola sur ses copains de classe qui manquaient de maturité. « Ils ont seize ans et se comportent comme des bébés. »
— C’est avec lui qu’elle a commencé à fumer du zamal ? ai-je demandé.
— Non, c’est plutôt lui qui a commencé avec elle.
J’avais la sensation de ne rien comprendre, l’impression que nous ne parlions pas de la même personne. La Lola qu’elle décrivait ne ressemblait en rien à ma fille. Ma Lola, calme, sociable, enthousiaste n’était ni naïve ni inconsciente. Le lycée était à cinq minutes de la maison. Elle y allait à pied, rentrait à l’heure. Ses amies passaient la voir chez nous. De temps en temps, elles restaient dormir. Elles discutaient dans sa chambre, regardaient sur Internet des vidéos qui les faisaient rire ou des séries sur Netflix, et s’installaient dehors sur la terrasse pour manger des gâteaux et boire des sodas ou, parfois, une bière. Je n’avais jamais entendu parler d’Audrey. Encore moins de son frère qui réparait les scooters.
— Ce que vous me racontez, c’est ce qu’elle vous a dit ?
— Entre autres.
— C’est-à-dire ?
— Ce qu’elle m’a raconté… ce que mon frère m’a confié… ce que j’ai vu et entendu au lycée. J’ai croisé les informations, c’est tout.
De nouveau, j’ai cru percevoir un faible couinement ou une vibration à l’arrière.
— C’est quoi, ce bruit ?
— C’est rien, juste un truc dans mon sac.
— On dirait le gazouillis d’un bébé.
— Le quoi ?
— Le bruit que fait un bébé quand il joue à se mordiller les pieds dans son berceau. Ou un chiot. C’est ça ? Vous transportez un chiot ?
— Non.
— Un chaton ?
— Mon frère n’était plus le même depuis qu’il avait rencontré Lola.
— Je me fiche de votre frère.
— Lola, elle couchait avec tout le monde. Mon frère en était malade.
— Je ne crois pas un mot de ce que vous racontez, alors vous allez arrêter. Je vous déposerai à Saint-Leu et je ne veux plus jamais vous revoir.
— Il a fait une tentative de suicide. À cause d’elle, il a passé trois semaines à l’hôpital de Saint-Pierre, l’année dernière. Chez les cinglés. Avec les drogués et les alcooliques.
La voiture s’est arrêtée net. J’en suis descendue. J’ai fait le tour du véhicule par l’arrière. J’ai ouvert la portière, j’ai attrapé le bertèl et je l’ai balancé dans le fossé.
— Vous descendez.
— Qu’est-ce qui vous prend ?
— J’ai dit : vous descendez.
— Mais ça va pas ! Vous avez pété un câble ou quoi ?
— Vous dégagez. Et très vite.
Le contenu du sac s’était renversé sur l’herbe. Au milieu d’un énorme tas de feuilles séchées de zamal, un portefeuille orange et jaune, plein de billets, était tombé sur le côté, ainsi qu’un mobile Samsung bleu nuit dont la sonnerie s’était déclenchée, imitant le gazouillis d’un bébé.
Le portefeuille et le téléphone de ma fille.
On ne les avait pas retrouvés après l’accident.
- Fin du chapitre et du livre -

Tous les contenus du site internet de Lectivia sont protégés par la loi sur les droits d'auteur. L'utilisation, le partage ou la reproduction de toute partie du contenu sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur ou des ayants droits ou de Lectivia sera punis par la loi en vertu des règlements sur la violation du droits d'auteur et la propriété intellectuelle.

Les fêtes de Noël approchaient.
À la sortie d’un virage, debout devant un muret de pierre, une fille faisait du stop en fumant une cigarette. Quand je me suis garée le long du chemin herbeux, elle a lancé son mégot dans le caniveau en jetant un coup d’œil à la maison voisine aux volets clos. Personne d’autre à l’horizon que cette auto-stoppeuse en rade, entre le Tévelave et Les Avirons, un samedi après-midi.
Moi, je revenais d’une promenade dans la forêt. J’ai descendu la vitre, côté passager. L’air chaud s’est engouffré dans la voiture. La fille s’est approchée. Seize ou dix-sept ans, pas plus.
— Bonjour, je peux monter ?
D’emblée, le paille-en-queue tatoué sur son bras gauche m’a rendu le personnage sympathique, même si je n’apprécie guère les tatouages. Marquer sa peau à vie d’un oiseau si élégant, c’est le signe d’un esprit tout en finesse, ai-je pensé.
— Oui, oui. Où allez-vous ?
— Je descends sur Saint-Leu.
— Vous pouvez mettre votre sac à l’arrière, il y a de la place.
Ses cheveux roux, bouclés, encadraient un visage qui semblait n’avoir jamais vu le soleil. Sur ses épaules, les pans d’un bertèl s’écartaient comme s’ils retenaient un objet trop volumineux. D’habitude, les jeunes que je prenais en stop se baladaient plutôt avec un sac à dos. Elle a posé le bertèl sur la banquette arrière avant de s’installer à côté de moi. Une odeur de nature a envahi l’habitacle, une odeur des Hauts, à la fois fraîche et âcre, un mélange de géranium, de feuilles séchées et de viandes boucanées.
J’ai redémarré.
Les effluves aigres des mangues tombées dans le fossé flottaient dans l’air tiède. Un peu plus loin, à l’arrêt de bus, trois chiens efflanqués se disputaient une carcasse de poulet couverte de mouches. Je n’ai pu m’empêcher de chercher du regard le sachet en plastique qui sert à transporter les offrandes déposées à l’issue d’une cérémonie tamoule. À la croisée de deux voies bitumées, j’ai contourné des restes de safran, de fleurs, de morceaux de noix de coco délaissés par les chiens. « La malédiction peut toucher celui qui roule dessus », aimait à dire ma grand-mère. Malgré mes efforts, la malédiction avait frappé six mois plus tôt. Et grand-mère s’en était allée vers, peut-être, une autre vie.
— Il y en a partout.
— Quoi ? Des restes d’offrandes ? ai-je demandé.
— Non, des chiens errants. Des hordes de chiens errants. Mon frère en a trouvé un qui avait été battu à mort et jeté dans un sentier comme un détritus, les pattes cassées, les oreilles découpées, la queue arrachée. Il l’a emmené chez le vétérinaire, mais c’était trop tard.
J’ai eu envie de vomir.
Sur le bord de la route, des flamboyants coloraient ciel et terre de leurs pétales écarlates. J’ai essayé de remplacer l’image du chien torturé par celle des fleurs rouges. Pratiquer la pensée positive, c’était à la mode et bon pour le karma, mais la couleur me ramenait au sang qui avait dû gicler des blessures de l’animal.
— Vous habitez au Tévelave ?
Elle n’a pas répondu. Par la vitre ouverte, elle regardait défiler les tamariniers tandis que sa main droite tapotait le rebord de l’accoudoir.
— Vous attendiez depuis longtemps ?
— Non, je n’attends jamais bien longtemps.
— Vous faites souvent du stop ?
Pas de réponse. Elle a fait craquer les jointures de ses doigts. Ce bruit désagréable m’a rappelé ma fille. Le mois prochain, Lola aurait eu seize ans si j’étais allée la chercher à Cilaos pendant les vacances de mai, au lieu de la laisser rentrer de randonnée en stop. Lola faisait toujours craquer ses articulations avant de jouer du piano. Elle n’aurait jamais seize ans. Ne ferait plus d’auto-stop. Le couvercle du piano avait été refermé.
Pour l’éternité.
Amen.
Le piano avait été mis en vente.
En octobre, Lola aurait dû danser à Saint-Louis pour le Dipavali, la fête de la lumière. Désormais, des fleurs de frangipaniers voletaient sur sa tombe au cimetière de Saint-Leu où je me rendais les samedis en me demandant : « À quoi bon ? »
Si j’avais su…
Ma passagère a cherché quelque chose dans les poches de son jean. Quelque chose qu’elle n’a pas trouvé. Dépitée, elle a secoué la tête. Puis elle a déplié le pare-soleil et s’est observée quelques secondes dans le petit miroir, avant de relever le battant en plastique et de se retourner pour surveiller son sac.
À ce moment-là, j’ai réalisé que je n’avais jamais vu une fille avec un bertèl sur le dos. Ce genre de sac en vacoas tressé, c’était les coupeurs de canne à sucre qui le portaient pour y ranger leur sabre. Qu’est-ce qui faisait saillir les pans du bertèl ? Des vêtements roulés en boule ? Un duvet ? Des fruits ?
— Comment vous appelez-vous ?
— Audrey.
— C’est joli, Audrey.
— Vous, vous êtes la mère de Lola.
— Comment le savez-vous ?
— J’ai vu des photos de vous sur Insta.
— Insta, c’est Instagram ?
— Ben oui. Des femmes métisses malbar, ça ne court pas les rues au Tévelave.
Sa réflexion sur la couleur de ma peau m’a interloquée. Oui, j’avais une mère malbar et un père à la peau blanche. En quoi cela la dérangeait-il ?
Arrivé à La Réunion en 1968, comme Volontaire de l’Aide Technique (VAT), mon père avait rencontré ma mère, alors infirmière à l’hôpital de Saint-Pierre. La naissance de deux enfants avait transformé le service civil de mon père en installation définitive. Créolisé, réunionnisé, malbarisé, et fier de l’être. Mon père était heureux. Et nous avec.
Je mangeais du bœuf aussi, si la demoiselle assise à côté de moi voulait le savoir. Lola, elle, était végétarienne. Elle me reprochait de me nourrir de cadavres. Elle prétendait que les enfants de sa génération finiraient tous par ne plus tuer les animaux. Elle comparait le poulet ou le poisson dans mon assiette à notre chien, qui répondait au nom de Massalé.
— Ça ne te viendrait pas à l’idée de manger Massalé, quand même ?
Non, je ne mangerais pas Massalé, mais j’aimais bien le poisson. Comme les ados de son âge, ma fille passait des heures sur son téléphone, à poster je ne sais trop quoi à je ne sais trop qui.
— Vous faites ça, vous aussi ?
— Faire quoi ?
— Afficher des photos de vos parents sur votre profil ?
— Alors, d’abord, les photos, c’est pas sur le profil, c’est dans le fil d’actualité. Ensuite, Lola ne postait pas de photos de son père, juste de vous.
C’est sûr que les relations entre Lola et son père n’étaient pas au beau fixe. Aux yeux de Lola, il passait trop de temps à régler les problèmes des jeunes qu’il recevait à son cabinet de psy, sans être capable de trouver de solution aux dilemmes autrement plus importants de sa fille unique.
« Elle me fatigue avec ses histoires de droits et de liberté », me confiait-il certains soirs.
« Il ne prend jamais le temps de m’écouter », se plaignait-elle.
— Vous êtes une amie de Lola ?
— J’étais.
— Oui, bien sûr, maintenant qu’elle n’est plus là…
— On n’était plus amies de toute façon.
Le ton sec d’Audrey m’a fait hésiter à mener l’investigation plus avant, bien que sa dernière remarque semble destinée à aiguiser ma curiosité. Elle m’était soudain moins sympathique. J’ai ralenti. Il était à peine quinze heures. J’avais du temps devant moi. Le tapotement sur l’accoudoir s’est interrompu. Elle a de nouveau tâté les poches de son pantalon.
— Vous avez du feu ?
— On ne fume pas dans la voiture, désolée.
Elle a soupiré, a recommencé à tapoter sur l’accoudoir avant d’ajouter :
— Vous ne fumez pas ?
— Non.
— Lola fumait. Et pas que des cigarettes.
— Pardon ?
— Vous avez très bien entendu.
— Qu’est-ce que vous insinuez ?
— J’insinue rien du tout, c’est la vérité. Ça vous choque ?
— Ça devrait ?
— Mon frère lui vendait du zamal. Elle passait le voir le mercredi, après son cours de piano chez madame Rivière. On habite juste à côté de la prof de musique, pas loin de la boutique de Piton Vert, derrière la boulangerie Payet. Elle garait son scooter bien en évidence, le long de la clôture mitoyenne.
La voiture a fait une embardée. Cette fille me provoquait sans que je comprenne la raison de son animosité. Après tout, c’était grâce à moi qu’elle n’était plus en train de poireauter sur le bord de la route. Est-ce qu’elle en voulait à ma fille ? Et si elle n’était pas montée dans ma voiture par hasard ?
Le soleil trônait dans un ciel d’azur, aveuglant. J’ai abaissé le pare-soleil. Une photo de Lola était scotchée sur le plastique noir. Ma fille sur la plage de rochers de la Pointe au sel, en maillot de bain fluo et chapeau de paille, le jour de ses dix ans. En équilibre sur un énorme bloc, elle avait répété des mouvements de son spectacle de danse de fin d’année. J’ai cru entendre un gémissement ténu qui émanait du bertèl.
— Ce n’est pas un bébé que vous transportez, quand même ?
— Non, non. Je n’aime pas les bébés. Ils ne font que manger, dormir et pleurer.
— Ma fille aimait bien les bébés.
— Je sais. C’est comme ça qu’elle a piégé mon frère. Elle lui a fait croire qu’ils se marieraient et qu’ils auraient un bébé, mais tout ce qu’elle voulait, au fond, c’était qu’il continue à lui vendre du zamal.
Au carrefour, j’ai failli brûler le stop à l’entrée des Avirons. Les ceintures de sécurité se sont tendues d’un coup sec quand j’ai pilé. Les pneus de la Nissan ont crissé sur l’asphalte. J’ai repensé aux traces laissées par la Ford du gars qui avait pris ma fille en stop à Cilaos, six mois plus tôt. Deux longues traînées noires là où la végétation avait été arrachée, en bordure du ravin, avant que le véhicule ne bascule dans le vide.
Si j’avais su…
Si j’avais su, j’aurais annulé mon stage de yoga le dernier weekend de mai, et au lieu de raccompagner mes copines chez elles, je serais allée récupérer ma fille chérie au fin fond du cirque de Cilaos pour la ramener vivante à la maison.
Vivante.
Les images de son cercueil m’ont assaillie, envahissant tout l’espace de mon cerveau comme une vague de tsunami qui s’engouffre dans un bâtiment sans issue. Un cercueil en bois de tamarin, lisse, sans fioritures, couvert de fleurs, de photos, de messages colorés. Le cercueil et l’odeur d’encens brûlé le jour de ses funérailles, voilà ce qu’il me restait de ma fille.
Derrière moi, un camion a klaxonné. J’ai de nouveau atterri dans la réalité : les cours de piano au Tévelave, les bébés, un frère amoureux et du cannabis.
— Du zamal ? Vous racontez n’importe quoi. Jamais Lola n’aurait fumé un truc pareil. De toute façon, elle n’avait pas d’argent pour en acheter.
— Vous croyez vraiment ce que vous dites ?
— On va arrêter cette conversation qui dérape. Si vous n’aimiez pas Lola, c’est votre droit.
— Vous voulez savoir comment Lola s’est acheté son dernier iPhone ? Celui avec la coque jaune pâle et la vitre rayée. À moins que, là aussi, vous n’ayez rien vu…
Une bouffée d’angoisse me submergeait chaque fois que cette sauvageonne sortie de nulle part prononçait le prénom de ma fille.
— Lola n’avait pas d’iPhone, vous vous trompez.
— Mon frère était fou amoureux d’elle.
— Ça suffit maintenant.
— Les filles métisses, il dit que c’est son style, qu’elles ont un truc en plus.
C’est ce qu’avait dit mon mari quand je l’avais rencontré.
Audrey a continué :
— Lola débarquait à la maison une fois par semaine et mon frère lui donnait tout ce qu’elle voulait. Il a même réparé son scooter le jour où elle a glissé sur la route mouillée et qu’elle a cassé la béquille.
Je ne comprenais pas de quoi elle parlait, comme si la vie de ma fille défilait et que je l’observais de l’extérieur.
— Moi, mon scooter, il est en panne depuis un mois, mais il s’en fout. Elle l’a mené en bateau, du début à la fin. Elle ne l’aimait pas, ça se voyait, elle se servait de lui pour faire du fric.
— Comment ça ?
— Ben, le zamal, elle le revendait au lycée.
J’ai commencé à avoir mal au ventre. Mes boyaux se tordaient, réveillant une douleur bien connue depuis quelques mois. J’ai ouvert le vide-poche où je laissais le jeton pour le caddie du supermarché et j’ai attrapé un sachet de Gaviscon. J’en avais disséminé partout : dans la voiture, dans mes sacs à main, dans mon panier de plage. Mes doigts ont heurté un porte-clés aux motifs traditionnels aborigènes, souvenir d’Australie rapporté à Lola par ma mère, deux ans plus tôt. En même temps qu’une partie de moi était tentée d’en savoir plus sur la vie cachée de ma fille, une autre craignait que je ne puisse le supporter.
— Taisez-vous ou je vous dépose.
— Là ?
— Oui, là, tout de suite.
— J’me tairai pas. Vous allez faire quoi ? Me balancer par-dessus bord ?
— Par exemple.
— Le gars qui a raté son virage à Cilaos, il ne l’a pas prise en stop par hasard. Elle le connaissait. Elle projetait de partir avec lui.
— …
— Vous n’êtes pas au courant, non plus ? Elle rêvait d’aller en Inde, de voir le Taj Mahal et Bollywood. C’est pour ça qu’elle revendait du zamal.
Chaque phrase qu’elle prononçait était pire que la précédente et me déchirait le ventre comme un coup de couteau. Il fallait que cette folle se taise, qu’elle arrête de déverser sa rancœur, qu’elle ferme sa bouche infecte.
— Vous vous rendez compte des accusations que vous portez ?
La sale gamine avait une tache sur le menton, comme une trace de salive. Je me suis mise à essuyer mon propre menton.
C’était quoi cette histoire de zamal ? Lola était plus maligne que tous ces petits dealers occasionnels du lycée.
— Vous connaissiez le gars qui l’a embarquée à Cilaos ?
— Non, jamais vu, mais Lola en parlait beaucoup. Il était guide de montagne et moniteur de canyoning. C’est comme ça qu’elle l’a rencontré. Ils ont descendu en rappel les gorges de Fleurs Jaunes, vers Ilet à Cordes.
Je me suis souvenue d’une enveloppe mauve que Lola avait ouverte, le jour de son anniversaire. Mes beaux-parents nous avaient consultés, quelques semaines plus tôt, avec l’idée de lui offrir une expérience de canyoning pour ses quinze ans. Lola était sportive, elle adorait la nature et la montagne. L’idée était originale.
— Lola m’a montré des photos du guide. Elle les cachait dans le coffre de son scooter. Un grand gars au visage fin, d’une trentaine d’années, tout en muscles, avec un sourire à faire de la pub pour du dentifrice. Plus beau que tous les mecs du lycée. Et plus mûr aussi.
J’ai reconnu le discours de Lola sur ses copains de classe qui manquaient de maturité. « Ils ont seize ans et se comportent comme des bébés. »
— C’est avec lui qu’elle a commencé à fumer du zamal ? ai-je demandé.
— Non, c’est plutôt lui qui a commencé avec elle.
J’avais la sensation de ne rien comprendre, l’impression que nous ne parlions pas de la même personne. La Lola qu’elle décrivait ne ressemblait en rien à ma fille. Ma Lola, calme, sociable, enthousiaste n’était ni naïve ni inconsciente. Le lycée était à cinq minutes de la maison. Elle y allait à pied, rentrait à l’heure. Ses amies passaient la voir chez nous. De temps en temps, elles restaient dormir. Elles discutaient dans sa chambre, regardaient sur Internet des vidéos qui les faisaient rire ou des séries sur Netflix, et s’installaient dehors sur la terrasse pour manger des gâteaux et boire des sodas ou, parfois, une bière. Je n’avais jamais entendu parler d’Audrey. Encore moins de son frère qui réparait les scooters.
— Ce que vous me racontez, c’est ce qu’elle vous a dit ?
— Entre autres.
— C’est-à-dire ?
— Ce qu’elle m’a raconté… ce que mon frère m’a confié… ce que j’ai vu et entendu au lycée. J’ai croisé les informations, c’est tout.
De nouveau, j’ai cru percevoir un faible couinement ou une vibration à l’arrière.
— C’est quoi, ce bruit ?
— C’est rien, juste un truc dans mon sac.
— On dirait le gazouillis d’un bébé.
— Le quoi ?
— Le bruit que fait un bébé quand il joue à se mordiller les pieds dans son berceau. Ou un chiot. C’est ça ? Vous transportez un chiot ?
— Non.
— Un chaton ?
— Mon frère n’était plus le même depuis qu’il avait rencontré Lola.
— Je me fiche de votre frère.
— Lola, elle couchait avec tout le monde. Mon frère en était malade.
— Je ne crois pas un mot de ce que vous racontez, alors vous allez arrêter. Je vous déposerai à Saint-Leu et je ne veux plus jamais vous revoir.
— Il a fait une tentative de suicide. À cause d’elle, il a passé trois semaines à l’hôpital de Saint-Pierre, l’année dernière. Chez les cinglés. Avec les drogués et les alcooliques.
La voiture s’est arrêtée net. J’en suis descendue. J’ai fait le tour du véhicule par l’arrière. J’ai ouvert la portière, j’ai attrapé le bertèl et je l’ai balancé dans le fossé.
— Vous descendez.
— Qu’est-ce qui vous prend ?
— J’ai dit : vous descendez.
— Mais ça va pas ! Vous avez pété un câble ou quoi ?
— Vous dégagez. Et très vite.
Le contenu du sac s’était renversé sur l’herbe. Au milieu d’un énorme tas de feuilles séchées de zamal, un portefeuille orange et jaune, plein de billets, était tombé sur le côté, ainsi qu’un mobile Samsung bleu nuit dont la sonnerie s’était déclenchée, imitant le gazouillis d’un bébé.
Le portefeuille et le téléphone de ma fille.
On ne les avait pas retrouvés après l’accident.
- Fin du chapitre et du livre -

Tous les contenus du site internet de Lectivia sont protégés par la loi sur les droits d'auteur. L'utilisation, le partage ou la reproduction de toute partie du contenu sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur ou des ayants droits ou de Lectivia sera punis par la loi en vertu des règlements sur la violation du droits d'auteur et la propriété intellectuelle.

— Arrête !
— Quoi ?
— Arrête de taper dans les cailloux avec tes savates, ça m’énerve. En plus, tu vas te faire mal.
Ça changerait quoi ? Il avait déjà mal. Mal au ventre de ne pouvoir lui dire. Mal à la tête d’y penser sans relâche. Mal au cœur à cause des images qui tournaient en boucle à l’intérieur de ses yeux.
Il étouffait.
Elle s’en fichait.
Comment il allait lui dire ? À quel moment ?
Il y avait réfléchi une partie de la nuit et il y réfléchirait encore s’il ne trouvait pas de solution. Il s’est remis à taper dans les cailloux, à les envoyer valser d’un coup de savate, le plus fort qu’il pouvait, le plus loin possible. Comme dans la cour de récréation, après la cantine.
— Arrête, purée ! Faut t’le répéter combien de fois ?
Parce qu’elle avait les yeux rougis, il a évité de la regarder. Elle avait pleuré presque toute la nuit. De l’autre côté de la cloison, elle avait gémi, reniflé, s’était mouchée au moins dix fois. Blotti contre le tigre en peluche gagné à Pâques à la fête foraine, il n’avait pas dormi non plus.
Côte à côte, ils marchaient maintenant sur la route, en direction de la forêt. Le soleil était encore haut. À l’orée du bois, un papangue a déchiré l’air lourd et plongé en piqué sur une proie. Un peu plus tard, une jeune femme les a doublés en courant. Ses bras fendaient l’air comme les pales d’un moulin à vent pour attirer l’attention du Car Jaune qui venait de les dépasser. Sans doute comptait-elle monter dedans au prochain arrêt. Mais son chapeau s’est envolé et elle n’a plus eu aucune chance de rattraper le bus. Un chapeau de paille, avec un ruban vert, comme celui de la directrice de l’école. Madame Hoarau n’aimait pas le soleil à cause de ses taches de rousseur.
Joseph a cessé de donner des coups de pied dans les pierres. Ses orteils étaient écorchés et mangés par la poussière. Ils sont arrivés devant le ponton de bois. Il avait bien tenté de freiner la marche depuis le départ, mais voilà, ils y étaient. Ils finissaient toujours par y arriver, quoi qu’il fasse.
— Tu y vas tout seul ou tu veux que je t’accompagne ? a-t-elle demandé d’un ton sec.
Elle n’avait aucune intention de le suivre.
Ni l’un ni l’autre, avait-il envie de répondre.
Sans un mot, il a lâché la main de sa mère. Il s’est avancé sur le pont branlant. Un bras d’eau douce limpide se faufilait entre les galets. Joseph s’est souvenu qu’il était tombé dedans à plusieurs reprises. Il a enlevé ses savates pour traverser prudemment pieds nus dans l’eau fraîche, presque froide en ce début du mois de mai.
En face, un sentier de terre rouge montait en pente douce vers une case noyée sous la végétation.
C’était samedi, Joseph allait chez son père à Condé Concession.
Il ne s’est pas retourné pour regarder sa mère s’éloigner. Il savait qu’elle avait déjà tourné les talons. Quand viendrait donc le jour où elle le prendrait dans ses bras pour lui dire au revoir ? Il n’avait cessé d’espérer. Il était né par accident. Qu’y pouvait-il ? Son sac sur le dos, il a continué à gravir le coteau, sans se presser.
En haut, personne ne l’attendait hormis quelques volailles dans la cour. De leurs grands bras feuillus, les tamarins avalaient le toit de tôle qui, un jour, avait dû être blanc. La rouille en avait grignoté la moitié.
De la poche de son short, Joseph a extirpé la clé de la porte de derrière. Son père ne rentrerait que vers six heures. Il était employé à la commune du Tampon qui l’avait appelé ce samedi, exceptionnellement.
Joseph avait deux heures pour ranger la maison, faire la vaisselle, balayer la cour et préparer le dîner. Il regarderait ce qu’il y avait dans le frigo. S’il ne trouvait rien, il mettrait de l’eau à bouillir sur la gazinière, y jetterait un sachet de nouilles, ou ferait cuire du riz dans le rice-cooker et ouvrirait une boîte de cassoulet. Ce qui comptait, c’était que son père ait à manger en arrivant.
Sinon…
Sur sa droite, des piaillements vers la lisière de la forêt. Au-dessus de la route bitumée de la ligne des 400, une tache vert olive se débattait sur une branche basse : encore un merle-pays pris dans la glu. Son père s’obstinait à braconner. Un jour, il se ferait prendre et ce serait bien fait pour lui. Quand Joseph le mettait en garde, tout ce que son père trouvait à dire, c’était : « Moin lé pa la èk sa. »
Il s’en moquait, quoi.
Tout à l’heure, Joseph irait libérer l’oiseau. Pas sûr qu’il y arrive. La dernière fois, il avait failli arracher les pattes à un autre merle, avant de se résoudre à le laisser crier sur la branche.
Maintenant, Joseph regrettait d’avoir parlé à Anne-Lise, la remplaçante de la maîtresse. Elle avait détourné le regard avant de faire diversion en lui proposant d’emporter le livre qu’il n’avait pas eu le temps de finir. Il s’en fichait complètement de savoir la fin ou pas. Sans famille ! Ce n’était pas un roman à lui donner à lire. Si elle avait su. S’il avait eu le choix, il aurait pris un livre sur les chats. Un livre où on explique ce qu’un chat ressent lorsqu’il meurt. C’était la question qui lui vrillait l’estomac.
Il a avisé un caillou assez gros et rond et a shooté dedans de toutes ses forces.
Même pas mal.
Derrière le mur en parpaings, un chien a hurlé dans la cour d’à côté. Il avait dû recevoir la pierre sur la gueule.
Pas de chance ! Pas fait exprès.
Joseph a déverrouillé la porte en forçant un peu sur la serrure.
Dans l’entrée, comme chaque samedi, il a frissonné en apercevant les fusils de chasse suspendus à des clous rouillés. Trois fusils marron et deux vieilles carabines 12 mm. Un peu plus loin, des jumelles, à un autre clou. Les armes, tête vers le haut, n’étaient pas chargées. Le dimanche, son père les utilisait pour chasser des lièvres dans les branles, du côté de La Plaine des Cafres où il posait des collets.
Joseph a jeté son sac derrière la porte. D’un mouvement de cheville, il a envoyé ses savates sur le meuble à chaussures en plastique. Au-dessus du meuble, un miroir lui a renvoyé son image : visage ovale plongeant vers un menton pointu, cheveux châtain clair, yeux marron tristes, peau blanche légèrement hâlée, le nez un peu trop long, les lèvres fines un peu trop crispées à son goût. Il n’aimait pas le grain de beauté sous son œil gauche. Une bande de coquillages, fixés à la colle Scotch, cerclait le miroir.
Joseph a souri.
Dans la glace, son visage s’est éclairé.
L’année dernière, il avait réalisé le plus beau cadeau de fête des Pères de tous les élèves de sa classe de CP. Quand il l’avait offert à son père, celui-ci l’avait aussitôt accroché dans l’entrée. Les murs semblaient vibrer encore de la joie que Joseph avait procurée à son père.
— Astèr, mon pti gaté, ou lé in lartist. Na poin in zafèr lé gayar komsa dann la kaz.
Un artiste dans la maison, quelle chance !
Son père, lui, savait lui faire oublier sa naissance indésirable.
Indésirée.
Derrière le cadre, un margouillat a pointé un bout de museau. Joseph a repensé au chat. Il faudrait bien qu’il explique à sa mère. Il n’avait pas voulu que ça arrive. C’était un accident. Il n’avait juste pas réfléchi. C’est tout. Seulement voilà, elle le lui répétait tous les jours :
— Fais attention, Joseph, tu vois bien que c’est dangereux.
Maintenant, il était un assassin. Bien fait pour lui. Il l’avait cherché. Il irait en prison. Dans une prison pour enfants où on mange du riz sec et des brèdes. Il serait enfermé dans une cellule moisie. Des grands avec des poux plein la tête lui feraient la peau. Il l’avait entendu à la télévision : les détenus règlent leur compte aux meurtriers et les gardiens ferment les yeux.
Il avait peur. Mais rester sans rien dire l’effrayait tout autant. Peut-être que sa mère pourrait l’aider. Une fois qu’elle aurait fini de pleurer la mort de son chat et de verser des larmes de découragement, parce que son fils était un bon à rien.
Il se ferait tout petit.
Encore plus petit.
Lorsqu’elle aurait épuisé son stock de larmes, il lui prendrait la main. Enfin, si elle le laissait approcher. Mais peut-être qu’elle pleurait pour autre chose que la mort de Figaro. Peut-être qu’elle pleurait le départ de son mari.
Le lendemain de Noël, quand elle s’était aperçue que Joseph avait vidé les flacons de parfum neufs dans le lavabo de la salle de bains, elle l’avait menacé de le placer dans une famille d’accueil. Il ignorait que c’était possible, ça, qu’on pouvait déménager un enfant, tout seul, dans un autre foyer, s’il n’était pas gentil. Il croyait qu’il resterait toujours avec sa mère. Ou, au pire, avec son père. Même s’il n’aimait pas les fusils dans la maison. Les armes, c’était pour la chasse, dehors, ou pour la guerre.
Dans une autre famille, il n’y aurait peut-être pas eu de chat, donc pas de meurtre de chat.
Pas d’accident de chat, a-t-il corrigé mentalement.
Il aurait préféré. C’était trop tard. Et sa mère n’achetait plus de parfum, alors il n’avait plus rien à vider lorsque la colère le submergeait.
Elle disait toujours :
— Arrête tes conneries, Joseph ! Après tu vas le regretter, mais ce sera trop tard.
Il ne répondait pas, ou bien juste :
— J’ai pas fait exprès.
— C’est bien ce que je te reproche. Je voudrais que tu fasses exprès de ne pas le faire.
Il a dégluti.
Il irait digérer la leçon en prison.
Comme tous les samedis, il a commencé par lancer des grains de maïs aux volailles qui gloussaient. Puis il a balayé la cour. Les feuilles mortes dansaient dans la poussière orangée qui lui giclait au visage. Il a éternué à plusieurs reprises.
Ensuite, il a rangé le séjour et la cuisine. Son père laissait tout traîner. Il a ramassé les vêtements sales par terre, les barquettes en plastique achetées chez le Chinois, en face de la mairie, et les chaussures qui sentaient mauvais. Il a caché ces dernières dans un goni déchiré qui dépassait du meuble à chaussures. Le sac en toile de jute était rempli de chaussettes en tire-bouchon. Son père avait les jambes poilues comme des pieds de palmiste. Il s’est demandé s’il aurait, un jour, de grands poils noirs comme lui, partout sur les mollets.
Il n’avait pas envie de grandir.
Il s’est attaqué à la vaisselle. De la sauce de soja marron dégoulinait des assiettes. Des yeux gras flottaient dans une casserole. Il a craché dessus. Des bulles ont fait exploser les yeux jaunes un à un. Il a repensé à la soupe de la prison. Et aux yeux de Figaro agonisant. Il a fouillé les placards. Une boîte de raviolis. Parfait. Du frigo, il a sorti un sachet de fromage râpé ouvert qui sentait un peu le moisi, mais qui ferait l’affaire. Il a mis deux doses de riz et deux d’eau dans le rice-cooker qu’il a branché sur la paillasse.
Oubliant l’oiseau pris au piège, il a allumé la télévision, a choisi une série pour enfants et s’est allongé sur le canapé en tissu.
Il s’est endormi.
Le chat l’étouffait. Ses énormes pattes noires appuyaient sur son cou où les veines gonflées traçaient un réseau en relief. Il était comme paralysé. Les griffes étaient plus longues que les dents de la fourche de son père planquée derrière le pied de letchi. Il essayait d’appeler à l’aide, mais aucun son ne sortait. Sa bouche de poisson tétait l’air sans bruit. Il battait de la queue sous la patte du chat qui l’observait, tranquille et froid. Des yeux jaunes du félin coulait un liquide visqueux, comme la glu meurtrière que son père étalait sur les branches.
Un crissement de pneus sur les scories du chemin l’a réveillé. Il faisait jour. Par la fenêtre, il a reconnu la voiture cabossée de sa mère.
— Ton père a eu un accident en sortant de la mairie.
— Il est mort ?
— Non. Il est aux urgences du Tampon. Dépêche-toi.
— C’est grave ?
— Non, une jambe cassée et deux côtes fêlées.
— Il va mourir ?
— Non. Arrête de poser des questions. Tu me fatigues.
Joseph a pris le trousseau de clés sur la table basse et a rejoint sa mère dans la cour. Il s’est souvenu du chat. Dans la voiture, oui, c’était une bonne idée. Il lui raconterait toute l’histoire pendant qu’elle conduirait. Ce n’était pas de sa faute. Elle comprendrait. À côté de l’accident de son père, l’incident du chat, cela ne serait plus grand-chose.
— Il faut qu’on accélère. Je n’ai pas de temps à perdre, moi. Après, je dois retourner travailler à la boulangerie.
Le dimanche, la boulangerie du Douzième kilomètre restait ouverte jusqu’à quinze heures. C’était pour cette raison que Joseph passait les weekends chez son père.
Il ne savait pas ce qu’il préférait : les jours d’école dans le petit appartement rénové de sa mère, à la Ligne Paradis, ou les weekends dans la case de son père, en pleine nature, à Condé Concession.
Il glissait d’un monde à l’autre en passant de la langue française au créole. Quand quelqu’un demandait à son père : « Comment ça va, Charly ? », celui-ci répétait invariablement la même blague éculée : « Savate deux-doigts ». Et sa mère disait que sa blague à deux balles ne faisait plus rire personne.
Sur la quatre-voies qui menait au Tampon tout était gris. Un fin brouillard aspirait les couleurs.
Joseph a pris son courage à deux mains.
— Jeudi, quand je suis rentré de l’école en vélo, le chat me barrait la route. Il était allongé de tout son long en travers du chemin. Tu sais, là où la clôture est cassée, près de la boîte aux lettres.
Il ignorait si sa mère l’écoutait ou si elle était déjà mentalement à l’hôpital avec son père, ou à la boulangerie avec sa grosse patronne qui criait tout le temps. Elle ne réagissait pas. Elle fixait la route, droit devant, et, pour une fois, elle n’a pas dit : « Arrête ! »
— Pour lui faire peur, j’ai foncé dessus. Je me serais arrêté à temps, je le jure. Je suis un pro des dérapages.
Il voulait juste effrayer le chat, mais celui-ci s’était sauvé par la droite, vers le four à chaux. Ce n’était pas prévu. Joseph avait sauté du vélo et couru derrière l’animal parce que, un peu plus loin, dans les herbes hautes, il avait posé des collets. Attraper un lièvre prouverait à son père qu’il méritait de l’accompagner à la chasse.
La tête de Figaro était coincée dans le nœud coulant. Au fond de ses orbites, ses yeux roulaient à lui déboulonner le cerveau. Ses griffes pédalaient dans l’air et un son bizarre s’échappait de sa gueule. Un cri rauque comme Joseph n’en avait jamais entendu. Il s’était approché. Le chat avait agonisé à ses pieds. Joseph s’était efforcé de ne pas le regarder, mais c’était impossible.
— J’ai rien pu faire. J’ai attendu qu’il meure. Ensuite, j’ai coupé la corde du collet avec le sabre à canne que tonton Michel pose le long du grillage. Après, j’ai paniqué et j’ai caché le corps dans le fossé.
Ils étaient arrivés à l’hôpital. Les essuie-glaces couinaient en chassant la pluie qui s’abattait sur le pare-brise. Sa mère a garé la voiture. Elle a observé Joseph dans le rétroviseur intérieur. Longtemps, sans rien dire. Joseph se tenait droit, immobile sur le siège arrière, le regard fixé sur l’appui-tête avant. La sueur lui ruisselait des aisselles aux poignets.
Sa mère a ouvert la portière. Il a fait de même. Ils sont sortis de la voiture, sous l’averse. Le macadam irrégulier du parking peinait à déglutir l’eau qui s’accumulait dans les creux.
Sa mère s’est tournée vers lui et, contre toute attente, l’a serré très fort dans ses bras, presque trop fort. Il a cru qu’il allait étouffer, comme le chat pris dans le piège, et ce serait un juste retour des choses, œil pour œil, dent pour dent.
Il sentait le visage mouillé et chaud de sa mère contre le sien. Sa peau collait. Elle pleurait. Quand est-ce qu’elle allait arrêter de pleurer ?
Il n’a rien dit, rien de plus que tout ce qu’il avait déjà dit.
Cela suffisait.
L’haleine de fumeuse de sa mère lui a donné la nausée. Il a essayé de desserrer son étreinte. Elle s’est penchée pour lui murmurer quelque chose à l’oreille.
Quelque chose que personne ne lui avait jamais dit.
Que les parents disent à leurs enfants.
Quelque chose qu’il avait attendu sept ans.
Qu’il s’était juré de dire un jour à son fils.
Il n’était pas sûr d’avoir bien entendu le « je t’aime ». Il ne lui demanderait pas de répéter. Il n’avait pas oublié son « Arrête de poser des questions. Tu me fatigues. » Si elle ne le lui redisait plus, il resterait avec ce doute jusqu’à la fin de sa vie.
Et ce serait bien fait pour lui !
Maudit chat…
- Fin du chapitre -

Tous les contenus du site internet de Lectivia sont protégés par la loi sur les droits d'auteur. L'utilisation, le partage ou la reproduction de toute partie du contenu sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur ou des ayants droits ou de Lectivia sera punis par la loi en vertu des règlements sur la violation du droits d'auteur et la propriété intellectuelle.

— Hôtesse de l’air ? Mais ma pauv’ fille, tu t’es regardée ? Pourquoi pas top model aussi, ou pute, tant que tu y es ? Tu rêves d’être bonniche sur Air Austral, c’est ça ?
— Non, je veux travailler sur Air France.
— Bonniche sur Air France, c’est pareil.
Le père a reposé son verre vide sur la table, près de la bouteille de rhum Charrette. La brume des Hauts avait envahi l’étroite cuisine en même temps que le soleil de mai disparaissait derrière le Piton Cabri. L’humidité imprégnait tout, du sol en béton ciré au plafond. L’esprit du père, lui, était brumeux depuis longtemps, aussi brumeux que sa Sologne natale.
Debout près de la porte, Mylène a baissé les yeux comme chaque fois que son père élevait la voix. Ses pieds nus portaient encore les empreintes creusées sur sa peau par les lanières de ses sandales. Quand elle serait riche, elle s’achèterait des chaussures à sa taille, au lieu de toujours devoir finir d’user celles de sa mère qui faisait une pointure de moins. Et elle prendrait l’avion. Avec la vieille valise noire qui moisissait derrière le buffet, elle irait à Gillot et s’envolerait dans un Boeing 747.
— Ou une fac de philosophie ? a-t-elle tenté, le regard fuyant. Je pourrais devenir professeur ou journaliste. Je pourrais travailler pour le Journal de l’île, a-t-elle continué, les yeux rivés sur ses orteils colorés par la terre rouge du chemin qui menait de la route goudronnée à la maison.
Tout en parlant, elle triturait un cahier qui semblait avoir vécu dix vies. La couverture écornée était déchirée au-dessus du Clairefontaine inscrit en majuscules bleues. Un des cahiers achetés au Mini-Market, à la rentrée d’août, qu’elle n’avait pas utilisé pour les cours au lycée.
— Y a une fac de philo à Saint-Denis ? a demandé son père.
— Non.
— Ben alors ?
— Faut aller en métropole.
— Et tu crois qu’on va t’payer des études à Paris ? Tu t’prends pour qui ? On n’a pas les moyens d’offrir à mademoiselle un logement pour faire la fête avec ces merdeux d’étudiants friqués.
— J’vais pas faire la fête, papa, je veux étudier.
— Tu parles ! La philo ! Qui t’a mis des idées pareilles dans la tête ? C’est encore ce con de prof, là, celui qui vient en cours en débardeur, short, et casquette à l’envers. La liberté ! Il me fait marrer. Il a oublié de grandir ou quoi ? C’est pas avec Platon que tu vas réussir à manger et à te payer un loyer. Non mais, t’entends ça, Cécile ? De la philo !
Jetant un coup d’œil à sa femme, assise à l’autre bout de la table, il a tiré sur son cinquième joint de la journée. Il était râblé, le visage rougeaud, les cheveux gras. Les muscles de ses bras bronzés saillaient là où s’interrompaient les manches de son T-shirt Quiksilver. Il a recraché la fumée dans la chevelure de sa fille qui n’a pas bougé.
Faut pas que je me laisse enfumer, a pensé Mylène, toujours immobile.
La mère, avachie sur une chaise bancale, est intervenue, aussi ivre que son mari, l’esprit aussi nébuleux.
— Et vendeuse, Frank ? Ce serait bien, vendeuse, pour elle, non ? Enfin, si elle y arrive…
En soupirant, elle a défait le nœud qui retenait ses longs cheveux noirs qu’elle a enroulés autour de son index, avant de remettre l’élastique en place pour maintenir sa queue de cheval. Avec ses yeux en amande, son nez retroussé et ses lèvres fines, elle aurait pu être belle.
— J’ai eu quinze de moyenne générale, ce trimestre, et les félicitations, s’est défendue l’adolescente. J’aurai le bac avec mention, tous mes profs le disent.
— Le bac, le bac ! Ils le donnent à tout l’monde. Hein, Cécile ? Même nous, on l’a eu. Même ton abrutie d’copine qui m’regarde pas quand j’lui parle, elle l’aura.
— Marcelline ?
— J’sais pas comment elle s’appelle. Celle qui est venue ici pour ton anniversaire.
— Marcelline. C’est la première de la classe.
— Ben, première ou pas, elle me regarde pas quand j’lui parle.
— Tu lui fais peur.
— Non, mais t’entends ça, Cécile ? Je terrorise les gosses maintenant.
Sa femme a tangué sur sa chaise. Puis, après un basculement sur la gauche et un autre sur la droite, elle a réussi à rétablir son équilibre.
— Vaut mieux entendre ça que d’être sourd, est-elle parvenue à articuler.
Mylène a réprimé les larmes qui montaient. Elle regrettait d’avoir invité Marcelline chez elle. C’était pourtant la seule amie à avoir franchi le seuil de cette maison. Elle n’osait plus inviter personne.
Marcelline n’était venue qu’une fois, en mars, pour les dix-huit ans de Mylène. Dix-huit ans, ça se fête, quand même !
Marcelline habitait à Saint-Louis, pas loin de l’usine sucrière du Gol, dans une petite case en bois sous tôle, comme Mylène, mais avec de vrais parents. Mylène aimait bien y aller. Souvent, après les cours, elles faisaient leurs devoirs ensemble, sur la grande table de la salle de séjour, en sirotant une tasse de café ou une limonade. Elles discutaient des heures dans la chambre que Marcelline partageait avec deux de ses sœurs. Quand elles avaient fini, la mère de Marcelline leur apprenait à préparer un rougail morue ou un gâteau patate. Dans la cour en terre battue, Marcelline jouait aux billes avec ses jeunes frères et sœurs, ou à la marelle et à l’élastique. Contrairement à Mylène, elle ne s’ennuyait jamais.
Et il y avait Benoît, le frère aîné de Marcelline. Quand il rentrait du boulot, il s’installait sur le canapé et lisait des romans de Jules Verne. Pas de bière, pas de rhum, pas de cigarette. Il souffrait d’épilepsie.
— Ouais, Cécile, t’as p’t-être raison, ta fille est propre et souriante, et tu pourras toujours demander au patron du Mini-Market de la prendre. Il t’a à la bonne, le Chinois, depuis que t’as dénoncé le client qui piquait des boîtes de sardines.
Il s’est mis à rire.
— Des sardines ! Tant qu’à voler, il aurait mieux fait de piquer du Dom Pérignon ou du Petrus.
Au milieu des éclats de rire du père, le frère de Mylène est entré dans la pièce. Il sentait l’urine et le vomi dans son pyjama qui, un jour, avait dû être bleu. Un doudou crasseux dans la main droite, il a tiré, de sa main gauche, sur le bas du peignoir informe qui enveloppait leur mère.
— Monmon, bibi, monmon, bibi.
Il avait la peau claire, comme sa mère, alors que Mylène avait hérité du teint méditerranéen de son père. À bientôt trois ans, le petit garçon souffrait de problèmes d’élocution. Son cerveau tournait au ralenti.
La mère a posé son verre, vide comme le cerveau de son fils, sur la toile cirée tachée, où trônaient des bouteilles de bière Bourbon et une pile d’assiettes rougies par la sauce du carri de porc de midi. À son tour, elle a allumé un joint en attrapant le biberon : une cuillère à café de rhum diluée dans deux cents millilitres de lait tiède, de quoi endormir le môme sans qu’il fasse le cirque. Elle était fière d’avoir trouvé la solution pour qu’il arrête de leur casser les pieds, le soir. En se retournant vers la gazinière, elle a saisi la poignée à moitié dévissée de la casserole en inox encore chaude. Elle a rempli le biberon en plastique où stagnait un fond du lait utilisé le matin, puis a placé la casserole sur un rectangle de bois qui servait tantôt de dessous-de-plat, tantôt de planche à pain et, occasionnellement, de cale pour la table.
— J’veux pas travailler dans un magasin comme toi, maman, je veux faire des études, a repris Mylène, rassemblant ce qui lui restait de courage.
Le père a tapé du poing.
— Tu ne parles pas à ta mère sur ce ton. Cécile, dis quelque chose.
Une bouteille de bière a roulé sur la toile cirée et s’est fracassée par terre. Du bout de sa savate, la mère a poussé les éclats de verre sous la table.
— Écoute ton père. Tu me parles pas sur ce ton, a-t-elle déclaré, sans même regarder sa fille.
Mylène a observé ses parents, se demandant ce qu’elle avait de commun avec ces ivrognes fainéants. Elle avait de la chance d’être née quinze ans avant son frère. Ils avaient déboulé à La Réunion, deux décennies plus tôt, parce qu’un de leurs copains surfeurs leur avait écrit que c’était l’endroit rêvé : « Les vagues sont magnifiques. On est en maillot de bain toute l’année. Pas de facture de chauffage à la fin du mois. Pas de vêtements à acheter. Du beau temps trois cent soixante-cinq jours par an. »
Alors, ils étaient venus, ils avaient surfé, et ils s’étaient installés dans une colocation, vers la grande ravine de Saint-Leu, vivant de pas grand-chose, un petit boulot par-ci, une indemnité de l’État par-là, un peu d’argent envoyé par la mère de Cécile et les grands-parents, jusqu’au moment où Cécile avait changé la donne en tombant enceinte. Surfer avec un marmay sur le dos, c’était inenvisageable, même si les parents de Mylène l’avaient sûrement envisagé.
Et le matin, c’était moins fun, à cause des pleurs nocturnes de la gamine. Ils étaient de vraies loques. Putain de môme. Impossible de s’arracher du lit avant midi. Laissant passer les vagues, ils avaient remisé leurs planches au fond du garage d’un copain. Cécile avait trouvé une place de caissière au Mini-Market de L’Étang-Salé. De temps en temps, Frank bricolait pour une boutique de surf, sur le port de Saint-Leu. À l’étroit dans leur chambre, ils avaient fini par quitter la colocation d’origine que leurs potes avaient désertée depuis longtemps. Ils avaient emménagé dans un petit meublé, au-dessus de la ligne droite qui traversait les champs de canne en direction de l’usine du Gol, à Saint-Louis.
Dans les Hauts, les loyers étaient abordables.
Fixant du regard le biberon qui se vidait dans le gosier de son frère, Mylène a cherché en vain d’autres arguments. Elle n’avait pas envie d’être à la merci des mains baladeuses du chef de rayon dont sa mère se plaignait à ses voisines, un jour sur deux. Son père était-il au courant ?
— Je ne vais pas passer ma vie à remplir des gondoles au Mini-Market, ni à trancher du saucisson ou du jambon, avec un bonnet plastique sur la tête. Je veux réaliser mon rêve, moi.
— Parce que tu crois que, dans la vie, on réalise ses rêves ? Moi, si j’avais eu le choix, je serais en train de surfer à Hawaï, tiens, et ta mère, elle serait pas assise là, à écouter tes conneries. Hein, Cécile ? Le pipeline de Waimea, c’est autre chose que la gauche de Saint-Leu.
Il a écrasé son mégot dans un cendrier cassé où se consumait un tortillon antimoustique à la citronnelle.
— C’est pas parce que vous n’avez pas su réaliser les vôtres que je ne vais pas suivre le mien.
— Tu la veux, celle-là ? a menacé le père, la main brandie au-dessus de la tête. Il s’est arrêté net en grimaçant : « Putain ! » Il avait réveillé sa tendinite à l’épaule droite.
— J’ai dix-huit ans maintenant.
— Et alors, qu’est-ce que ça change ?
— Je suis majeure.
— C’est pas ça qui va m’empêcher de t’en coller une. T’en aurais vingt que ce serait pareil.
— Tu ne me fais pas peur.
Pris de court, il s’est tourné vers sa femme.
— Si j’avais pas assisté à ton accouchement, Cécile, j’aurais du mal à croire que c’est ta gosse.
Mylène s’est tue.
Plus que la violence physique de son père, sa violence verbale faisait mouche à tous les coups. Elle avait compris, depuis des années, qu’il aurait mieux valu qu’elle ne vienne pas au monde. Seulement voilà, elle était là, et elle était leur fille. Elle s’estimait heureuse : elle aurait pu être aussi abrutie qu’eux.
— Nous, à ton âge, on s’imaginait surfeurs professionnels. Tu vois le résultat, a relancé la mère.
Après une seconde d’hésitation, Mylène a pris son courage à deux mains.
— Moi, mon rêve, c’est d’être écrivain.
— Écrivain ? se sont exclamés ses parents d’une seule voix.
— Mais pour écrire quoi ? a demandé son père.
— Pour m’évader dans un autre univers. Pour inventer des histoires.
— Des histoires de quoi ? De Grand-mère Kalle ? De Sitarane ?
— Pour raconter les confidences de tes copines du lycée ? a ajouté sa mère.
— Tu vas pas raconter notre vie quand même ? s’est inquiété son père.
Tiens, je n’y avais pas pensé, s’est dit Mylène.
Le père s’est resservi une rasade avant d’amorcer une tentative pour se lever de sa chaise. Il a désigné la bouteille vide.
— Va en chercher une autre, Mylène.
— Y en a plus, a précisé la mère, c’était la dernière.
— Quoi ? On a déjà descendu les trois litres de rhum que t’avais rapportés hier midi ?
— Ben oui. Les trois Charrette. Plus le Bordeaux que le chef de rayon m’avait filé en douce, à la fermeture du magasin, samedi soir.
En échange de quoi ? a failli demander Mylène.
Une pluie régulière tambourinait maintenant contre la tôle. Avec la tombée de la nuit, le vent austral s’infiltrait à travers les boiseries creusées par les termites. Même s’il tenait mieux l’alcool que sa femme, le père avait du mal à rester debout. Il s’est appuyé sur un coin de la table.
— J’ai jamais lu un livre de ma vie et ma fille veut devenir écrivain ! On aura tout vu. C’est pas un métier, ça, tu m’entends ? Laisse ça aux intellos. De toute façon, ils ont déjà tout écrit.
— Je veux écrire des romans.
— Des romans ?
— Comme Marguerite Duras.
— C’est qui celle-là ? Tu sais qui c’est, toi, Cécile ?
— Jamais entendu parler.
— C’est celle qui a écrit Un barrage contre le Pacifique, a expliqué Mylène. Je l’ai étudié en classe l’an dernier, pour le bac de français.
— Connais pas.
— D’ailleurs, j’en ai presque fini un.
— Un barrage ?
— Ben non, un roman. J’ai pres-que fi-ni d’é-crire un ro-man.
Mylène n’était pas sûre que ses mots traversent l’opacité de leur cerveau.
Elle a secoué le cahier blanc qu’elle tenait à la main. Cent cinquante pages écrites en six mois, cachées dans son cartable qu’elle gardait avec elle, nuit et jour. Entourée de livres, de dictionnaires, de manuels scolaires, elle avait passé des heures au CDI du lycée à remplir son cahier, assise à la table en formica, près de la verrière avec vue sur la mer.
Le samedi après-midi, elle continuait à la bibliothèque de L’Étang-Salé, bien au frais dans la salle de lecture climatisée qui donnait sur une haie d’hibiscus plus haute que le premier étage.
De temps en temps, elle relevait la tête pour observer Benoît, debout un peu plus loin, occupé à réparer les ordinateurs du club informatique. Si leurs regards ne se croisaient pas, elle comptait jusqu’à trente avant de risquer une nouvelle tentative. Quand leurs regards se croisaient, il lui souriait. Elle rougissait et, l’inspiration décuplée par le charme du jeune homme, elle replongeait dans l’écriture de son roman. Son stylo se mettait à trembler.
Il avait vingt ans. Il avait quitté le lycée après la seconde. Il jouait au foot dans l’équipe de La Dominicaine. Le dimanche, elle allait parfois au stade assister aux matchs avec Marcelline. Perchées en haut des gradins, à l’ombre de l’avant-toit du gymnase, elles encourageaient l’équipe de Benoît en buvant un Cot citron. À la fin de la rencontre, elles l’attendaient à la sortie des vestiaires. Elles regardaient défiler les joueurs en maillot vert et jaune. Ceux qui connaissaient Marcelline venaient les saluer. Quand Benoît sortait enfin, sa sœur le félicitait, quel que soit le résultat du match, et Mylène ne savait jamais quoi dire. Elle s’efforçait d’avoir l’air sûre d’elle, mais en réalité, elle se sentait bête et moche, avec ses vêtements qui n’avaient plus de couleurs et ses sandales usées.
— Où t’as trouvé le temps d’écrire ? T’es censée travailler pour le bac, et, si tu as un moment de libre, c’est pour aider ta mère avec le ménage, le linge, la vaisselle et Kevin. Regarde-moi, ça !
Son père a repoussé les assiettes sales et s’est mis à gratter de l’ongle les miettes de pain agglutinées en croûtes sur la toile délavée.
— C’est dégueulasse ici.
Pour une fois, Mylène était d’accord avec lui. C’était dégueulasse, répugnant et de pire en pire. Qu’est-ce qui l’empêchait, lui, de nettoyer tout ça ?
Sa mère n’a pas bronché, sûrement déjà trop ensuquée. Les yeux ternes et le teint fatigué, elle a agité la main devant elle pour chasser un moustique imaginaire. Elle a tourné son regard vers le canapé en skaï au dossier déchiré. Kevin s’était endormi. Le biberon avait roulé vers le montant de l’accoudoir, semant des gouttelettes blanches qui finiraient par sécher en laissant des auréoles sur le similicuir. La pointe d’une planche de surf jaunie dépassait sous la banquette.
La seule chose de rangée dans cette maison, ce sont les rêves, a pensé Mylène. Les rêves et les bouteilles pleines.
Le père a tendu un bras vers sa fille.
— Montre un peu ton truc, là, qu’on lise c’que t’as écrit.
Aussitôt, Mylène a caché le cahier dans son dos, hors de portée des mains grasses de son père.
— Non, personne ne le lira. Surtout pas vous.
— T’as peur des critiques ?
— Non, plus maintenant. Je le montrerai à Marcelline.
Et à Benoît, s’est-elle promis.
Le bras de Kevin a glissé du canapé, entraînant le biberon qui a d’abord ricoché sur la pointe de la planche de surf, puis sur le sol. Le lait a recommencé à couler doucement sur le béton. Mylène s’est avancée vers son frère. Elle l’a réinstallé au milieu des coussins râpés et a ramassé le biberon collant. « Monmon, bibi, monmon, bibi », a répété Kevin dans son sommeil. Il s’est mis à sucer son pouce. Ses petits orteils se rétractaient et se détendaient au fur et à mesure que les images de ses rêves lui traversaient le cerveau.
À quoi pouvait-il bien penser ?
À quoi rêve un enfant ivre ?
Mylène ne boirait jamais d’alcool.
— Allume, a ordonné son père. On voit plus rien là-dedans.
Mylène a fait trois pas vers la porte sur laquelle était affiché un calendrier des pompiers dont personne ne tournait les pages. Elle a appuyé plusieurs fois sur l’interrupteur avant que l’ampoule du plafonnier daigne réagir et diffuser une lumière blafarde au-dessus du buffet, éclairant la photo de ses parents le jour de leur mariage, à Lamotte-Beuvron, en Sologne, au pays du Grand Meaulnes.
Inutile de leur parler d’Alain Fournier ou de François Seurel. Ils n’avaient sûrement pas plus lu Le Grand Meaulnes que les romans de Marguerite Duras.
Un ananas, donné par la mère de Marcelline, pourrissait dans la coupe à fruits. Des mouches tournoyaient, voletant de l’ananas à un morceau de papaye que personne n’avait pris la peine de mettre dans le frigo.
— Il va falloir que je cherche un éditeur.
— V’là aut’ chose. Tu vas rien chercher du tout. Tu vas bosser ton bac et aider ta mère.
— L’un n’empêche pas l’autre. J’enverrai mon manuscrit à des maisons d’édition et on verra bien.
— On verra rien du tout.
Elle s’imaginait découvrant, un matin, dans la boîte aux lettres, un courrier d’une grande maison parisienne. Est-ce qu’elle leur donnerait son vrai nom ou est-ce qu’elle utiliserait un pseudonyme ? Mylène Charbonnier, cela n’était pas le nom du siècle. Mylène C. ? Ou Meryl, à la place de Mylène ?
Elle prendrait l’avion pour la capitale, elle qui n’avait jamais quitté La Réunion. On la recevrait comme une princesse. Elle signerait un contrat dans un salon aux murs tapissés de livres, et alors, adieu la case miteuse, la crasse et les alcooliques. Adieu les rayons du Mini-Market et la trancheuse à jambon. Adieu les habits trop petits, les souliers râpés et les draps poisseux.
Elle dînerait au restaurant, dormirait à l’hôtel, ferait les magasins sur les Champs-Élysées. Elle irait chez le coiffeur et l’esthéticienne. On lui livrerait des fleurs dans sa chambre. Elle irait au cinéma, au théâtre, voir des expositions. Elle se promènerait sur les quais de la Seine. Elle monterait en haut de la tour Eiffel. On la prendrait en photo. Elle enverrait des cartes postales à Marcelline et à Benoît.
— Tu feras rien sans ma permission, a lancé son père.
— J’vais m’gêner.
— Il te faudra des sous pour expédier ton manuscrit. On va pas t’en donner. On n’en a pas.
— Je trouverai un moyen. J’irai faire le ménage à la bibliothèque. Ils ont mis une annonce. Ils cherchent quelqu’un.
— Ma fille ne fera le ménage chez personne.
— C’est pas pire que d’être employée au Mini-Market. Au moins, personne ne me tripotera les fesses, là-bas…
Elle a jeté à sa mère un coup d’œil qu’elle aurait voulu complice, mais cette dernière était hors-jeu. Mylène n’aurait su dire si elle s’était endormie sur sa chaise, ou si elle n’était plus en état de capter la conversation autrement que comme un bruit de fond.
*
Cette année-là, Mylène a obtenu le bac avec mention bien. Ses parents ne l’ont pas félicitée. Le lendemain, elle a été engagée au Mini-Market sur les recommandations de sa mère. Six mois plus tard, elle a démissionné et, contre l’avis de son père, elle a épousé Benoît.
— C’est un bon à rien, celui-là, même pas capable de me dire bonjour quand il me croise. En plus, il bégaie.
Avec son mari, elle s’est installée dans la maison de la mère de Marcelline. Elle a fait le ménage à la bibliothèque, le temps de rassembler suffisamment d’argent pour s’acheter un ordinateur d’occasion. Pendant huit semaines, elle a tapé et corrigé le texte de son roman. À la bibliothèque, elle l’a imprimé en trois exemplaires, moyennant une vingtaine d’euros. Elle a ensuite envoyé son manuscrit à trois grandes maisons d’édition à Paris.
Le weekend, elle rendait visite à sa famille. Refusant de la voir, son père disparaissait dès qu’elle franchissait le seuil. Elle nettoyait la case de fond en comble et la débarrassait des dizaines de bouteilles vides accumulées pendant la semaine. Elle s’assurait que Kevin allait à l’école, qu’il y avait de quoi manger dans le frigo et que sa mère ne portait pas de traces de coups.
Un matin de mai, deux ans jour pour jour après la conversation dans la cuisine, elle a reçu une lettre : son roman serait publié à la rentrée de septembre.
Le trente novembre, alors que les jacarandas refleurissaient dans la cour, Mylène est passée chercher ses parents. Ils avaient du mal à marcher mais, bras dessus, bras dessous, elle a réussi à les emmener jusque devant la Librairie de L’Océan, près de l’église, en centre-ville. Elle avait arrangé ses cheveux en un chignon qui lui dégageait la nuque et lui donnait « une certaine classe » avait dit Benoît, avant qu’elle ne parte. Elle avait enfilé une robe neuve, des sandales neuves et arborait un petit sac en cuir neuf.
Dans la vitrine, entre les cahiers Clairefontaine, les manuels scolaires et les articles de papeterie, une pile de livres s’élevait en plein soleil. Sur la couverture bleue s’étalait une photo de Mylène en gros plan, prise devant un flamboyant. Tout en haut, un titre, en lettres noires : Bouteilles vides. Un peu plus bas, en plus petit : Mylène Charbonnier.
— Tu vois, papa. Tu disais que je n’y arriverais jamais, s’est exclamée Mylène.
Son père s’est tourné vers elle et, sans un mot, lui a collé la gifle qu’il avait regretté de ne pas lui avoir donnée deux ans plus tôt.
- Fin du chapitre -

Tous les contenus du site internet de Lectivia sont protégés par la loi sur les droits d'auteur. L'utilisation, le partage ou la reproduction de toute partie du contenu sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur ou des ayants droits ou de Lectivia sera punis par la loi en vertu des règlements sur la violation du droits d'auteur et la propriété intellectuelle.