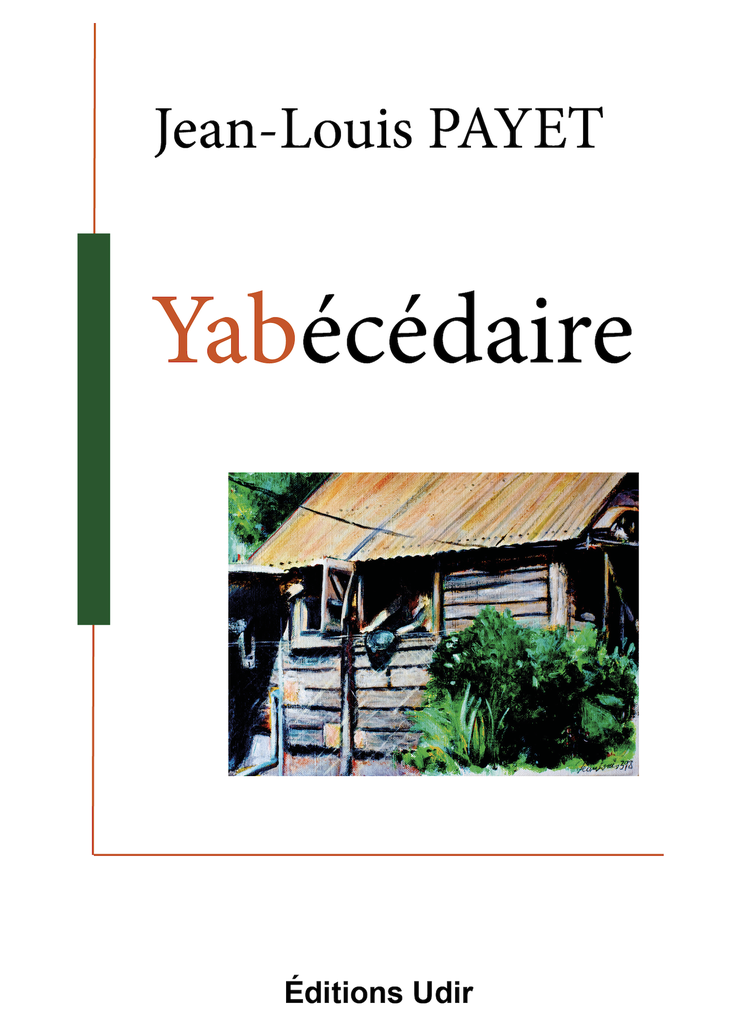
Yabécédaire
Editeur : UDIR
Auteur : Jean-Louis PAYET
ISBN : 978-2-87863-102-9
| Mis en ligne par | Lectivia |
|---|---|
| Dernière mise à jour | 11/10/2024 |
| Temps estimé de lecture | 3 minutes |
| Lecteur(s) | 5 |
Partager ce cours
Partager le lien
Partager sur les réseaux sociaux
Partager par email
Veuillez s'inscrire afin de partager ce Yabécédaire par email.

46. Moi je sais, puisque je suis institutrice
Monsieur et madame ont passé la journée chez leurs enfants à Le-Tang-Salé-les-Bains. En attendant le dîner, toute la famille se retrouve sur la plage à quelques pas de la maison pour admirer le soleil couchant. Marie-Paule, qui ne supporte pas de perdre son temps, a apporté ses aiguilles à tricoter et le cache-cœur qu’elle doit terminer avant l’anniversaire de son amie et collègue. Du haut de sa chaise de plage, et de sa voix d’amontreuse du haut de son pupitre, elle écrase l’auditoire de toute sa supériorité de maîtresse d’école ; elle relate par le menu les aventures de tous les personnages de tous les feuilletons-télé qu’elle a gobés goulûment durant la semaine. Heureusement que les autres s’en moquent parce que même le scénariste ne reconnaîtrait pas sa création si c’est Marie-Paule qui raconte.
Quand, il y a de cela bien longtemps, elle est parvenue à devenir institutrice, elle s’est sentie instantanément auréolée de tout le savoir du monde, nimbée de science infuse et le front ceint de palmes académiques, encouragée en ce sens par sa mère qui répétait à l’envi que si on ne savait pas, il fallait s’adresser à Marie-Paule, quel que soit le sujet, même en chinois, elle vous donnera la bonne réponse, puisqu’elle est essitutrice. Elle s’est alors empressée de s’entourer de tous les attributs de sa profession : un air condescendant, un mari non-fonctionnaire, une baguette de bambou, une règle en fer, une Peugeot 403 et une sœur quasi-analphabète pour s’occuper du ménage et des enfants à venir.
Chez ses collègues masculins, à part l’auto et la maîtresse (pas celle d’école), le plus gros de la panoplie se devait d’être en or : lunettes, stylo, montre, gourmette, épingle de cravate et au moins une dent, au besoin en se faisant arracher une canine saine. On pouvait se passer du jaseran, qui ne se voit que dans des circonstances particulières.
Revenons sur la plage, où ce soir-là donc, le soleil fait aux gens normaux l’ineffable cadeau de toute sa magnificence et Marie-Paule râle parce qu’elle ne distingue plus sa rangée, bécalu !
Bécalu est avec tabouret, le juron le plus soft de la langue créole.
Son mari, qui n’est pas instituteur, profite d’une accalmie dans la logorrhée conjugale pour faire part, avec une émotion à peine contenue, de son émerveillement et de son humilité devant ce spectacle féerique, toujours renouvelé et pourtant jamais semblable, qui depuis l’aube de l’humanité, jette comme un voile somptueux devant l’éternité, et puis cet insondable mystère…
Marie-Paule, en épouse raisonnable, le stoppe net dans ses élucubrations :
Ah vouzote,
ça d’là y fait des vers,
en plein air,
dans la touffe galabert…
Dans sa poésie-moucatage, elle cherche en vain d’autres rimes en air.
Se taire, peut-être ?
- Fin du chapitre -

Tous les contenus du site internet de Lectivia sont protégés par la loi sur les droits d'auteur. L'utilisation, le partage ou la reproduction de toute partie du contenu sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur ou des ayants droits ou de Lectivia sera punis par la loi en vertu des règlements sur la violation du droits d'auteur et la propriété intellectuelle.

On se traite de con,
à peine qu’on se traite.
Claude Nougaro
Oté couillon !
Celui à qui on s’adresse en ces termes n’est pas forcément un imbécile, ni quelqu’un à qui il manque quelques petites choses. Il s’agit ici simplement d’une sorte de ponctuation censée renforcer la narration, exactement comme le « con » toulousain.
Mais voilà une richesse, une de plus, de notre vocabulaire des Hauts qui est en train de disparaître à cause de la susceptibilité de certains interlocuteurs. On entendra rarement de nos jours :
— Té couillon, viens ‘oir ça qu’moin l’a trouvé, couillon. Hein angarde couillon : ain’ canette couillon !
Évidemment, Ti-Toine n’a pas pensé un seul instant qu’on ne s’adresse pas ainsi à son maître d’école, même s’il s’agit d’un remplaçant qu’on appelle ti-maître et qui a l’air si gentil. Il a eu tout le temps d’y réfléchir, à genoux, au coin de la salle de classe, après avoir tâté de la baguette-bambou. Et défense de s’asseoir sur les talons, ni de se retourner, ni de rire, ni de pleurer.
Lorsqu’un marmaille se blessait et, quêtant à la fois des soins et de la compassion, présentait à l’adulte son doigt sanguinolent, il avait droit à un regard neutre suivi de :
— Vous l’est pas assez couillon !
C’est seulement après que le blessé avait droit à un flot d’alcool à brûler sur son index, qu’on engarotait ensuite comme un baba-chiffon.
Le maître d’école, à part l’argument du bâton, n’a pas donné à Ti-Toine plus d’explication que ça sur le motif de sa punition, alors, devenu adulte, il a nourri une solide aversion envers les maîtres du primaire. Il n’est pas allé plus loin à l’école et si on insiste bien, il vous dira simplement que ce ti-maître là l’a peuse couillon à terre pou prendre la place.
- Fin du chapitre -

Tous les contenus du site internet de Lectivia sont protégés par la loi sur les droits d'auteur. L'utilisation, le partage ou la reproduction de toute partie du contenu sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur ou des ayants droits ou de Lectivia sera punis par la loi en vertu des règlements sur la violation du droits d'auteur et la propriété intellectuelle.

Méfie-toi d’un jeune médecin et d’un vieux coiffeur.
Benjamin Franklin
Bien sûr tout le monde chez nous allait au coiffeur, car jamais personne ne disait aller chez lui. Le cheveu long n’était pas bien vu chez les garçons et les mamans vous expédiaient vite fait chez Philaumar dès que votre oreille n’était plus entièrement visible, et de toute façon elle vous y envoyait quelques jours avant la rentrée, comme si cette dernière punition, à elle seule, ne suffisait pas.
La clientèle de notre coiffeur a sensiblement diminué pendant ces années où les jeunes gens imitaient leurs idoles en harnachant leur tête d’une boursouflure capillaire laquée, tandis que leur taille se cintrait, que les pattes de leurs pantalons s’éléphantaient et que les pattes de leurs rouflaquettes s’allongeaient.
Monsieur Philaumar, ne s’étant pas reconverti, n’a pas pu suivre la tendance, lui qui avait toujours pratiqué une coupe maîtrisée au poil près qu’il se refusait à appeler coupe-au-bol, car il savait aussi coiffer avec d’autres ustensiles et il pouvait s’occuper également des cheveux féminins.
La petite échoppe de monsieur Philaumar était l’ancien magasin en bois sous tôle de madame Delphine, c’est là qu’il a exercé son métier une grande partie de sa vie, avant de changer d’adresse et de s’installer dans le garage en dur de matante Lise, un peu plus loin que la rue de la boutique ; sa clientèle et les descendants l’ont suivi jusqu’après ses quatre-vingts ans. Il travaillait la même coupe de cheveux, on ne change pas une recette qui marche, et gardait en toutes circonstances cette bonhomie qui faisait que son petit salon de coiffure ne désemplissait pas, malgré la saine concurrence de Dany installé cent mètres plus loin.
Autour de l’imposant fauteuil inclinable en bois et skaï, sa majesté monsieur Philaumar vaque comme dans son palais. Pli de pantalon impeccable sur souliers cirés, tours-de-bras métalliques pour ses manches de chemise, il aiguise son coupe-chou sur une lanière de cuir accrochée à la cloison ; il a ses lunettes en or sur le bout du nez et regarde alternativement dedans et par-dessus, tandis que son corps entier, pied droit en avant, suit le mouvement du bras d’avant en arrière. Ses outils de travail, multipliés par deux dans le grand miroir, sont alignés sur la commode en attendant le bon vouloir et le savoir-faire du maître.
Il secoue d’un clac la grande serviette blanche qui soulève un tourbillon de cheveux coupés sur le plancher disjoint, la passe autour du cou du jeune homme agrippé aux poignées, et la croise derrière son dos. Le spèce bavoir en caroutchou par-dessus. La coupe peut commencer.
Début des opérations : la grosse tondeuse qu’il fait claquer trois fois à vide, il pousse d’une main douce et ferme la tête du coiffable (coupable ?) qui courbe aussitôt la nuque comme un orant. Ce qu’il semble craindre se produit : la tondeuse monte en cliquetant jusqu’au sommet de son crâne et dégarnit un large espace, comme la trace laissée par une journée de coupe dans un caro de cannes. Le jeune homme se résigne : la rentrée c’est dans quinze jours, les dégâts seront moins visibles et les moucatages moins lourds. Tandis qu’il achève de débroussailler l’occiput, monsieur Philaumar chantonne Mexico, Mexiiiico, comme pour donner du courage à sa victime.
Monsieur Armand vient d’entrer et, avant même de s’asseoir, commence à vitupérer politique : toutes l’est pourris, n’a point ain’ pou rachète l’autre ; notre coiffeur adhère entièrement à ses opinions qu’il exprime par des : Mais voui, bien sûr, ah bah ! qu’il a servis le matin même à un client qui soutenait l’opinion contraire.
Les ciseaux entrent en action, puis le rasoir pour une bordure bien nette autour des oreilles et sur la nuque. Époussetage au blaireau, vaporisation à tout-va d’une eau de Cologne qui distillera ses effluves pendant une bonne semaine, et Figaro tient fièrement un miroir derrière ma tête pour que je voie à quel point il a scrupuleusement respecté mon souhait d’une coupe à la Marlon Brando. J’acquiesce tristement en me disant qu’avec une tête pareille, l’acteur se fermerait à coup sûr l’accès aux studios hollywoodiens. Ou alors ce ne serait pas Un tramway nommé désir mais Une charrette nommée délire.
Y fait dix francs.
Soir de rentrée à l’internat du lycée de Saint-Urbain. J’ai bien fait d’avancer de quinze jours le rendez-vous coiffure ; mes cheveux ont eu le temps de repousser et ma coupe n’attire pas l’attention des copains-moucateurs ; je peux me croire à l’abri jusqu’aux prochaines vacances.
Outre l’interdiction de marcher en savates-doigts-de-pied, de porter des jeans délavés (la limite de délavage étant laissée à l’appréciation du pion), de faire le mur, de lire des bandes dessinées ou des revues pornographiques, de fumer, de répondre aux membres du corps enseignant et de soutenir leur regard, de se battre, de parler ou dormir en classe, de faire des graffitis avec les marqueurs qu’on a sous la main dans les cabinets aux demi portes et chasse d’eau automatique, d’avoir des mauvaises notes sous peine de six heures de colle un dimanche entier, le règlement du lycée interdisait expressément le cheveu long. La tolérance allait jusqu’à environ vingt-deux millimètres, pas plus, et sur le haut du crâne seulement. Surveillants, surveillants généraux, censeur et proviseur veillaient au respect de cette loi fondamentale et déterminante pour l’avenir de la belle jeunesse de chez nous.
Deux semaines à peine avant les vacances de Noël, nous étions en classe de latin, tranquilles, à nous amuser comme des fous sur une version de Cicéron, face à notre prof rigolo comme tout, lorsque notre appariteur qu’on surnommait Gary, à cause d’une très vague mais flatteuse ressemblance avec Cooper, a annoncé l’entrée de monsieur le proviseur qui venait nous livrer les noms des lauréats des compositions du premier trimestre. Il les a félicités, malgré leur tête de premiers de la classe, avec l’assentiment de l’enseignant qui s’est fendu d’un rictus, puis a regardé dans ma direction, et comme j’étais avant-dernier ex-æquo, je me suis douté qu’il n’allait pas me parler latin.
— Qu’est-ce que c’est que cette chevelure absalonienne ?
C’était presque du latin.
Absalon, fils de David, devait avoir une sacrée crinière et être fichtrement maladroit (après mon prof de français, plus personne n’a dit fichtrement) pour se prendre les cheveux dans les branches ; les miens ne mesuraient pas plus de vingt-trois millimètres, mais cela n’avait pas échappé à l’œil avisé du débonnaire chef d’établissement. Un réflexe idiot m’a fait me gratter la tête, tandis que la classe entière se retournait pour me dévisager. Je tentais désespérément d’être moins rouge et d’avoir l’air décontracté, et j’ai reçu l’ordre de passer chez le coiffeur dès le lendemain jeudi, lors de la sortie surveillée de l’après-midi.
Mon argent de poche ayant fondu en grande partie dans le flipper, le coca et un ami emprunteur-non-rendeur, il me restait juste de quoi offrir ma tête au coiffeur Crépin. Il sévissait à un coin de rue du lycée et, pour un prix aussi ridicule, sa technique rudimentaire rendait son art reconnaissable entre tous.
« Crépin, coiffeur parisien,
Crépin, coiffeur de demain. »
C’est ce que d’habitude, on chantait en ronde autour du massacré. Les plus gentils de mes copains se sont contentés de sourire en me voyant, tandis que Guito affirmait, pince-sans-rire, que là, vraiment, Crépin s’était surpassé et que je serais gentil de lui prêter ma tête pour faire rire son petit frère.
Je décidais de rentrer à ma case de Pont-Les-Hauts, avant la date officielle des vacances, afin de confier au génial, à l’incomparable, à l’unique monsieur Philaumar le soin de réparer les dégâts occasionnés sur mon coco-de-tête par son confrère de la ville, de niveler les chemins de rats et de retrouver ainsi une sorte de normalité capillaire sur l’air de Mexiiico.
- Fin du chapitre -

Tous les contenus du site internet de Lectivia sont protégés par la loi sur les droits d'auteur. L'utilisation, le partage ou la reproduction de toute partie du contenu sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur ou des ayants droits ou de Lectivia sera punis par la loi en vertu des règlements sur la violation du droits d'auteur et la propriété intellectuelle.

À l’arrière des Dauphines.
Alain Bashung
La petite Renault blanche s’engage dans une impasse sablonneuse et s’arrête en lisière de forêt, à l’ombre d’un pied de tamarin. L’endroit est désert et difficilement accessible en voiture ; il faut la laisser filer en première, sans à-coups, sans accélération, sinon c’est l’ensablement.
Je me penche vers ma jolie passagère brune (oui, nous sommes à l’avant) qui ne semble pas effarouchée, mais proteste un peu et se fait prier parce que c’est comme ça, toutes les mamans l’ont fait avant elle. Le dossier s’incline lentement et nos lèvres s’unissent comme dans les plus beaux romans-photos. Malgré les vitres baissées, il fait un peu chaud et nos vêtements de plage nous semblent superflus. Ils tombent l’un après l’autre et nous nous laissons gagner par une délicieuse frénésie.
Si vous croyez pour vraiment que tout peut se passer de manière aussi idéale, alors je vous mets au défi de prendre une Dauphine et une brune, et d’aller embrasser l’autre dans l’une, où vous voudrez. Pour abaisser le dossier, il faut tourner une grosse molette à droite du siège, ce qui vous oblige à vous tenir sur le quart de la fesse droite, un genou par-dessus le levier de vitesse. La molette fait trois tours dans le vide, tandis que vous approchez vos lèvres ; à ce moment-là, le dossier bascule de trois bons crans et toutes vos dents s’entrechoquent, les vôtres et celles de la brune.
Prenez une blonde si vous préférez, mais alors plutôt dans une Simca P-soixante : le levier de vitesse se trouve sous le guidon.
Enfin vous vous stabilisez et tentez de vous débarrasser de votre chemise collante (je vous rappelle qu’il fait chaud), tout en faisant ce qu’il faut pour que le désir ne faiblisse pas. Les étreintes lascives se transforment en contorsions ridicules et vous vous dites qu’avec la chemise, ça ira aussi bien. Vous venez de dénuder les épaules de votre blonde et vos genoux vous font mal, même si c’est la posture que vous jugez la plus adaptée et vous n’avez pas le choix.
J’en suis là, avec ma brune, quand nous ressentons comme un tremblement de terre qui fait tanguer, puis rouler notre Dauphine. Le septième ciel nous semble bien orageux. Les mouvements s’amplifient ; nous nous redressons. Une bande de marmailles hilares, moyenne d’âge douze ans, lâche les pare-chocs et surgit tout autour de nous comme des petits diables à ressort. Ils restent deux secondes devant toutes les vitres avant de s’égailler dans les bois avec des grands cris de victoire.
Ma brune n’a pas tout perdu : elle a beaucoup ri, et loin de la Dauphine, ça a été partie remise.
Parmi tous les ti-couillons à l’origine du tremblement de terre, il y en a un que j’ai parfaitement reconnu : c’était moi, dix ans plus tôt.
- Fin du chapitre -

Tous les contenus du site internet de Lectivia sont protégés par la loi sur les droits d'auteur. L'utilisation, le partage ou la reproduction de toute partie du contenu sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur ou des ayants droits ou de Lectivia sera punis par la loi en vertu des règlements sur la violation du droits d'auteur et la propriété intellectuelle.

La douceur du miel ne console pas de la piqûre de l’abeille.
La grande Pierrette qui, à dix-huit ans, s’apprête à passer son brevet élémentaire, a le visage un peu boutonneux et les pommettes roses des filles de gendarmes de France, que le hasard des mutations a exilés en yaberie.
Elle a fini par accepter les avances maladroites de Jean-Marie, le journalier gratteur de pioche qui, un jeudi, l’a invitée à se promener avec lui dans les sentiers de Coteau-Bouc où il vit chez ses parents. Maladroit, parce qu’il lui a gentiment dit qu’elle serait sa petite chèvre à lui. Il ne peut pas savoir que ce n’est pas un compliment, car il est bête. Pierrette, en bonne fille, ne s’est pas arrêtée à si peu, surtout qu’elle est en proie, depuis quelque temps, à d’étranges et irrépressibles fourmillements dont il lui faut trouver la cause en se promettant d’y apporter un remède.
Le complot a été éventé, car Jean-Marie (ai-je dit qu’il était maladroit ?) n’a pas pu s’empêcher de parler à des amis sûrs de son rendez-vous prochain avec une fille de gendarme. On a même été au courant de l’heure, de l’itinéraire et du lieu du spectacle. C’était presque trop facile et ça risquait de se jouer à guichets fermés. Cependant, beaucoup ayant été réquisitionnés par leurs parents pour les corvées d’eau, de commissions et de bois-feu, nous, les quelques élus, avons promis de tout leur raconter après.
À partir du sentier où ils se sont rencontrés, ils ont marché main dans la main, un peu nerveux, sur le qui-vive, jetant des regards dans toutes les directions comme les suricates, mais visiblement pressés d’en venir au fait. L’air était chaud en ce mois de février et pas le plus léger souffle de vent. Ils se sont arrêtés dans un coin idyllique, avec vue sur le bas du village, à vingt mètres du sentier, sous un gros pied de jamblons.
Les guêpes aiment bien les pieds de jamblons. Celui-là semblait calé par un énorme rocher au pied duquel les aiguilles sèches des filaos formaient une couche très convenable pour la circonstance ; chocas et galaberts clôturaient le repaire des tourtereaux.
Les préliminaires sont à peine commencés qu’ils semblent finis. En effet, Robert, du bout d’un mât de choca, a ravagé le nid de guêpes du jamblon, alors que Jean-Marie était sur le point de s’occuper de celui de Pierrette. Les bestioles ont fondu sur le couple et tous les dards sont entrés en action, car Jean-Marie, en garçon honnête, tenait à terminer ce qu’il avait entamé. C’est quand même lui qui a accueilli le gros de la troupe, vu qu’il avait le dessus et servait de bouclier, mais il est resté stoïque et concentré.
Et puis Pierrette a poussé un grand cri, car figurez-vous qu’elle venait de se faire piquer.
L’expression créole, c’est : courir culotte dans la main. Il l’a suivie en tentant de se reboutonner, tandis qu’elle faisait des moulinets en criant : Y’a des abeilles ! (Bis)
On n’aurait jamais dû emmener ce couillon de Robert.
Ce petit drame a soudé le couple qui a légitimement convolé un an plus tard. À la fin des années cinquante, on pouvait entrer dans l’enseignement avec le brevet élémentaire ; Jean-Marie est donc devenu mari d’institutrice, et quand papa gendarme est rentré en Zoreillie, eux sont restés pour donner à notre village trois jolis petits yabeilles aux pommettes roses.
Aujourd’hui encore, j’ai honte d’avoir participé à un jeu aussi cruel, mais Bon Dieu y dort pas, car, à peine dix ans plus tard… du côté de la gare désaffectée de Le-Tang-Salé…

Quand j’allais géométrisant mon âme
au creux de ta blessure.
Léo Ferré
Nous sommes loin de la poésie flamboyante de Ferré et de celle de Brel qui aurait voulu encore remplir d’étoiles un corps qui tremble, mais c’est bien de cela qu’il s’agit, même si le mot n’est plus guère employé que par une poignée de rescapés du deuxième millénaire et, paraît-il, par nos amis cajuns de la lointaine Louisiane.
L’action, le plus souvent, se passait dans le caro de cannes, entre fourmis-qui-mord, feuilles coupantes et choses plus ou moins sèches, car les cabinets étaient rares, sans parler des voyeurs qui épiaient le couple, bien avant qu’ils ne fassent leur entrée sur scène, l’un côté cour, l’autre côté jardin, pour brouiller les pistes mais ça ne marchait pas toujours.
Nous les pré-ados, toujours désireux d’apprendre pendant les vacances, avions développé un réseau de débusqueurs, pisteurs et sentinelles qui nous garantissait un spectacle quasi-hebdomadaire de la bête à deux dos. Bon, c’était toujours le même, vu qu’il n’y a pas trente-six manières… Si, pour ceux qui font l’amour tout confort et protégés de partout, mais pas pour ceux qui ne sont pas vraiment à leur ouvrage, un œil sur un sein, l’autre entre les cannes à sucre, et l’oreille attentive au moindre craquement de feuille sèche. Dans ces conditions, c’est toujours un peu bâclé, parfois inachevé.
Heureusement, l’entrée était gratuite.
Avant de vous raconter la belle histoire de Pierrette, je voudrais vous rafraichir la mémoire à propos des expressions employées jadis pour envoyer paître quelqu’un :
— Allez pousse canard dans la montée Bel-Air !
— Allez peind’ la mer !
— Allez vend’ la fumée par pinte !
— Allez faire paît’ bœuf Bois-Rouge !
Et, bien sûr, pour rester dans le sujet :
— Allez faire coque puces derrière bazar !
- Fin du chapitre -

Tous les contenus du site internet de Lectivia sont protégés par la loi sur les droits d'auteur. L'utilisation, le partage ou la reproduction de toute partie du contenu sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur ou des ayants droits ou de Lectivia sera punis par la loi en vertu des règlements sur la violation du droits d'auteur et la propriété intellectuelle.

Il y a beaucoup d’invités au mariage de Sophie et Martial à Piton-Margoze : les parents, les amis, les parents des amis, les amis des amis, tous venant ou de Saint-Léon ou de Pont-Les-Hauts ou de Piton-Margoze même, mais personne de Saint-Julien, Hélène a bien insisté sur ce point ; condition sans concession à sa présence au mariage de sa sœur. Il lui reste comme un doute à propos de Jean-Guy.
Des fois que sa papangue y serait dans le tas !
Les mariés sont radieux comme le soleil, la réception a lieu par en bas d’le gros pied de jambalac, dans le séchoir à tabac du frère de mamère qu’on a décoré (le séchoir à tabac) d’un tonnage impressionnant de feuilles palmisse, d’arums, de plumosas, de sagou et de fougères qui dissipent un peu le parfum ambiant.
Jean-Guy est très à l’aise dans son nouveau costume gris-fusil acheté le mois précédent chez Babate, le Zarabe de la rue Gentils Marmailles. La vendeuse était si persuasive, qu’il s’est laissé tenter par des nouveaux souliers, un chapeau-feutre, une chemise blanche, une cravate verte et la pochette assortie, des chaussettes, un ceinturon. Il n’a pas tout acheté d’un coup, préférant revenir chaque semaine pour laisser mûrir sa réflexion, toujours quelques minutes avant la fermeture (n’a moins de monde), et n’hésitant pas à refaire le trajet pour échanger la paire de souliers qui lui mordaient les pieds.
À la grande table des convives, tout le monde ne se connaît pas forcément et on s’informe de qui est qui. Les mariés font ensemble le tour des invités pour cueillir les compliments et s’assurer que personne ne manque de rien.
Une jeune fille porte les verres dés à coudre sur un plateau, une autre la bouteille de maribrizar et la troisième la bassine d’eau. On sert la première tournée qui se boit cul sec, on plonge les verres dans la bassine et on les ressort, ruisselants, pour la tournée suivante, et quand il n’y a plus de liqueur dans la bouteille, le liquide de la bassine est tellement gras, qu’un invité déjà titubant ne verrait pas la différence.
— Oncore ain’ ti verre de liqueur ?
Les mariés avisent, assise à la table voisine de Jean-Guy et Hélène, une coquette quasi quadragénaire qu’aucun d’eux ne connaît. Se souciant peu de l’allitération, ils s’informent :
— Par l’faite, vous c’est qui ?
Josiane a un beau sourire-rouge-fardé et se présente comme la nièce de la marraine du témoin, du côté de la jambe gauche.
— Où ça vi resse ?
Elle est venue, dit-elle, habiter à Saint-Léon il y a quelques mois, parce que dans sa ville de Saint-Julien il n’y avait plus de travail, et qu’elle en a trouvé un comme vendeuse chez Babate, le Zarabe de la rue Gentils Marmailles.
- Fin du chapitre -

Tous les contenus du site internet de Lectivia sont protégés par la loi sur les droits d'auteur. L'utilisation, le partage ou la reproduction de toute partie du contenu sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur ou des ayants droits ou de Lectivia sera punis par la loi en vertu des règlements sur la violation du droits d'auteur et la propriété intellectuelle.

Pensez deux fois avant de parler
et vous parlerez deux fois mieux.
Plutarque
En allant voir son grand camarade Jean-Guy à Saint-Léon, Martial ne s’attend pas à ce que sa visite l’entraîne si loin, et qu’en même temps elle soit si courte, plus courte que le voyage en car courant d’air qui l’a mené à la ville, jusqu’à derrière bazar. De là, il a remonté à pied la rue Bordier où l’eau des caniveaux, comme un tout-à-l’égout, charrie jusqu’à la mer ce que les riverains et les passants y déversent, sans penser à l’écologie, puisqu’elle n’existe pas encore.
— Point personne ?
C’est Hélène qui vient l’accueillir au baro avec les gentillesses d’usage.
— Vous l’est rare comme les beaux jours, rente à vous, mi connais ain’ qui sera content, depuis le temps que zot l’a pas vu ! Et sans ça, chez vous, ça va ?
— Mafi, vi connais, quand l’est pas les deux bout’, c’est l’milieu mais na toujours ain’ affaire qui déroge.
Jean-Guy arrive en s’essuyant les mains sur son pantalon kaki, il sourit large et tape chaleureusement sur l’épaule de son ami.
— Aaah ben y fait pleusir ! Y fait au moins trois mois…
— Ben non, rectifie Martial spontanément, le mois dernier moin l’a vu à vous à Saint-Julien et…
Hélène vient de couper sa phrase, comme on coupe collet cabri du côté de Saint-Bénédict :
— Vous l’a vu Jean-Guy à Saint-Julien ? Le mois passé ?
Martial est tellement décontenancé qu’il n’est presque plus là. Hélène entame alors un long, très long interrogatoire pendant lequel ses yeux-fusil ont dans leur mire tour à tour un mari liquéfié et son ami flageolant. Elle revient en boucle sur les mêmes questions de temps et de lieu, de quiqui, de à cause, n’attend pas les réponses qui ne viennent d’ailleurs pas, prend à témoin sa sœur Sophie qui jubile intérieurement, car ce Jean-Guy, elle ne l’a jamais vraiment bien senti, et c’est peu dire.
— Hein, Sophie, Jean-Guy l’a dit à vous que lu partait à Saint-Julien le mois passé ? Jean-Guy l’a pas dit à moin que lu partait à Saint-Julien le mois passé ! Quoi lu n’avait pou faire à Saint-Julien le mois passé ?
L’émotion chez certaines épouses des Hauts engendre répétitions, balbutiements et redondances.
Devant le tour que prennent les événements et un Jean-Guy au supplice, Martial tente une parade désespérée pour rattraper le coup et innocenter son ami rouge qui ne réussit toujours pas à en placer une. Il se tourne résolument vers Sophie et s’adresse à elle en l’appelant Hélène :
— Hélène, acoute à moin, ça s’peut ce coup-là, moin l’a pas bien vu, Hélène.
Il prétend avoir perdu ses lunettes, sans lesquelles il ne voit pas très bien de loin, alorsse, celui qu’il a pris pour Jean-Guy ce jour-là, c’était sûrement ain’ aut’ boug. Ses explications sont ponctuées d’un tas d’Hélène, tandis qu’il continue à fixer Sophie, qui fait non-non de la main et lui indique, en retrait à droite, la bonne interlocutrice.
Martial quart-de-tourne en plissant un peu les yeux, il ressemble à un tang sorti de terre, et l’attitude d’Hélène lui montre que la partie est presque gagnée ; la voilà plus détendue, soulagée, et même ain’ ti peu narquoise.
Attention à ne pas trop en faire, c’est là que tout se joue. Du doigté, de la mesure !
— Ben y faut vraiment vi rode ain’ aut’ lunette pou vous, dit Hélène sur le mode semi-moucatage, mi comprends à c’t’heure pouquoué vi voit Jean-Guy portout.
Martial s’excuse de sa méprise, non, vraiment, c’est impardonnable ; d’ailleurs, pas plus tard que tout de suite, il ira chez le Chinois de la rue Gentils Marmailles pour choisir une bonne lunette dans la boite souliers.
Pour s’acheter des lunettes, dans les années cinquante, tout le monde ne suivait pas forcément le parcours généraliste-ophtalmo-opticien qui était encore en friche. Il suffisait de piocher dans un tas de verres et de montures usagés que le commerçant récupérait on ne sait où ni comment.
Il se murmure quand même que les morts n’ont plus besoin de voir clair et que l’approvisionnement viendrait de ce constat, mais je ne ferai aucun pariage là-dessus.
— Mi disais aussi, reprend Hélène, de plus en plus rassurée, d’abord ain’, jamais Jean-Guy y sort sans dire à moin où lu sava, et pu surtout, comment y peut confonde à moin avec Sophie ? Y faut pas voir clair pou tout de bon !
Elle fait allusion à la différence de taille, de corpulence, à la couleur des cheveux et à celles des vêtements qu’elles portent.
— L’est vrai vraiment, répond Martial, n’a point pou comparaitre, vous l’est plusse mieux qu’elle.
La voilà, mon brave Martial, la réflexion de trop !
— Ah bon ? glapit Sophie, avec dans ses yeux des éclairs meurtriers.
Deux camuseries dans la même journée, avant neuf heures du matin, il y a de quoi déstabiliser le plus coriace des yabs qui bafouille, avant de bredouiller et de s’emberlificoter, pire que dans la colle jacques ; et au plus il esplique sa conception du beau, du bien, du mieux, du goût des uns, de la proférence des autres, c’est selon, au plus que sa voix faiblit et qu’il se rapproche du baro qu’il détaque en expliquant que là, pou vraiment, il faut qu’il baise chemin.
— Allez, arvoir tout le monde, moin l’étais bien aise et monte ain’ peu dans la fraiche ain’ ces jours, nous l’a pas chanze place et bonne santé, allez…
Martial redescend à la même vitesse que l’eau du caniveau qui glougloute tandis qu’il margongne des ‘toche ta nénène couillon ! s’adressant à lui-même qui s’est fourré tout seul son arrière-train dans un sac de jute.
Autrement dit : son cul dans ain’ gouni.
Piton-Margoze, le 12 avril 1959
Cher Martial,
C’est aujourd’hui dimanche que je prends ma plume pour te donner de mes nouvelles qui sont bonnes en ce moment et j’espère que chez toi soit de même.
Cher Martial, depuis que tu as venu nous voir le mois passé à Saint-Léon, je sais que c’est moi que tu as venu voir, mais que tu n’as pas osé parle avec moi, à cause de ma sœur et mon beau-frère cocol. Depuis ça, je te pense jour comme nuite et j’espère que tu as pour moi des sentiments pareils. Tu m’angardais si tellement fort quand que tu parlais de voir pas clair, alorsse j’ai compris que tu faisais semblant de pas voir clair pour sauver l’autre doudoule qui mérite pas ton amitié, tandisse que moi, si tu voudrais faire un morceau de vie ensemb moi, je dirai pas non, je dirai voui.
Ne me pousse pas, cher Martial, donne-moi des nouvelles ou viens me voir pour faire plus connaissance. Aujourd’hui je suis à Piton-Margoze, chez mamère, avec Hélène, qui a demandé à la voisine de veiller si l’autre sosso y vole pas chemin.
Je te prie d’accepter, mon cher Martial, mes sentiments les plus distingués.
Sophie qui t’aspère
Saint-Léon, le 12 avril 1959
Mon cher Martial,
C’est aujourd’hui que je prends ma plume pour te donner de mes nouvelles qui sont bonnes en ce moment, et j’espère que chez toi soit de même.
Mon cher Martial, j’emprofite que Hélène avec sa sœur ont parti chez la moman jordu pour te dire merci de m’avoir sauvé l’aut’ coup. J’ai pas gagné de faire avant, à cause que depuis ça, elle me veille comme lait su’ l’feu, et que même pour pisser il faut que je demande, y fait que pour Saint-Julien, je peux faire une croix dessus. Elle me laisse jusse aller à pied en ville, et oncore, elle crache à terre quand je pars et il faut pas que ça chesse quand je reviens. En plus que ça, elle a mis comme gardien la vieille toquée en face, et je peux compter aussi sur ma belle-sœur pour peuser ma tête dans la baille, alorsse tu vois que ma vie n’est pas rose, mais j’ai confiance que le miracle y peut arriver, par exemple, le car y chavire dans le rempart en sortant de Piton-Margoze.
Oncore merci, mon cher Martial, et à bientôt siplétadieu.
Jean-Guy
Piton-Margoze, le 12 avril 1959
Bien cher Martial,
C’est aujourd’hui que je prends ma plume pour te donner de mes nouvelles qui sont bonnes en ce moment et j’espère que chez toi soit de même.
Bien cher Martial, je t’écris en cachiette depuis Piton-Margoze où je suis chez mamère pour la journée avec Sophie.
J’ai compris que tu as des sentiments pour moi depuis le jour quand tu as venu à la case, c’est normal mais je suis une femme fidèle quand je peux, et j’aime mon mari, même si je dois le veiller toultan. Mais ma sœur Sophie a déjà coiffé Sainte-Catherine depuis un bout de temps, et toi-même tu es vieux garçon, même si tu es joli garçon, alorsse j’ai pensé comme ça que vous ferez un joli couple ensemble ma tite sœur, mais ne dis pas que c’est moi qui a dit.
Je te quitte en te disant à bientôt, cher Martial, en espérant que nous serons famille un de ces jours prochains.
Hélène
- Fin du chapitre -

Tous les contenus du site internet de Lectivia sont protégés par la loi sur les droits d'auteur. L'utilisation, le partage ou la reproduction de toute partie du contenu sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur ou des ayants droits ou de Lectivia sera punis par la loi en vertu des règlements sur la violation du droits d'auteur et la propriété intellectuelle.

C’est une question d’équilibre.
Francis Cabrel
Ceux qui connaissent le village de Le-Tang-Salé ont donc déjà bu la tasse au Banc, lieu de baignade un peu moins tranquille que le Bassin Pirogue, à quelques brasses de là, de l’autre côté de la pointe sableuse.
C’est quand la mer est agitée que la baignade au Banc prend tout son intérêt. Sur ces dalles de corail alignées à quelques mètres du rivage, larges et légèrement inclinées vers la haute mer, une bande d’écervelés jouent à qui résistera aux vagues qui viennent se briser, puis déploient leurs rouleaux jusqu’au sable noir de la plage pour revenir en ressac au pied des inconscients.
Le jeu, lorsqu’on s’est fait faucher par une déferlante, consiste à se laisser porter le plus loin possible sur le sable, mais le véritable exploit est de tout mettre en œuvre pour ne pas tomber du Banc, ni dans le Banc : il y a des grands trous dedans, et dans les trous, un monde fabuleux d’oursins toutes aiguilles dressées.
Ce garçon ne faisait pas partie de notre groupe, mais ce jour-là nous étions debout côte à côte comme autant de manchots sur leur glaçon, bien décidés à remporter la palme de l’inconscience.
Il a d’abord glissé et nous l’avons tous observé tournoyer vers le fond pour chatouiller les oursins. Il a tenté de refaire surface, mais il était à peine d’aplomb qu’une vague l’a renvoyé d’où il venait. Ceux qui n’ont pas été éjectés ont pu admirer l’élasticité de son corps qui se pliait aux aléas des remous. Il a repris pied truffé d’épines noires, mais n’a pas vu venir le ressac et s’en est retourné saluer ses bourreaux. La troisième tentative a été la bonne : il a pu garder la station debout environ cinq secondes, le temps de nous avouer d’une voix blanche, derrière tous ses piquants :
— L’est en couillon dans c’trou-là, oui !
On l’a cru sur parole.
Ça, c’était de la camuserie pitaclée.
On n’avait jamais vu autant d’oursins brisés dans un même trou.
Alors une grosse vague compatissante a ramené le garçon sur la plage. Il l’a remontée en boitant et, à dater de ce jour, nous ne l’avons plus vu qu’au Bassin Pirogue en sandalettes-plastique et assez loin des vaguelettes.
- Fin du chapitre -

Tous les contenus du site internet de Lectivia sont protégés par la loi sur les droits d'auteur. L'utilisation, le partage ou la reproduction de toute partie du contenu sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur ou des ayants droits ou de Lectivia sera punis par la loi en vertu des règlements sur la violation du droits d'auteur et la propriété intellectuelle.

Il paraît que c’est trop risqué pour le cœur d’être à la fois coureur cycliste et coureur de jupons. J’abandonne le vélo.
Sami Ghaddar
Par un beau jour des vacances de janvier, notre groupe de jeunes, c’est-à-dire tous les garçons et les filles de mon âge, décidons de nous aérer un peu du local exigu mais douillet où nous nous retrouvons chaque jour, pour vivre pleinement notre jeunesse et nous préparer un avenir fabuleux à l’écart de ces adultes qui n’y connaissent rien.
À vrai dire, les parents nous avaient un peu virés, vu qu’ils ne savaient pas trop ce qui se tramait derrière la porte fermée où se tramaient des baisers maladroits. Quelqu’un a dit que nous ne faisions rien de mal et le regard de ma mère lui a bien fait comprendre qu’il ne fallait pas trop la prendre pour une imbécile.
Allez, allez ! Chape à zot’ !
Dès le début de notre promenade dans les rues de Pont-Les-Hauts, chacun a remarqué le manège d’un jeune homme sur sa bicyclette rutilante (nous disons vélo, tandis que maman dit encore bicyclette). Il s’appelle Jean-Paul, mais pour l’anonymat, nous l’appellerons Bernard. Il ne fait pas partie du groupe mais rêve d’y entrer pour les beaux yeux (et tout ce qu’il y a autour) de Juliette que nous appellerons Marie pour l’anonymat et qui, elle, est de toutes nos sorties et de nos surprises-parties.
Ce jour-là, donc, Bernard-Jean-Paul, pantalon blanc, baskets neuves, chemise à carreaux manches courtes retroussées sur des sortes de biceps, le cheveu à peine gominé et lissé par une brosse ronde qu’il planque dans sa poche-à-cul, fait des va-et-vient incessants afin de croiser notre groupe, et surtout accrocher le regard admiratif de l’élue.
Nous entamons la côte vers Bras-Jonc quand il surgit à cent mètres devant nous en faisant des slaloms parce que jusque-là, Marie-Juliette ne lui a pas accordé plus d’attention que ça. Alors peut-être les slaloms ? Il joue frénétiquement de la sonnette et lâche le guidon pour montrer qu’il est capable de lâcher le guidon. Il aurait fait forte impression s’il n’y avait pas eu les gravillons que les services municipaux avaient semés la veille. Voilà la roue arrière qui veut jouer la roue avant et la monture qui se couche et le cavalier qui s’accroche à une des deux poignées et tous deux qui dansent, enlacés, une étrange chorégraphie au ras du sol et qui se désolidarisent pour laisser filer Bernard-Jean-Paul qui, ventre à terre, nous croise en crissant et dont les yeux rencontrent enfin les yeux de l’aimée.
Instant trop bref pour exprimer quoi que ce soit d’autre que la douleur du présent et l’angoisse de l’avenir immédiat.
Tandis qu’après deux loopings, le vélo plié finit seul sa course dans les zétivers de madame Jules, le soupirant finit la sienne au bas de la pente qu’il s’évertue à remonter héroïquement en récupérant au passage ce qu’il a semé dans la descente : sa brosse ronde et la tite glace en éclats, son bracelet d’identité, une basket, quelques cigarettes Pink encore entières, de la menue monnaie. Il renonce aux allumettes et arrive ainsi à notre hauteur, se recoiffe, rentre sa chemise déchirée dans son pantalon lacéré, et tout en enfilant sa basket décapotée :
— L’était moins cinq, hein !
Ça, c’est de la camuserie pluchée.
Car enfin, moins cinq avant quoi ? Il est graffiné de partout. Ayant frôlé le pire, il aurait pu dire moins une, ou ne rien dire du tout et se contenter d’être livide.
Cet endroit décidément ne lui portait pas chance. Peu de temps auparavant, alors qu’il descendait la même pente à vive allure, il avait dû freiner à mort et zigzaguer pour ne pas emboutir, dans le tournant, les derniers marcheurs d’un cortège funèbre qui s’étaient écartés in extremis pour lui faire comme une haie d’honneur jusque derrière la couronne de fleurs du corbillard où il s’était enfin arrêté sous le regard froid des processionnaires. Ses savates doigts-de-pieds, qui avaient servi de freins de secours sur les derniers mètres, s’étaient cassées en deux.
Alors, soit pour tirer sa camuserie, soit pour remercier le ciel, il a fait, blanc comme le lys de la couronne, un grand signe de la croix, puis a laissé s’éloigner le cortège avant d’opérer un demi-tour pour aller changer ses patins de freins ainsi que ses savates et brûler une bougie.
Bernard-Jean-Paul (qui s’appelle Serge en réalité) fait désormais partie du groupe et une semaine avant la rentrée, quand la dernière croûte du dernier boubou est tombée, il a pu sans boiter, danser sur Mahaa viiiiie d’Alain Barrière avec Marie-Juliette (qui pour vraiment s’appelle Mathilde). Ils ont fait ensemble quelques pas sur le chemin des vacances, se sont un peu écrit à la rentrée (FPMB au dos de l’enveloppe, c’est-à-dire fermé par mille baisers), puis ont abandonné chacun le flirt pour l’amour, mais séparément.
C’est la vie.
- Fin du chapitre -

Tous les contenus du site internet de Lectivia sont protégés par la loi sur les droits d'auteur. L'utilisation, le partage ou la reproduction de toute partie du contenu sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur ou des ayants droits ou de Lectivia sera punis par la loi en vertu des règlements sur la violation du droits d'auteur et la propriété intellectuelle.

La vie, comme un roman, doit être une aventure
et les aventures, ce sont les vacances de la vie.
Joël Dicker
Les mond’longtemps ne se contentaient pas de partir en vacances, ils changeaient d’air et sans aller bien loin, car chaque ville de la côte avait ses Hauts et leur fraîcheur en été. En hiver, le choix des bords de mer se limitait aux plages de Saint-Loulou et de Le-Tang-Salé, de pittoresques villages de pêcheurs dont la population explosait avec les vacanciers.
Nous, on allait à Timimile en janvier et à Le-Tang-Salé-Les-Bains en juillet-août, car mon père était enseignant et multimilliardaire, ce qui n’était pas incompatible d’après la rumeur persistante qui courait à Pont-Les-Hauts depuis les années cinquante et poursuit encore la descendance du fonctionnaire jusqu’à ce jour.
L’expédition vers Timimile se prépare des semaines à l’avance ; depuis le village, on n’y accède que par des sentiers, après plus de dix heures de marche au rythme des enfants, des vieux, des porteurs de chaise, des bœufs-panneaux, c’est-à-dire bâtés, qui acheminent vivres et vêtements. Il faut bien que l’intendance suive pour nourrir et habiller pendant un mois une bonne douzaine de personnes, parmi lesquelles neuf enfants d’un à onze ans, dont quelques-uns énurétiques.
On nous réveille vers minuit et l’excitation du départ est telle que personne ne râle. Chacun-chacune s’active à la lueur des bougies ou du fanal, afin que la colonne se mette en route pour marcher le moins longtemps possible sous le soleil de janvier. La première halte se fait au plateau de Jolie-Vue d’où on aperçoit quelques rares lumières du Pompon et de Saint-Léon. Ma mère en profite pour nous compter, même si tous les cent mètres elle s’assure que tout son petit monde est bien là, en passant en revue tous les prénoms sauf celui de la petite qu’elle porte dans ses bras.
— Aspère pas moin, crie Paulin en rebroussant chemin, m’a artrouve à zot par en l’air.
— Quoué l’arrivé, Paulin ?
— Moin l’a oubli d’embrasse Fifi.
Nous apprendrons plus tard que ce retour précipité, c’était plus un gros doute qu’une gentille attention pour Fifi, vu que Paulin n’est plus venu nous retrouver ni ce jour-là, ni le reste de notre séjour, et que les années suivantes, il s’est toujours arrangé pour avoir sa femme à portée de main dans le caro de géranium ou ailleurs.
Pause-pipi, deux disques d’ananas-soleil, un peu d’eau et la troupe repart pour deux heures de marche, une lampe électrique tous les quatre marcheurs jusqu’au plateau de Lagrimasse où on arrive aux premiers rayons du soleil. On éteint le phare, on souffle un peu et on prend des forces en mordant dans le macatia de la veille fourrée d’une côte de chocolat noir.
Le convoi s’étire à nouveau sur l’étroit sentier qui surplombe le Bras-Madeleine, puis serpente le long de la ravine cannes fourragères mettant les mollets à l’épreuve. Assise confortablement dans la chaise à porteurs, matante encourage les moins résistants à tenir bon : L’est pu trop loin, juste en l’air-là, derrière la tête cacia !
Depuis le départ, on a renoncé à attendre Julius qui a la charge, en plus de son bertelle charzé, de convoyer un bouc pour que les chèvres de là-haut se sentent un peu moins seules et perpétuent l’espèce. Mais Julius tire à-hue et le bouc tire à-dia, opère un demi-tour, freine des quatre sabots puis démarre en trombe vers un brin d’herbe qui semble plus vert, et le chevrier-marron n’en finit pas d’égrener, comme le bouc égrène ses crottes, des jurons que même l’écho n’ose pas répéter.
Il y a bien longtemps, sur le « plateau », propriétaires et colons cultivaient et distillaient le géranium dont l’essence se vendait si bien qu’elle pouvait faire vivre décemment quelques familles. Pas Byzance non plus. Autour des petites cases poussaient pommes de terre, choux, oignons, thym, poivrons, gros l’ail, artichauts, citrouilles-quarante-jours et citrouilles-cap et d’autres légumes qui agrémentaient la ration de riz ou de maïs, en plus des délicieux champignons de géranium qu’on pouvait cueillir chaque matin, et des fraises des bois qu’on dégustait au hasard des caros où nos jeux nous menaient.
Il y avait donc, dans les années cinquante, quelques familles qui vivaient et travaillaient à Timimile et ne descendaient à Pont-Les-Hauts que pour les grands événements ou pour leur approvisionnement. Le facteur y faisait sa tournée une fois par mois, sa sacoche en cuir en bandoulière, avec son costume kaki col officier, ses godillots et son parapluie Chamberlain.
En plus du plateau de Timimile, le préposé devait aussi porter le courrier aux habitants de Grand-Bac, l’îlet du fond du Bras-Madeleine qui ne dépendait pas encore de la commune du Pompon. Monsieur Aurélien profitait du passage du facteur pour trinquer un coup de plus à la santé de ce qu’on voulait, et pour qu’on lui lise son courrier, lui qui n’avait jamais mis même le gros doigt de pied dans une école.
Mais il avait l’œil et savait reconnaître la lettre comminatoire :
— C’est pou payer ça, non ?
— Ben !
— Donne ici !
Aurélien déchirait tranquillement le document officiel et le jetait dans le feu, sous les gros pois. Il n’embêtait jamais personne et c’était, à son avis, la moindre des choses que l’administration lui rende la pareille.
Ce jour-là, sur le sentier vers Timimile, Julius est encore aux prises avec son bouc fantasque qui vient de le faire capoter dans les fougères. Les jurons se transforment en menaces de mort par décapitation.
Notre petite troupe entame la dernière montée vers la case de nos vacances où nous arrivons vers onze heures, sous un grand ciel bleu. Le vin chaud réconforte les adultes, les marmailles se contentent d’un miel-citron et tout le monde se prépare pour ces trois semaines de dépaysement total. Comme le mot étirements nous est inconnu, nous avons les jambes raides pendant quelques jours, mais profitons pleinement de notre immense espace de jeux couvert d’une ravine à l’autre de géraniums, de bosquets d’acacias, d’alambics, de cases en tôle et bardeaux bordées d’œillets, d’hortensias, d’aubépines, que le brouillard gobe avidement certains après-midis.
Nous venons de terminer notre premier repas à Timimile : driz, cari pomme-terre, cari de cochon mangé à la main dans une feuille de chou, lorsque nous voyons arriver Julius, tout seul sans son bouc mais l’air apaisé, presque serein malgré la fatigue.
Pompon, le royal-bourbon de grand Joseph, se hisse sur ses pattes arrière et vient renifler le bertelle qui paraît plus lourd qu’au départ sur son dos. Julius souffle sur son vin chaud. Il en avale une bonne gorgée, pousse un aaah de satisfaction, soulève du pouce le bord de son chapeau-feutre gondolé et dit calmement en montrant le bas du sentier où gît le bouc dépecé :
— N’a oncore d’la viande en-bas-là-bas !
- Fin du chapitre -

Tous les contenus du site internet de Lectivia sont protégés par la loi sur les droits d'auteur. L'utilisation, le partage ou la reproduction de toute partie du contenu sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur ou des ayants droits ou de Lectivia sera punis par la loi en vertu des règlements sur la violation du droits d'auteur et la propriété intellectuelle.

Rien à voir avec la forme d’un nez, sauf peut-être si ça se rapproche de l’expression avoir un nez sur sa figure, qui signifie qu’on a sa dignité.
Le mot n’est plus guère employé que par les très anciens, lorsqu’en public ils ont commis un impair, une bourde, une bévue et que le rouge leur monte au front.
Moin l’a gaingne la honte ! Moin l’a resse camus !
À ce moment-là, pour se rattraper aux branches, pour minimiser et faire oublier l’incident, ils disent la première phrase qui leur vient à l’esprit et qui n’est pas forcément appropriée. Ce qui souvent renforce encore la camuserie, alors ils bégaient une autre phrase, et ainsi de suite, jusqu’à la fuite salvatrice, parce que ce serait trop long de rentrer sous terre.
Ça s’appelle tirer sa camuserie.
- Fin du chapitre -

Tous les contenus du site internet de Lectivia sont protégés par la loi sur les droits d'auteur. L'utilisation, le partage ou la reproduction de toute partie du contenu sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur ou des ayants droits ou de Lectivia sera punis par la loi en vertu des règlements sur la violation du droits d'auteur et la propriété intellectuelle.

Tous ces tournants-là l’a soule à moin ;
quand le car l’arrive en bas la Pointe,
moin l’étais fine casse la pompe trois-quatre fois.
Casser la pompe : l’expression est quasiment passée à la trappe, la plupart du temps, les gens préfèrent dire vomir.
Les mêmes mond’ qui parlent d’& s’attardent sur le rejet de pompe et semblent s’en gargariser. On en disserte à table en n’oubliant pas le préambule : Ce n’est ni le moment ni le lieu, mais… Puis vous trouverez toujours quelqu’un, entre la salade et le plat de résistance, qui a une anecdote encore plus ragoûtante et n’arrive pas à se la caler pour plus tard ou pour jamais. Alors vous gardez pour vous vos haut-le-cœur, parce qu’apparemment vous êtes bien le seul que ça incommode, et qu’il serait très malvenu d’étaler sur la nappe blanche ce dont ils parlent depuis le début du repas.
Cousin Raoul a eu, lui, la délicatesse d’aller jusqu’au perron de la salle à manger pour y déverser une pleine platée de salade russe dans laquelle dominait la betterave. En ce temps-là, on savait vivre.
Un soir que la faim le titillait, Julien a quitté son fauteuil-bière-télé et s’est approché de son épouse qui cuisinait, l’a prise tendrement par la taille et par-dessus son épaule, a jeté un coup d’œil sur ce qui mijotait dans la tite mormite. Il a semblé surpris, jusqu’à relâcher un peu son étreinte. Le compliment n’a pas tardé :
— C’est quoué ce vomi de chien-là ?
La réplique n’a pas tardé non plus, assaisonnée d’une pincée d’agacement, d’un zeste de mauvaise humeur et d’un soupçon d’énervement, à deux pas du hachoir à viande et du gros calou :
— C’est du vomi de chien !
Julien en a repris deux fois en répétant piteusement l’est bien bon, pour tenter de se faire pardonner, mais cette nuit-là, il a quand même dormi sur le cric.
Bon, passons vraiment à autre chose et tant pis pour Julien. Il apprendra à réfléchir un peu, ou à faire lui-même la cuisine, ou les deux.
- Fin du chapitre -

Tous les contenus du site internet de Lectivia sont protégés par la loi sur les droits d'auteur. L'utilisation, le partage ou la reproduction de toute partie du contenu sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur ou des ayants droits ou de Lectivia sera punis par la loi en vertu des règlements sur la violation du droits d'auteur et la propriété intellectuelle.