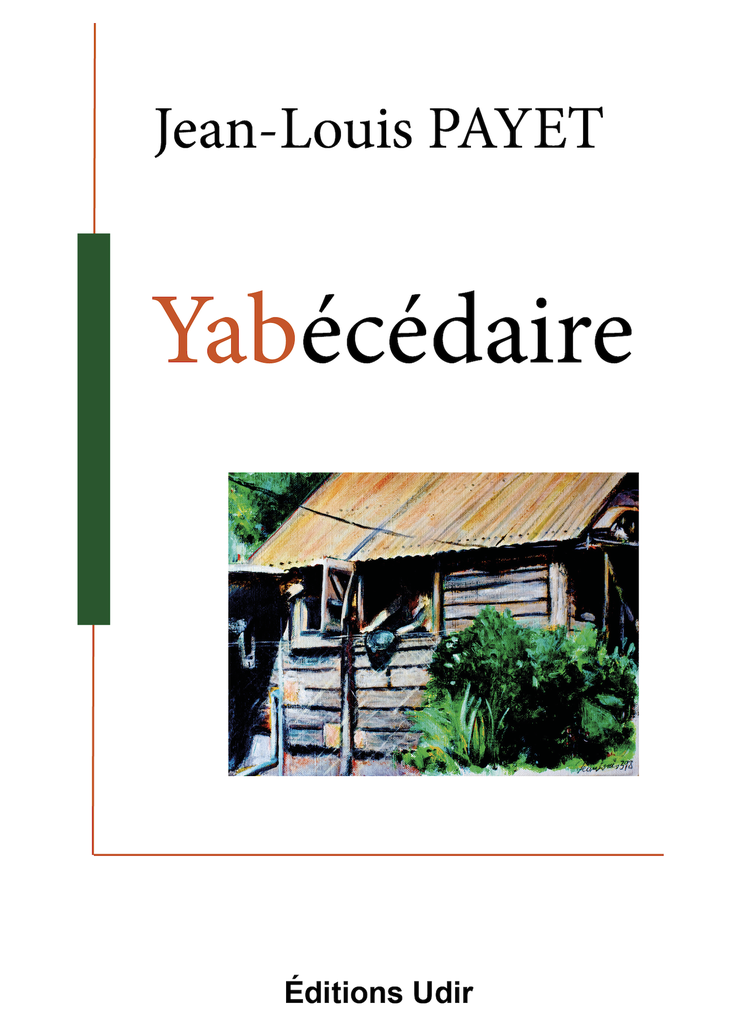
Yabécédaire
Editeur : UDIR
Auteur : Jean-Louis PAYET
ISBN : 978-2-87863-102-9
| Mis en ligne par | Lectivia |
|---|---|
| Dernière mise à jour | 11/10/2024 |
| Temps estimé de lecture | 3 minutes |
| Lecteur(s) | 5 |
Partager ce cours
Partager le lien
Partager sur les réseaux sociaux
Partager par email
Veuillez s'inscrire afin de partager ce Yabécédaire par email.

46. Moi je sais, puisque je suis institutrice
Monsieur et madame ont passé la journée chez leurs enfants à Le-Tang-Salé-les-Bains. En attendant le dîner, toute la famille se retrouve sur la plage à quelques pas de la maison pour admirer le soleil couchant. Marie-Paule, qui ne supporte pas de perdre son temps, a apporté ses aiguilles à tricoter et le cache-cœur qu’elle doit terminer avant l’anniversaire de son amie et collègue. Du haut de sa chaise de plage, et de sa voix d’amontreuse du haut de son pupitre, elle écrase l’auditoire de toute sa supériorité de maîtresse d’école ; elle relate par le menu les aventures de tous les personnages de tous les feuilletons-télé qu’elle a gobés goulûment durant la semaine. Heureusement que les autres s’en moquent parce que même le scénariste ne reconnaîtrait pas sa création si c’est Marie-Paule qui raconte.
Quand, il y a de cela bien longtemps, elle est parvenue à devenir institutrice, elle s’est sentie instantanément auréolée de tout le savoir du monde, nimbée de science infuse et le front ceint de palmes académiques, encouragée en ce sens par sa mère qui répétait à l’envi que si on ne savait pas, il fallait s’adresser à Marie-Paule, quel que soit le sujet, même en chinois, elle vous donnera la bonne réponse, puisqu’elle est essitutrice. Elle s’est alors empressée de s’entourer de tous les attributs de sa profession : un air condescendant, un mari non-fonctionnaire, une baguette de bambou, une règle en fer, une Peugeot 403 et une sœur quasi-analphabète pour s’occuper du ménage et des enfants à venir.
Chez ses collègues masculins, à part l’auto et la maîtresse (pas celle d’école), le plus gros de la panoplie se devait d’être en or : lunettes, stylo, montre, gourmette, épingle de cravate et au moins une dent, au besoin en se faisant arracher une canine saine. On pouvait se passer du jaseran, qui ne se voit que dans des circonstances particulières.
Revenons sur la plage, où ce soir-là donc, le soleil fait aux gens normaux l’ineffable cadeau de toute sa magnificence et Marie-Paule râle parce qu’elle ne distingue plus sa rangée, bécalu !
Bécalu est avec tabouret, le juron le plus soft de la langue créole.
Son mari, qui n’est pas instituteur, profite d’une accalmie dans la logorrhée conjugale pour faire part, avec une émotion à peine contenue, de son émerveillement et de son humilité devant ce spectacle féerique, toujours renouvelé et pourtant jamais semblable, qui depuis l’aube de l’humanité, jette comme un voile somptueux devant l’éternité, et puis cet insondable mystère…
Marie-Paule, en épouse raisonnable, le stoppe net dans ses élucubrations :
Ah vouzote,
ça d’là y fait des vers,
en plein air,
dans la touffe galabert…
Dans sa poésie-moucatage, elle cherche en vain d’autres rimes en air.
Se taire, peut-être ?
- Fin du chapitre -

Tous les contenus du site internet de Lectivia sont protégés par la loi sur les droits d'auteur. L'utilisation, le partage ou la reproduction de toute partie du contenu sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur ou des ayants droits ou de Lectivia sera punis par la loi en vertu des règlements sur la violation du droits d'auteur et la propriété intellectuelle.

Monsieur et madame ont passé la journée chez leurs enfants à Le-Tang-Salé-les-Bains. En attendant le dîner, toute la famille se retrouve sur la plage à quelques pas de la maison pour admirer le soleil couchant. Marie-Paule, qui ne supporte pas de perdre son temps, a apporté ses aiguilles à tricoter et le cache-cœur qu’elle doit terminer avant l’anniversaire de son amie et collègue. Du haut de sa chaise de plage, et de sa voix d’amontreuse du haut de son pupitre, elle écrase l’auditoire de toute sa supériorité de maîtresse d’école ; elle relate par le menu les aventures de tous les personnages de tous les feuilletons-télé qu’elle a gobés goulûment durant la semaine. Heureusement que les autres s’en moquent parce que même le scénariste ne reconnaîtrait pas sa création si c’est Marie-Paule qui raconte.
Quand, il y a de cela bien longtemps, elle est parvenue à devenir institutrice, elle s’est sentie instantanément auréolée de tout le savoir du monde, nimbée de science infuse et le front ceint de palmes académiques, encouragée en ce sens par sa mère qui répétait à l’envi que si on ne savait pas, il fallait s’adresser à Marie-Paule, quel que soit le sujet, même en chinois, elle vous donnera la bonne réponse, puisqu’elle est essitutrice. Elle s’est alors empressée de s’entourer de tous les attributs de sa profession : un air condescendant, un mari non-fonctionnaire, une baguette de bambou, une règle en fer, une Peugeot 403 et une sœur quasi-analphabète pour s’occuper du ménage et des enfants à venir.
Chez ses collègues masculins, à part l’auto et la maîtresse (pas celle d’école), le plus gros de la panoplie se devait d’être en or : lunettes, stylo, montre, gourmette, épingle de cravate et au moins une dent, au besoin en se faisant arracher une canine saine. On pouvait se passer du jaseran, qui ne se voit que dans des circonstances particulières.
Revenons sur la plage, où ce soir-là donc, le soleil fait aux gens normaux l’ineffable cadeau de toute sa magnificence et Marie-Paule râle parce qu’elle ne distingue plus sa rangée, bécalu !
Bécalu est avec tabouret, le juron le plus soft de la langue créole.
Son mari, qui n’est pas instituteur, profite d’une accalmie dans la logorrhée conjugale pour faire part, avec une émotion à peine contenue, de son émerveillement et de son humilité devant ce spectacle féerique, toujours renouvelé et pourtant jamais semblable, qui depuis l’aube de l’humanité, jette comme un voile somptueux devant l’éternité, et puis cet insondable mystère…
Marie-Paule, en épouse raisonnable, le stoppe net dans ses élucubrations :
Ah vouzote,
ça d’là y fait des vers,
en plein air,
dans la touffe galabert…
Dans sa poésie-moucatage, elle cherche en vain d’autres rimes en air.
Se taire, peut-être ?
- Fin du chapitre -

Tous les contenus du site internet de Lectivia sont protégés par la loi sur les droits d'auteur. L'utilisation, le partage ou la reproduction de toute partie du contenu sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur ou des ayants droits ou de Lectivia sera punis par la loi en vertu des règlements sur la violation du droits d'auteur et la propriété intellectuelle.

Que ton poème soit, dans les lieux sans amour,
où l’on trime, où l’on saigne, où l’on crève de froid,
comme un air murmuré qui rend les pieds moins lourds,
un café noir au point du jour,
un ami rencontré sur le chemin de croix.
Ce que dit Elsa (extrait), Louis Aragon
Restons dans les bals-mariage et changeons de lieu. Nous allons à la Rivière-Saint-Julien (prononcer Rivir) qui se trouve à une portée de galets de Pont-Les-Hauts. Ses habitants s’expriment exactement comme nous, paroles et musique, mais ils disent que nous chantons, ils en rigolent (là nous l’a ri là ! Nous, à terre pou rire !) et leurs jeunes gens adorent cogner sur les nôtres, et réciproquement. Les coups n’empêchent pas les coups de foudre et l’on voit parfois quelques pionniers-pionnières de l’entente cordiale s’unir devant Dieu et les hommes afin que leur postérité fraternise enfin. Nous sommes sur le bon chemin.
Avant la cérémonie du mariage, on attribue à chaque cavalier une cavalière qu’il ne connaît pas forcément, mais c’est l’occasion de tisser des liens et on a vu des couples éternels se former à partir de ces rencontres. L’usage veut que, si on ne se plaît pas mutuellement, ou si on est déjà amoureux hors cortège, on fasse ensemble au moins une danse de courtoisie et le reste de la soirée vous appartient.
Je ne sais plus qui m’a « attribué » cette jeune fille, jolie au demeurant, mais déjà entre les mains calleuses d’une sorte de taureau qui n’arrêtait pas de me fixer, l’œil globuleux, l’écume aux naseaux pendant tout le cortège ; et au plus il écumait, au plus ma cavalière se pendait à mon bras en imitant le sourire de la Joconde. Je crains les taureaux. Quand un bœuf vous fonce dessus, on dit qu’il charge ; chez nous on dit : Le bœuf y bourre. Je n’étais pas prêt et ne le suis toujours pas, à être bourré par qui que ce soit : après la première danse, je lui ai laissé la fille, qui continuait de sourire comme Mona Lisa, que Jackie Kennedy a si merveilleusement imitée.
Et maintenant, ou je rentre à la case, ou j’en trouve une autre.
Les lumières s’éteignent sur la piste et les premières notes du slow font se lever tous les jeunes gens qui s’en vont faire des courbettes aux quatre coins de la salle. J’avise une table en bord de piste : une petite un peu rousse, un peu pas mal, qui me détaille de la tête à l’ourlet, regarde sa maman et me dit non, merci. Non, ça suffit. Pourquoi merci, je n’ai rien fait. Je ne suis pas goujat, aussi ne l’ai-je pas priée, comme font certains jeunes malappris que l’on rembarre, d’aller pluche l’ail.
Je change de quartier : on ne prospecte pas dans la même zone après un refus parce que les voisines immédiates, même si elles sont intéressées par le beau jeune homme que voilà, ne vont jamais accepter ce qu’une autre, pour des raisons qui sont les siennes et elle ne sait pas ce qu’elle perd, vient de repousser d’une moue dédaigneuse sur sa figure qui n’est pas si jolie que ça.
Plus au nord, celle-là a accepté, bien qu’un peu gênée quand sa maman a braqué le faisceau de son phare dans ma figure :
— Par l’fait’, vous c’est le garçon de qui vous ?
J’ai donné la bonne réponse et elle m’a prêté sa fille, que j’ai entraînée sur la piste, que j’ai enlacée, à qui j’ai demandé son prénom et qui m’a répondu :
— Elsaaa, à cause ?
À cause margoze, mais l’occasion est trop belle d’étaler une noisette d’Aragon dont je viens de refermer le recueil de poèmes. Les lèvres collées à l’oreille de ma cavalière, je susurre, car il m’arrive de susurrer :
« Tes yeux sont si profonds qu’en me penchant pour boire,
j’ai vu tous les soleils y venir se mirer… »
Elsa (la mienne) s’est un peu éloignée de moi pour mieux m’examiner, les mains sur mes épaules, prête à prendre la fuite en cas de récidive, puis, les sourcils froncés sur ses yeux noirs, elle s’est adressée à elle-même à haute et chantante voix :
— Quoué ça d’là y veut ec moin lu là ?
Pour mon lecteur zoreil :
— Qu’est-ce qu’il me veut celui-là ?
Alors, pour que les regards se détournent de notre couple et pour faire vers elle un bout de chemin sans l’aide d’Aragon, avec des mots à moi qui, j’en ai bien peur, sont parfois un peu crus, un peu lestes, je lui ai expliqué en gros ce que je voulais d’elle et elle n’a pas sursauté. Elle s’est plaquée contre moi et tout le reste de la soirée, j’ai déglingué les lyres et fait fuir les poètes à grands coups de trivialités dans les muses.
Ça fait du bien parfois.
- Fin du chapitre -

Tous les contenus du site internet de Lectivia sont protégés par la loi sur les droits d'auteur. L'utilisation, le partage ou la reproduction de toute partie du contenu sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur ou des ayants droits ou de Lectivia sera punis par la loi en vertu des règlements sur la violation du droits d'auteur et la propriété intellectuelle.

« Je sais que l’an dernier, un jour, le douze mai,
pour sortir le matin, tu changeas de coiffure. »
Cyrano de Bergerac, Edmond Rostand.
La mémoire de l’éléphant est légendaire, celle de Maxeau l’est un peu moins parce qu’aucun scientifique ne l’a étudiée jusqu’à présent. Il ne serait pourtant pas déçu des résultats de ses recherches pour peu qu’il se donne la peine de se déplacer jusqu’à Pont-Les-Hauts, au numéro trois du chemin Galabé.
Durant toute sa scolarité, Maxeau n’avait ramassé que des moques en histoire-géo. Des moques en tout d’ailleurs. Ce qu’on voulait lui faire croire, c’est qu’il y aurait eu des époques antérieures à la sienne (fais pas rire à moin, couillon, ma lèvre l’est pétée), ainsi que d’autres lieux que La Rénion où des gens pouvaient exister. Alors, forcément, ça l’avait dégoûté de l’école et avec les encouragements de son père, il était venu aider ce dernier à cultiver la canne et à songner les zanimo.
Cependant il avait développé, dès son enfance, une forme de mémoire assez exceptionnelle qui lui permettait de dire avec précision ce qu’il s’était passé la veille ou même un an auparavant. Il n’avait rien eu à faire pour cultiver ce don, ça lui venait, c’est tout.
Certains sont incollables sur les noms des médicaments, d’autres ont, à propos des visages, des noms propres et des liens de parenté, une véritable machine dans la tête, d’autres encore n’oublient jamais un anniversaire, même chez la famille lointaine ou les amis de passage. Maxeau était un peu tout ça, et avec le temps, il était devenu la référence et l’arbitre dans tout conflit ou contestation relatifs à un fait ou à un événement dont il avait été témoin. Certains le surnommaient le magnétophone. Si vous lui parliez de quelque chose aujourd’hui et que, six mois plus tard, vous changiez ne serait-ce qu’une virgule à votre récit, il rectifiait illico.
— C’était pas un douze, mais un treize sectamb. Augusse y venait de charger sa charrette manger-bœuf, la plue y farinait et vous l’était en pantalon beige et chemise bleue (c’est pourtant vrai) ; après ça, l’était huit heures moins le quart pile quand Joseph l’a arrivé et l’a dit à vous comme ça que lu peux pas rembourse à vous ce mois-ci et si y dérange pas vous d’attendre l’année prochaine et si vi peux arprête à lu oncore trois mille francs, comme ça y fait ain’ compte rond et si vi sava Saint-Léon jordu, oublie pas emmène à lu parce que lu n’a trois quatre commissions pou faire, et ar dépose à lu sa case après, parce que les gounis l’est risquab être un peu lourds et si lu remonte par le car, ça va prendre su’ son argent de remboursement et c’est vous-même qui sera perdant.
Il était passionné de foot, ayant lui-même évolué quelques années comme défenseur dans l’équipe locale, et il était capable, longtemps après, de vous restituer dans le détail, toutes les phases de tel ou tel match, mieux qu’une rediffusion ou qu’un Vincent Gendolor dans le posse-radio.
Avant le mariage de Maxeau, la vie de sa fiancée n’avait déjà plus aucun secret pour lui. Il connaissait bien sûr la date et l’heure de sa naissance, mais aussi ses premières dents, sa varicelle, la fois où elle l’a tombé dans la baille, quelle robe elle portait pour sa première communion, ses amoureux, ses serviettes et tampons, ses notes en classe de fin d’études ainsi qu’une tralée de détails qui n’auraient absolument aucune importance pour le commun des mortels, mais Maxeau, bien que mortel, n’était pas commun.
Jenny avait d’abord été subjuguée par le phénomène Maxeau ; il devait avoir à ses yeux un certain charme, puisqu’elle ne lui en voulait pas de se moquer de son prénom de cyclone. Elle s’amusait à lui poser des questions de plus en plus précises en remontant le temps et en variant les sujets ; il faisait toujours un sans-faute et si les jeux radiophoniques de ladilafé existaient, il aurait été champion toutes catégories.
Toute médaille a son revers. Le don de Maxeau lui collait dans son quotidien un côté maniaque et une intolérance à tout ce qui n’était pas précis, pesé, exact, juste, sans bavure, minuté, cuit à point, repassé, pas trop chaud (le manger), pas trop froid (elle), à sa place.
Lorsqu’après quelques mois d’absence, j’avais revu Maxeau, il m’avait donné sans attendre, avec la voix neutre d’un comptable qui expose son bilan, la nouvelle la plus importante de l’année :
— Ma femme m’a quitté le lundi neuf mars à quatorze heures trente-cinq minutes (14 h 35 min), juste après le café et le gâteau-patates. Y faisait à nous sept ans, trois mois et douze jours de mariage.
Là tu nous déçois Maxeau. Et les heures, et les minutes ?
- Fin du chapitre -

Tous les contenus du site internet de Lectivia sont protégés par la loi sur les droits d'auteur. L'utilisation, le partage ou la reproduction de toute partie du contenu sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur ou des ayants droits ou de Lectivia sera punis par la loi en vertu des règlements sur la violation du droits d'auteur et la propriété intellectuelle.