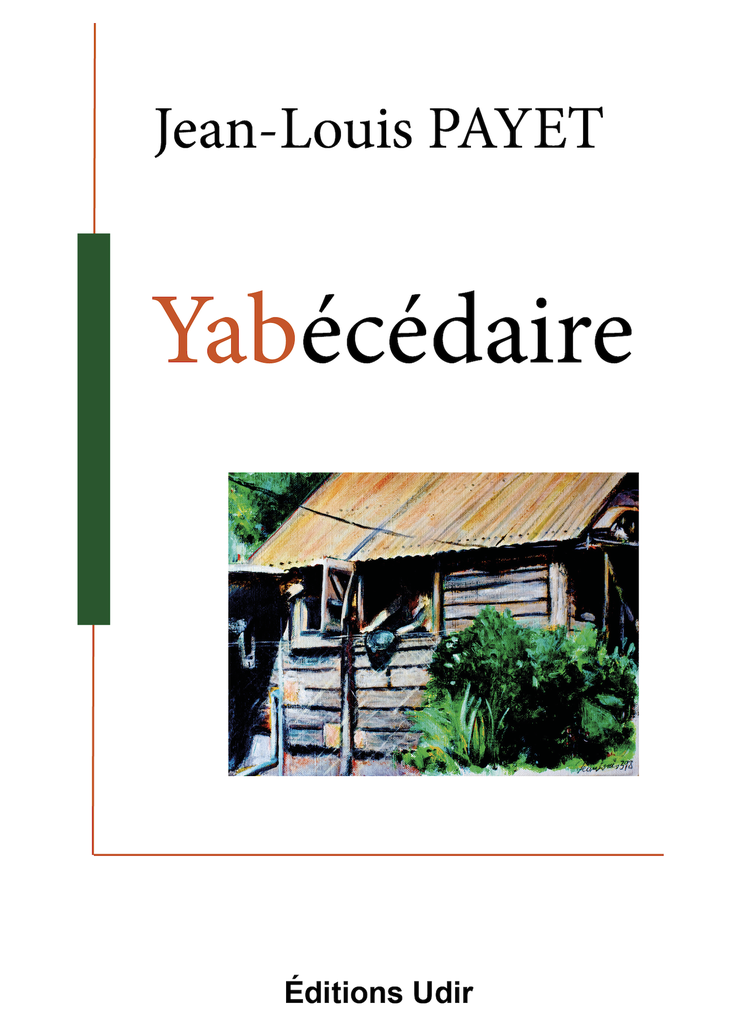
Yabécédaire
Editeur : UDIR
Auteur : Jean-Louis PAYET
ISBN : 978-2-87863-102-9
| Mis en ligne par | Lectivia |
|---|---|
| Dernière mise à jour | 11/10/2024 |
| Temps estimé de lecture | 3 minutes |
| Lecteur(s) | 5 |
Partager ce cours
Partager le lien
Partager sur les réseaux sociaux
Partager par email
Veuillez s'inscrire afin de partager ce Yabécédaire par email.

46. Moi je sais, puisque je suis institutrice
Monsieur et madame ont passé la journée chez leurs enfants à Le-Tang-Salé-les-Bains. En attendant le dîner, toute la famille se retrouve sur la plage à quelques pas de la maison pour admirer le soleil couchant. Marie-Paule, qui ne supporte pas de perdre son temps, a apporté ses aiguilles à tricoter et le cache-cœur qu’elle doit terminer avant l’anniversaire de son amie et collègue. Du haut de sa chaise de plage, et de sa voix d’amontreuse du haut de son pupitre, elle écrase l’auditoire de toute sa supériorité de maîtresse d’école ; elle relate par le menu les aventures de tous les personnages de tous les feuilletons-télé qu’elle a gobés goulûment durant la semaine. Heureusement que les autres s’en moquent parce que même le scénariste ne reconnaîtrait pas sa création si c’est Marie-Paule qui raconte.
Quand, il y a de cela bien longtemps, elle est parvenue à devenir institutrice, elle s’est sentie instantanément auréolée de tout le savoir du monde, nimbée de science infuse et le front ceint de palmes académiques, encouragée en ce sens par sa mère qui répétait à l’envi que si on ne savait pas, il fallait s’adresser à Marie-Paule, quel que soit le sujet, même en chinois, elle vous donnera la bonne réponse, puisqu’elle est essitutrice. Elle s’est alors empressée de s’entourer de tous les attributs de sa profession : un air condescendant, un mari non-fonctionnaire, une baguette de bambou, une règle en fer, une Peugeot 403 et une sœur quasi-analphabète pour s’occuper du ménage et des enfants à venir.
Chez ses collègues masculins, à part l’auto et la maîtresse (pas celle d’école), le plus gros de la panoplie se devait d’être en or : lunettes, stylo, montre, gourmette, épingle de cravate et au moins une dent, au besoin en se faisant arracher une canine saine. On pouvait se passer du jaseran, qui ne se voit que dans des circonstances particulières.
Revenons sur la plage, où ce soir-là donc, le soleil fait aux gens normaux l’ineffable cadeau de toute sa magnificence et Marie-Paule râle parce qu’elle ne distingue plus sa rangée, bécalu !
Bécalu est avec tabouret, le juron le plus soft de la langue créole.
Son mari, qui n’est pas instituteur, profite d’une accalmie dans la logorrhée conjugale pour faire part, avec une émotion à peine contenue, de son émerveillement et de son humilité devant ce spectacle féerique, toujours renouvelé et pourtant jamais semblable, qui depuis l’aube de l’humanité, jette comme un voile somptueux devant l’éternité, et puis cet insondable mystère…
Marie-Paule, en épouse raisonnable, le stoppe net dans ses élucubrations :
Ah vouzote,
ça d’là y fait des vers,
en plein air,
dans la touffe galabert…
Dans sa poésie-moucatage, elle cherche en vain d’autres rimes en air.
Se taire, peut-être ?
- Fin du chapitre -

Tous les contenus du site internet de Lectivia sont protégés par la loi sur les droits d'auteur. L'utilisation, le partage ou la reproduction de toute partie du contenu sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur ou des ayants droits ou de Lectivia sera punis par la loi en vertu des règlements sur la violation du droits d'auteur et la propriété intellectuelle.

On se traite de con,
à peine qu’on se traite.
Claude Nougaro
Oté couillon !
Celui à qui on s’adresse en ces termes n’est pas forcément un imbécile, ni quelqu’un à qui il manque quelques petites choses. Il s’agit ici simplement d’une sorte de ponctuation censée renforcer la narration, exactement comme le « con » toulousain.
Mais voilà une richesse, une de plus, de notre vocabulaire des Hauts qui est en train de disparaître à cause de la susceptibilité de certains interlocuteurs. On entendra rarement de nos jours :
— Té couillon, viens ‘oir ça qu’moin l’a trouvé, couillon. Hein angarde couillon : ain’ canette couillon !
Évidemment, Ti-Toine n’a pas pensé un seul instant qu’on ne s’adresse pas ainsi à son maître d’école, même s’il s’agit d’un remplaçant qu’on appelle ti-maître et qui a l’air si gentil. Il a eu tout le temps d’y réfléchir, à genoux, au coin de la salle de classe, après avoir tâté de la baguette-bambou. Et défense de s’asseoir sur les talons, ni de se retourner, ni de rire, ni de pleurer.
Lorsqu’un marmaille se blessait et, quêtant à la fois des soins et de la compassion, présentait à l’adulte son doigt sanguinolent, il avait droit à un regard neutre suivi de :
— Vous l’est pas assez couillon !
C’est seulement après que le blessé avait droit à un flot d’alcool à brûler sur son index, qu’on engarotait ensuite comme un baba-chiffon.
Le maître d’école, à part l’argument du bâton, n’a pas donné à Ti-Toine plus d’explication que ça sur le motif de sa punition, alors, devenu adulte, il a nourri une solide aversion envers les maîtres du primaire. Il n’est pas allé plus loin à l’école et si on insiste bien, il vous dira simplement que ce ti-maître là l’a peuse couillon à terre pou prendre la place.
- Fin du chapitre -

Tous les contenus du site internet de Lectivia sont protégés par la loi sur les droits d'auteur. L'utilisation, le partage ou la reproduction de toute partie du contenu sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur ou des ayants droits ou de Lectivia sera punis par la loi en vertu des règlements sur la violation du droits d'auteur et la propriété intellectuelle.

Méfie-toi d’un jeune médecin et d’un vieux coiffeur.
Benjamin Franklin
Bien sûr tout le monde chez nous allait au coiffeur, car jamais personne ne disait aller chez lui. Le cheveu long n’était pas bien vu chez les garçons et les mamans vous expédiaient vite fait chez Philaumar dès que votre oreille n’était plus entièrement visible, et de toute façon elle vous y envoyait quelques jours avant la rentrée, comme si cette dernière punition, à elle seule, ne suffisait pas.
La clientèle de notre coiffeur a sensiblement diminué pendant ces années où les jeunes gens imitaient leurs idoles en harnachant leur tête d’une boursouflure capillaire laquée, tandis que leur taille se cintrait, que les pattes de leurs pantalons s’éléphantaient et que les pattes de leurs rouflaquettes s’allongeaient.
Monsieur Philaumar, ne s’étant pas reconverti, n’a pas pu suivre la tendance, lui qui avait toujours pratiqué une coupe maîtrisée au poil près qu’il se refusait à appeler coupe-au-bol, car il savait aussi coiffer avec d’autres ustensiles et il pouvait s’occuper également des cheveux féminins.
La petite échoppe de monsieur Philaumar était l’ancien magasin en bois sous tôle de madame Delphine, c’est là qu’il a exercé son métier une grande partie de sa vie, avant de changer d’adresse et de s’installer dans le garage en dur de matante Lise, un peu plus loin que la rue de la boutique ; sa clientèle et les descendants l’ont suivi jusqu’après ses quatre-vingts ans. Il travaillait la même coupe de cheveux, on ne change pas une recette qui marche, et gardait en toutes circonstances cette bonhomie qui faisait que son petit salon de coiffure ne désemplissait pas, malgré la saine concurrence de Dany installé cent mètres plus loin.
Autour de l’imposant fauteuil inclinable en bois et skaï, sa majesté monsieur Philaumar vaque comme dans son palais. Pli de pantalon impeccable sur souliers cirés, tours-de-bras métalliques pour ses manches de chemise, il aiguise son coupe-chou sur une lanière de cuir accrochée à la cloison ; il a ses lunettes en or sur le bout du nez et regarde alternativement dedans et par-dessus, tandis que son corps entier, pied droit en avant, suit le mouvement du bras d’avant en arrière. Ses outils de travail, multipliés par deux dans le grand miroir, sont alignés sur la commode en attendant le bon vouloir et le savoir-faire du maître.
Il secoue d’un clac la grande serviette blanche qui soulève un tourbillon de cheveux coupés sur le plancher disjoint, la passe autour du cou du jeune homme agrippé aux poignées, et la croise derrière son dos. Le spèce bavoir en caroutchou par-dessus. La coupe peut commencer.
Début des opérations : la grosse tondeuse qu’il fait claquer trois fois à vide, il pousse d’une main douce et ferme la tête du coiffable (coupable ?) qui courbe aussitôt la nuque comme un orant. Ce qu’il semble craindre se produit : la tondeuse monte en cliquetant jusqu’au sommet de son crâne et dégarnit un large espace, comme la trace laissée par une journée de coupe dans un caro de cannes. Le jeune homme se résigne : la rentrée c’est dans quinze jours, les dégâts seront moins visibles et les moucatages moins lourds. Tandis qu’il achève de débroussailler l’occiput, monsieur Philaumar chantonne Mexico, Mexiiiico, comme pour donner du courage à sa victime.
Monsieur Armand vient d’entrer et, avant même de s’asseoir, commence à vitupérer politique : toutes l’est pourris, n’a point ain’ pou rachète l’autre ; notre coiffeur adhère entièrement à ses opinions qu’il exprime par des : Mais voui, bien sûr, ah bah ! qu’il a servis le matin même à un client qui soutenait l’opinion contraire.
Les ciseaux entrent en action, puis le rasoir pour une bordure bien nette autour des oreilles et sur la nuque. Époussetage au blaireau, vaporisation à tout-va d’une eau de Cologne qui distillera ses effluves pendant une bonne semaine, et Figaro tient fièrement un miroir derrière ma tête pour que je voie à quel point il a scrupuleusement respecté mon souhait d’une coupe à la Marlon Brando. J’acquiesce tristement en me disant qu’avec une tête pareille, l’acteur se fermerait à coup sûr l’accès aux studios hollywoodiens. Ou alors ce ne serait pas Un tramway nommé désir mais Une charrette nommée délire.
Y fait dix francs.
Soir de rentrée à l’internat du lycée de Saint-Urbain. J’ai bien fait d’avancer de quinze jours le rendez-vous coiffure ; mes cheveux ont eu le temps de repousser et ma coupe n’attire pas l’attention des copains-moucateurs ; je peux me croire à l’abri jusqu’aux prochaines vacances.
Outre l’interdiction de marcher en savates-doigts-de-pied, de porter des jeans délavés (la limite de délavage étant laissée à l’appréciation du pion), de faire le mur, de lire des bandes dessinées ou des revues pornographiques, de fumer, de répondre aux membres du corps enseignant et de soutenir leur regard, de se battre, de parler ou dormir en classe, de faire des graffitis avec les marqueurs qu’on a sous la main dans les cabinets aux demi portes et chasse d’eau automatique, d’avoir des mauvaises notes sous peine de six heures de colle un dimanche entier, le règlement du lycée interdisait expressément le cheveu long. La tolérance allait jusqu’à environ vingt-deux millimètres, pas plus, et sur le haut du crâne seulement. Surveillants, surveillants généraux, censeur et proviseur veillaient au respect de cette loi fondamentale et déterminante pour l’avenir de la belle jeunesse de chez nous.
Deux semaines à peine avant les vacances de Noël, nous étions en classe de latin, tranquilles, à nous amuser comme des fous sur une version de Cicéron, face à notre prof rigolo comme tout, lorsque notre appariteur qu’on surnommait Gary, à cause d’une très vague mais flatteuse ressemblance avec Cooper, a annoncé l’entrée de monsieur le proviseur qui venait nous livrer les noms des lauréats des compositions du premier trimestre. Il les a félicités, malgré leur tête de premiers de la classe, avec l’assentiment de l’enseignant qui s’est fendu d’un rictus, puis a regardé dans ma direction, et comme j’étais avant-dernier ex-æquo, je me suis douté qu’il n’allait pas me parler latin.
— Qu’est-ce que c’est que cette chevelure absalonienne ?
C’était presque du latin.
Absalon, fils de David, devait avoir une sacrée crinière et être fichtrement maladroit (après mon prof de français, plus personne n’a dit fichtrement) pour se prendre les cheveux dans les branches ; les miens ne mesuraient pas plus de vingt-trois millimètres, mais cela n’avait pas échappé à l’œil avisé du débonnaire chef d’établissement. Un réflexe idiot m’a fait me gratter la tête, tandis que la classe entière se retournait pour me dévisager. Je tentais désespérément d’être moins rouge et d’avoir l’air décontracté, et j’ai reçu l’ordre de passer chez le coiffeur dès le lendemain jeudi, lors de la sortie surveillée de l’après-midi.
Mon argent de poche ayant fondu en grande partie dans le flipper, le coca et un ami emprunteur-non-rendeur, il me restait juste de quoi offrir ma tête au coiffeur Crépin. Il sévissait à un coin de rue du lycée et, pour un prix aussi ridicule, sa technique rudimentaire rendait son art reconnaissable entre tous.
« Crépin, coiffeur parisien,
Crépin, coiffeur de demain. »
C’est ce que d’habitude, on chantait en ronde autour du massacré. Les plus gentils de mes copains se sont contentés de sourire en me voyant, tandis que Guito affirmait, pince-sans-rire, que là, vraiment, Crépin s’était surpassé et que je serais gentil de lui prêter ma tête pour faire rire son petit frère.
Je décidais de rentrer à ma case de Pont-Les-Hauts, avant la date officielle des vacances, afin de confier au génial, à l’incomparable, à l’unique monsieur Philaumar le soin de réparer les dégâts occasionnés sur mon coco-de-tête par son confrère de la ville, de niveler les chemins de rats et de retrouver ainsi une sorte de normalité capillaire sur l’air de Mexiiico.
- Fin du chapitre -

Tous les contenus du site internet de Lectivia sont protégés par la loi sur les droits d'auteur. L'utilisation, le partage ou la reproduction de toute partie du contenu sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur ou des ayants droits ou de Lectivia sera punis par la loi en vertu des règlements sur la violation du droits d'auteur et la propriété intellectuelle.

À l’arrière des Dauphines.
Alain Bashung
La petite Renault blanche s’engage dans une impasse sablonneuse et s’arrête en lisière de forêt, à l’ombre d’un pied de tamarin. L’endroit est désert et difficilement accessible en voiture ; il faut la laisser filer en première, sans à-coups, sans accélération, sinon c’est l’ensablement.
Je me penche vers ma jolie passagère brune (oui, nous sommes à l’avant) qui ne semble pas effarouchée, mais proteste un peu et se fait prier parce que c’est comme ça, toutes les mamans l’ont fait avant elle. Le dossier s’incline lentement et nos lèvres s’unissent comme dans les plus beaux romans-photos. Malgré les vitres baissées, il fait un peu chaud et nos vêtements de plage nous semblent superflus. Ils tombent l’un après l’autre et nous nous laissons gagner par une délicieuse frénésie.
Si vous croyez pour vraiment que tout peut se passer de manière aussi idéale, alors je vous mets au défi de prendre une Dauphine et une brune, et d’aller embrasser l’autre dans l’une, où vous voudrez. Pour abaisser le dossier, il faut tourner une grosse molette à droite du siège, ce qui vous oblige à vous tenir sur le quart de la fesse droite, un genou par-dessus le levier de vitesse. La molette fait trois tours dans le vide, tandis que vous approchez vos lèvres ; à ce moment-là, le dossier bascule de trois bons crans et toutes vos dents s’entrechoquent, les vôtres et celles de la brune.
Prenez une blonde si vous préférez, mais alors plutôt dans une Simca P-soixante : le levier de vitesse se trouve sous le guidon.
Enfin vous vous stabilisez et tentez de vous débarrasser de votre chemise collante (je vous rappelle qu’il fait chaud), tout en faisant ce qu’il faut pour que le désir ne faiblisse pas. Les étreintes lascives se transforment en contorsions ridicules et vous vous dites qu’avec la chemise, ça ira aussi bien. Vous venez de dénuder les épaules de votre blonde et vos genoux vous font mal, même si c’est la posture que vous jugez la plus adaptée et vous n’avez pas le choix.
J’en suis là, avec ma brune, quand nous ressentons comme un tremblement de terre qui fait tanguer, puis rouler notre Dauphine. Le septième ciel nous semble bien orageux. Les mouvements s’amplifient ; nous nous redressons. Une bande de marmailles hilares, moyenne d’âge douze ans, lâche les pare-chocs et surgit tout autour de nous comme des petits diables à ressort. Ils restent deux secondes devant toutes les vitres avant de s’égailler dans les bois avec des grands cris de victoire.
Ma brune n’a pas tout perdu : elle a beaucoup ri, et loin de la Dauphine, ça a été partie remise.
Parmi tous les ti-couillons à l’origine du tremblement de terre, il y en a un que j’ai parfaitement reconnu : c’était moi, dix ans plus tôt.
- Fin du chapitre -

Tous les contenus du site internet de Lectivia sont protégés par la loi sur les droits d'auteur. L'utilisation, le partage ou la reproduction de toute partie du contenu sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur ou des ayants droits ou de Lectivia sera punis par la loi en vertu des règlements sur la violation du droits d'auteur et la propriété intellectuelle.